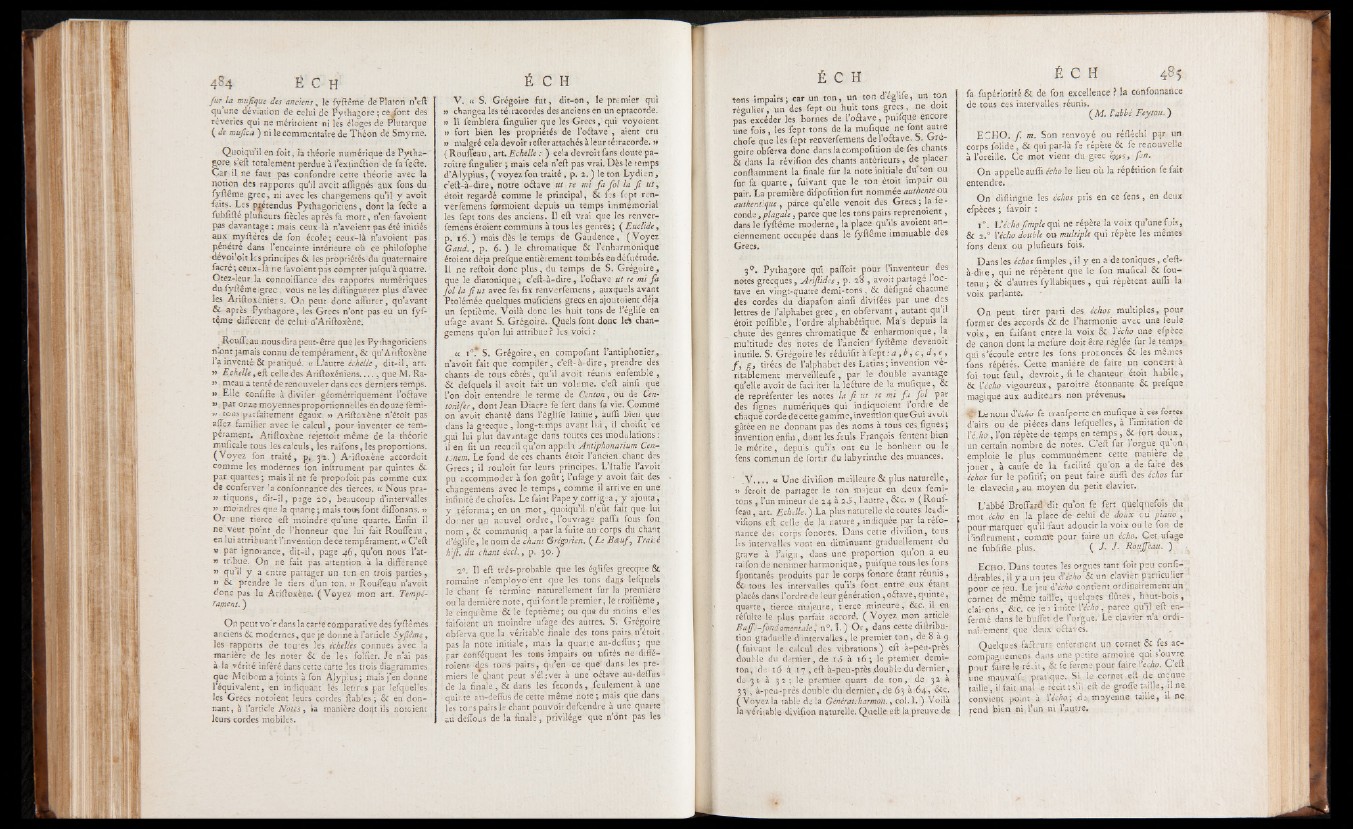
fur la muf que des anciens, le fyftême de Platon n’eft
qu’une déviation de celui de Pythagore ; cejfônt des
rêveries qui ne méritoient ni les éloges de Plutarque
( de mujîca ) ni le commentaire de Théon de Smyrne.
Quoiqu’il en fa it, la théorie numérique de Pythagore
s’eft totalement perdue à l’extinâion de fa fç&e.
Car il ne faut pas confondre cette théorie avec la
notion des rapports qu’il avcit aflignés aux fons du
fyftême grec, ni avec les changemens qu’il y avoit
faits. Les prétendus Pythagoriciens, dont la fe&e a
fubfifté pluliaurs fiècles après fa mort, n’en favoient
pas davantage : mais ceux-là n’aveient pas été initiés
aux myfteres de fon école; ceux-là n’avoient pas
pénétré dans l’enceinte intérieure où ce philofophe
devoi'oit k s principes & les propriétés du quaternaire
facré; ceux-là~ne favoient pas compter jufqu’à quatre.
Gtez-Ieur la connoiffance des rapports numériques
du fyftême,grec , vous ne les diftinguerez plus d’avec
les Ariftoxéniers. On peut donc affurer, qu’avant
après Pythagore, les Grecs n’ont pas eu un fyf-
teme différent de celui d’Ariftoxènë.
. R©uff;au nous dira peut-être que les Pythagoriciens
n.ont jamais connu de tempérament, & qu’Ariftoxène
l’a inventé & pratiqué. « L’autre échelle , dit-il, art.
» Echelle, eft celle des Ariftoxéniens.. . . , que M. Ra-
j> meau a tenté de renouveler dans ces derniers temps.
» Elle confifte à divifer géométriquement l’oâave
v par onze moyennes proportionnelles en douze femi-
■ * tons parfaitement égaux. » Ariftoxène n’étoit pas
aftez familier avec le calcul, pour inventer ce temperament.
Ariftoxène rejettoit même de la théorie
muficale t.ous les calculs, les raifons, les proportions.
(Voyez fon traité, p* 3-2. ) A rifloxène accordoit
comme les modernes fon inftrument par quintes &
par quartes ; mais il ne fe propofoit pas comme eux
de conferver -a confonnance des tierces. « Nous pra-
» tiquons, dit-il, page 20, beaucoup d’intervalles
” nio.ndres que la quarte ; mais tours font diffonans.
Or une tierce eft moindre qu’une quarte. Enfin il
ne veut point de l’honneur que lui fait Rouffeau,
en lui attribuant l’invention de ce tempérament. «G’eft
v P^r ignorance, dit-il, page 46, qu’on nous"l’at-
» tr.bue. On ne fait pas attention à la différence
» qu’il y a entre partager un tçn en trois parties,
” & prendre le tiers d’un ton. » Rouffeau n’avoit
donc pas lu Ariftoxène. (V oy e z mon art. Tempérament.
)
On peut vo'r dans la carte comparative des fyftêmes
anciens & modernes, que je donne à l’article Syfiême,
les rapports de toutes les échelles connues avec la
manière de les noter & de les folfier. Je n’ai pas
à-la vérité inféré dans cette carte les trois diagrammes
que Meibom a joints à fon Alÿpius ; mais j’en donne
l’équivalent, en indiquant lés lettres par iefquelles
les Grecs notoient leurs cordes f tab-es& en donnant,
à l’article Notes, la manière dont ils notcient
leurs cordes mobiles.
V . . a S. Grégoire fu t, dit-on, le premier qui
»> changea les tétracordes des anciens en un eptacorde.
» Il femblera fingulier que les Grecs, qui voyoient
» fort bien les propriétés de l’o&ave , aient cru
» malgré cela devoir refter attachés à leur térracorde. »
( Rouffeau, art. Echelle : ) cela devroit fans doute pa-
roître fingulier ; mais cela n’eft pas vrai. Dès le temps
d’Alypius, ( voyez fon traité, p. 2. ) le ton Lydien ,
c’eft-à-dire, notre o&ave ut re mi fa fo l la f i ut,
étoit regardé comme le principal, & fes fept ren-
verfemens fcwmoient depuis un temps immémorial
les fept tons des anciens. Il eft vrai que les renver-
femens étoient communs à tous les genres ; ( Euclide,
p. 16 .) mais dès le temps de Gaudence, (Voyez
Gaud., p. 6. ) le chromatique & l’enharmonique
étoient déjà prefque .entièrement tombés en défuétude.
Il ne reftoit donc plus, du temps de S. Grégoire ,
que le diatonique ; c’e ft-à -d ire i’oâave ut re mi fa
fo l la f i ut avec fes fix renverfemens, auxquels avant
Ptolémée quelques muficiens grecs en ajoutaient déjà
un feptième. Voilà donc les huit tons de l’églife en
ufage avant S. Grégoire. Quels font donc lefc chanr
gemens qu’on lui attribue ? les voici ;
a 1 . S. Grégoire, en compofant Pantiphonier.,
n’avoit fait que compiler, c’eft- à-dire, prendre des
chants de tous côtés, qu’il avoit réunis enfemble ,
& defquels il avoit fait un volume, c’eft ainfi que
l’on doit entendre le terme de Centon, ou de Cen-
tonifer, dont Jean Diacre fe fert dans fa vie. Comme
on avuit chanté dans l’églife latine, àufïï bien que
dans la grecque, long-temps avant lu i, il choifit ce
_qui lui plut davantage dans toutes ces modulations :
il en fit un recueil qu’on appela Antïphonarium Cen-
tonem. Le fond de ces chants étoit l’ancien.chant des
Grecs ; il rouloit fur leurs principes. L’Italie l’avoit
pu accommoder à fon goût ; l’ufage y avoit fait des
changemens avec le temps, comme il arrive en une1
infinité de chofes. Le faint Pape y corrigea ; y ajouta,
y réforma ; en un mot, quoiqu’il, n’eût fait que lui
donner un nouvel ordre, l’ouvrage paffa fous fon
nom , & communiqua parla fuite au corps du chant
d’églife, le nom de chant Grégorien. ( Le Boeuf Traité
h fi. du chant éccl. , p. 30. )
2°. Il eft très-probable que les églifes grecque &
romaine n’employoent que les tons dans- lesquels
le chant fe termine naturellement fur la première
oula dernière note, qui font le premier, le troifième ,
le cinquième & le leptième; ou que du moins elles
faifoient un moindre ufage des autres. S. Grégoire
obferva que la véritable finale des tons pairs n’étoit
pas la note initiale, mais la quarte au-deffus; que
par èonféquent les tons impairs ou ufités ne diffé-
iroient des tons pairs, qu’en ce que' dans les pre-
; miers le qhant peut s’élever à une o&ave au-deffus
| de la finale, & dans les féconds, feulement à une
: quir.te au-deffus de cette même note ; mais que dans
les tors pairs le chant pouvoit defcéndre à une quarte
au dèffous de la finale, privilège que n’ont pas les
tons impairs; car un ton, un ton d’égUfe, un ton
régulier, hn des fept ou huit tons grecs, ne doit
pas excéder les bornes de l’o â av e , puifque encore
une fo is , les fept ton? de la mufique ne font autre
chofe que les fept renverfemens del’oélave. S. Gre-
goire obferva donc dans la compofition de fes chants
& dans la révifion des chants antérieurs, de placer
conftamment la finale fur la note initiale du ton ou
fur fa quarte, fuivant que le ton étoit impair ou
pair. La première difpofition fut nommée authente ou
authentique, parce qu’elle venoit des Grecs ; la fe -
conde splagale, parce que les tons pairs reprenoient,
dans le fyftême moderne, la place qu’ils avoient anciennement
occupée dans le fyftême immuable des
Grecs.
39. Pythagore qui paffoit pour l’inventeur des
notes grecques, Ariflides , p. 28 , avoit partagé 1 octave
en vingt-quatre demi-tons , & défigne chacune
des cordes du diapafon ainfi divifées par une des
lettres de l’alphabet grec, en obfervant, autant qu il
étoit poflible, l’ordre alphabétique. Mas depuis la
chute des genres chromatique & enharmonique, la
multitude des notes de l’ancien fyftême devenait
inutile. S. Grégoire les réduifit à fept : a ,b 9 c , d 9 e,
f 9 gy tirées de l’alphabet des Latins ; invention véritablement
merveilleufe, par Te double avantage
qu’elle avoit de faci iter la leâure de la mufique, &
de repréfenter les notes la f i ut re mi fa fol par
des fignes numériques qui indiquoient l’ordre de
chaque corde de cette gamme, invention que Gui avoit
gâtée en ne donnant pas des noms à tous ces fignes;
invention enfin , dont lesieuls François fentent bien
le mérite, depuis qu’ils' ont eu le bonheur ou le
fêns commun de fortir du labyrinthe des muances.
’ . V __u Une divifion meilleure & plus naturelle,
» feroit de partager le ion majeur en deux femi-
tons , l’un mineur de 24 à 2x5, l’autre, &c. » (Rouffeau,
art. Echelle.') La plus naturelle de toutes leidi-
vifions eft celle de la rature , indiquée par la réfo-
nance des corps fonores. Dans cette divifion, tous
Ls intervalles vont en diminuant graduellement du
grave à l’aigu, dans une proportion quona eu
rai fon de nommer harmonique, puifque tous les fons
fpontanés produits par le corps fonore étant réunis ,
&■ tous les intervalles qu’ils font entre eux étant
placés dans l’ordre de leur génération ,o£tave, quinte,
quarte, tierce majeure, tierce mineure, &c. il en
réfülte le plus parfait accord. (V o y e z mon article
Baffe-fondamentale,' n°. I. ) O r , dans cette diftribu-
tion graduelle d intervalles, le premier ton, de 8 a 9
(fuivant le calcul des vibrations) eft àrpeu-pres
double du dernier, de 15 à 16 ; le premier demi-
ton, de 16 à 17 , eft à->peu-près,double du dernier,
de 31 à .32 ; le premier quart de ton, de 32 a
33 , à-peu-près double du dernier, de 63 à -64, &ç.
(V oyez la table de la Générât: harmon. , col. 1. ) Voilà
la véritable divifion naturelle. Quelle eft la preuve de
fa fupériorité & de fon excellence ? la confonnance
de tous ces intervalles réunis.
(M. l'abbé Feytou.)
ECHO. f . m. Son renvoyé ou réfléchi par un
corps fôlide, & q u i par-là fe répète & fe renouvelle
à l’oreille. Ce mot vient du grec fon.
On appelle aufli écho le lieu où la répétition fe fait
entendre.
On diflingue les échos pris en ce fens, en deux
efpèces ; favoir :
i° . b 1 écho fimple qui ne répétera voix qu’une fois,
& 2.0 Y écho double ou multiple qui répète les mêmes
fons deux ou plufieurs fois.
Dans les échos fimples , il y en a de toniques, c’eft-
à-dife, qui ne répètent que le fon mufical & fou-
tenu ; & d’autres fyllabiques , qui répètent aufli la
voix parlante.
On peut tirer parti des échos multiples, pour
former des accords & de l’harmonie avec une feule
voix, en faifant entre la voix^ (k .l'écho une efpèce
de canon dont la mefure doit être réglée fur le temps
qui s’écoule entre les fons prononcés & les mêmes
fons répétés. Cette manière de faire .un cône3« à
foi tout feul, devroit, fi le chanteur étoit habile ,
& Y écho vigoureux, paroître étonnante & prefque
magique aux auditeurs non prévenus.
C ' Le nom d'écho fe tranfporte en mufique a ces fortes
d’airs, ou de pièces dans Iefquelles, a limitation de
Yé.ho , l’on répète-de temps en temps , & fort doux,
un certain nombre de notes. C ’eft fur 1 orgue qu on
emploie le plus communément cette manière de
jouer, à caufe de la facilite qu on a de faire des
échos fur le pofîtif; on peut faire aïïfli des échos fur
le clavecin , au moyen du petit clavier.
L’abbé Broffard dit qu’on fe fert quelquefois du
mot écho en la place de- celui de doux cù piano ,
pour marquer qu’il -faut adoucir la voix ou le fon de
rinflrument, comme pour, faire un écho. Cet.ufage
ne fubfifté plus. ( ƒ. ƒ. Rouffeau. )
Echo. Dans toutes les orgues tant foit peu confi-
dérableSjil y a un jeu d'écho & un clavier particulier
pour ce jeu. Le y.u YYecho contient, ordinairement u ti.
cornet de même taille, quelques flûtes, haut-bois,
clairons'/&c. ce je 1 imite Yécho, parce _qu’il^ eft enfermé
dans le buftèt de l’orgue. Le clavier n’a ordinairement
que 'deux- délaves.
Quelques faveurs enferment un cornet & fes ac-
compagaemens dans une petite armoire qui s’ouvre
pour faire le-rérit, & fe ferme pour (zire Vecho. Ç ’eft
une mativaife prarque. Si le cornet,eft de menue
taille, il fait mal le répit; s’il eft de groffe taille, il ne
convient point à l’écho ; d i moyenne taille, il ne
rend bien ni,l’un ni l’autre.