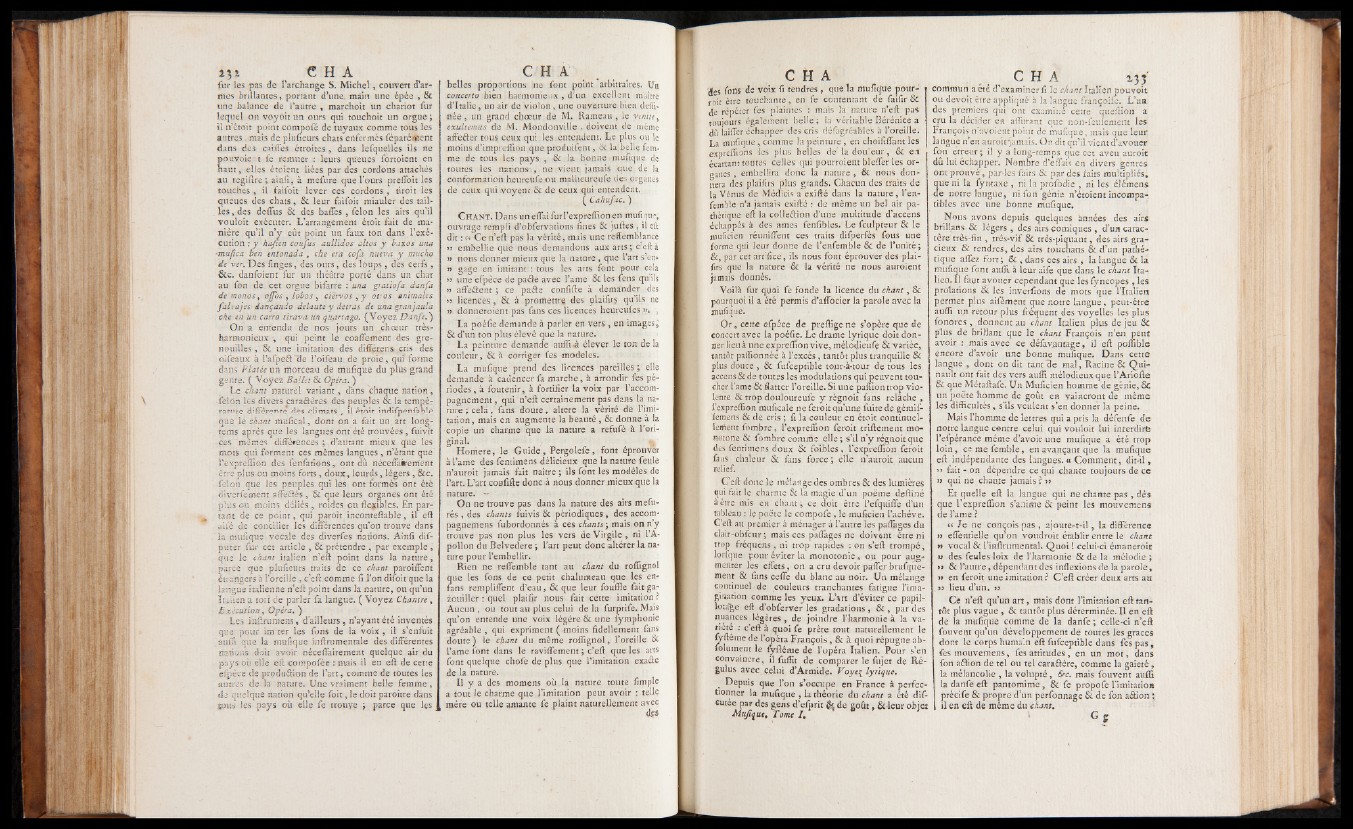
fur les pas de l’archange S. Michel , couvert d’armes
brillantes, ponant d’une, main une épée , &
une balance de l’autre , marchoit un chariot fur
lequel on voyoit un ours qui touchoit un orgue ;
il n’étoit point compofé de tuyaux comme tous les
autres.. mais de plusieurs chats enfermés féparéilsent
dans des cailles étroites, dans lefquelles ils ne
ouvoie-1 fe remuer : leurs qûeues fortoient en
aut, elles étoient liées par des cordons attachés
au regiftre ; ainii, à mefnre que l’ours preffoit les
touches , il faifoit lever ces cordons , tiroit les
queues des chats, & leur faifoit miauler des tail-
. les, des defîus & des baffes , félon les airs qu’il
vouloit exécuter. L ’arrangement étoit fait de manière
qu’il n’y eût point un faux ton dans l’exécution
: y haßen coiifus aullidos altos y baxos una
-mufîca ben entonada , ehe era cofa nueva y mucho
de ver. Des l ingesdes ours, des loups , des cerfs ,
& c . danfoient fur un théâtre porté dans un char
au fon de. cet orgue bifarre : una gratte fa dan fa
de monos, ojfos , lobos , ciervos , y ot-os animales
falvajes dançàndo delaute y detras de una gran jaula
. ehe en un carro tirava un quartago. (V oyez Danfe
On a entendu de nos jours lin choeur très-
harmonieux , qui peint le coaffement des grenouilles
, & une imitation des difféjtens. cris des
oifeaux à l’afpe<ft~3e l ’oifeau de proie, qui forme
dans Platée un morceau de mufique du plus grand
genre.’ ( Voyez Ballet & Opéra. )
Le chant naturel variant, dans chaque nation,
félon les divers caractères des peuples & la température
différente des climats , il étoit indifpenfàble
que le chant mufical, dont on a fait un art long-
tems après que les langues ont été trouvées, fuivît
ces mêmes différences; d’autant mieux que les
mots qui forment ces mêmes langues, n’étant que
Fexpreflion des fenfations, ont dû nécessairement
être plus ou moins forts, doux , lourds, légers, &c.
félon que les peuples qui les ont formés ont été
diverfement affeâés , & que leurs organes ont été
plus ou moins déliés , roides ou flexibles. En partant
de ce point, qui paroît inconteftable, il eft
ailé de concilier les différences qu’on trouve dans
la mufique vocale des diverfes nations. Ainfi dif-
puter fur cet article , & prétendre , par exemple ,
que le chant italien n’eft point dans la nature,
parce que plufieurs traits de ce chant paroiffent
étrangers à l’oreille , c’eff comme fi l’on difoit que la
langue italienne n’eft point dans la nature, ou qu’un
Italien a tort de parler fa langue. ( Voyez Chantre ,
Exécution y Opéra. )
Les inffruniens, d'ailleurs , n’ayant été inventés
que pour im ter les fons de la voix , il s’enfuit
suffi que la mufique inftru mentale des différentes
nations doit avoir, néceffairement quelque air du
pays où elle eft çompofée : mais il en eft de cette
efpèce de produétion de l’art, comme de toutes les
autres de la nature. Une vraiment belle femme ,
de quelque nation qu’elle foit, le doit paraître dans
les pays où elle fe trouye ; parce que les
C H A .
belles proportions ne font point arbitraires. Un
concerto bien harmonieux , d'un excellent maître
d’Italie, un air de violon, une ouverture bien deffi-
n é e , tîn grand choeur de M. Rameau , le venite,
exulternus de M. Mondonville , doivent de même
afte&er tous ceux qui les .entendent. Le plus ou le
moins d’impreffion que produifent, & la'belle femme
de tous les pays , & la bonne mufique de
toutes les nations., ne vient jamais que de la
conformation heureufe ou malheureufe desprganes
de ceux qui ,voyent & de ceux qui entendent.
( Cahufac. )
Chant. Dans mi:effaifurl’expreffionen mufique;
ouvrage rempli d-’obfervations fines & juftes , il eft
dit : et Ce n’eft pas la vérité, mais une refiemblancè
>3 embellie que nous demandons aux arts ; c’eft à
» nous donner mieux que la nature, que l’art s’en»
» gage en imitant : tous les arts font pour, cela
>3 une efpèce de paéle avec Famé & les fens qu’ils
» affeûent ; ce pa&e confifte à demander des
’»s licences, & à promettre des plaifirs qu’ils ne
» donneroient pas fans ces licences heureufes »t ,
La poéfie demande à parler en vers , en images;
& d’un ton plus élevé que la nature.
La peinture demande auffi sà élever le ton de la
couleur, & à corriger fes modèles.
La mufique prend des licences pareilles ; elle
demande à cadencer fa marche, à arrondir fes périodes
, à foutenir, à fortifier la voix par l’accompagnement,
qui n’eft certainement pas dans la nature
; ce la , fans doute, altéré la vérité de l’imitation
, mais en. augmente la beauté, & donne à la
copie un charme que la nature a refufé à l'original.
Homere, le Guide, Pergolefe, font éprouver
à Famé des fentimens délicieux que la nature feule
n’auroit jamais fait naître ; ils font les modèles de
Fart. L ’art confifte donc à nous donner mieux que la
nature.' '■**■ '
On ne trouve pas dans la nature des airs mefu-
rés , des chants fuivis & périodiques, des accom-
pagnemens fubordonnés à ces chants ; mais, on n’y
trouve pas non plus les vers de Virgile, ni l’A pollon
du Belvedere ; Fart peut donc altérer la nature
pour l’embellir.
Rien ne reffemble tant au chant du roffignel
que les fons de ce petit chalumeau que les en-
fans rempliffent d’eau, & que leur fouffle fait gazouiller
: quel plaifir nous fait cette imitation ?
Aucun , ou tout au plus celui de la furprife. Mais
qu’on entende une voix légère & une lymphome
agréable , qui expriment ( an oins fidellement fans
doute ) le chant du même roffignol, l’oreille &
Famé font dans le raviffement ; c’eft que les arts
font quelque chofe de plus que l’imitation exafte
de la nature.
Il y a des momens où.là nature toute fimple
a tout le charme que l’imitation peut avoir : telle
mère ou telle amante fe plaint naturellement avec
df S
des fons de voix lî tendres , que la mufiefue pour-
roit être touchante, en fe contentant de faifir &
de répéter fes plaintes mais la nature n’eft pas
toujours également belle ; la véritable Bérénice a
du laiffer échapper des cris défagréables à l’oreille.
La mufique, comme la peinture , en choififfant les
expreffions 'les plus belles de' la douleur, & o i
écartant toutes celles qui pourraient bleffer les organes
, embellira donc la nature , & nous donnera
des plaifirs plus grands. Chacun des traits de
la Vénus de Médicis a exifté dans la nature, Fen-
femble n’a jamais exifté : de même un bel air pathétique
eft la colleétion d’une multitude d’accens
échappés à des âmes fenfibles. Le fculpteur & le
muficien réunifient ces traits difperfés fous une
forme qui leur donne de l’enfemble & de Funité;
&, par cet arf fice, ils nous font éprouver des plaifirs
que la nature & la vérité ne nous auraient
jamais donnés.
Voilà fur quoi fe fonde la licence du chant, &
pourquoi il a été permis d’affocier la parole avec la
mufique.
O r , cette èfpéce de preftige ne s’opère que de
concert avec la poéfie. Le drame lyrique doit donner
lieu à une expreffion vive, mélodieufe & variée,
tantôt paffionnée à l’excès , tantôt plus tranquille &
plus douce, & fufceptible tour-à-tour de tous les
accens & de toutes les modulations qui peuvent toucher
l’ame & flatter l’oreille. Si une pamontrop violente
& trop douloureufe y régnoit fans relâche ,
l’expreffion rauficale ne feroit qu’une fuite de gémif-
femens & de cris ; fx la couleur en étoit continuel- '
leirient fombre, l’expreffion feroit triftement monotone
& fombre comnie elle ; s’il n’y régnoit que
des fentimens doux & foibles, l’expreffion feroit
fans chaleur & fans force; elle n’auroit aucun 1
relief.
C’eft donc le mélange des ombres & des lumières
qui fait le charme & la magie d’un poème dsftiné
à être mis en chant ; ce doit être Fefquiffe d’un
tableau : le poète le compofe , le muficien l’achève.
C’eft au premier à ménager à l’autre les pafijages du
clair-obfcur ; mais ces paffages ne doivent être ni
trop fréquens , ni trop rapides : on s’eft trompé,
lorfque pour éviter la monotonie, ou pour augmenter
les effets, on a cru devoir pifier brusquement
& fans ceffe du blanc au noir. Un mélange
continuel de couleurs tranchantes fatigue l’imagination
comme les yeux. L’art d’éviter ce papillotage
eft d’obferver les gradations , & , par des
nuances légères , de joindre l’harmonie à la va-
ri * ; c e^ ** <ïu0* Se prête tout naturellement le
lyftême de l’opéra François, & à quoi répugne ab-
folument le fyftêrae de l’opéra Italien. Pour s’en
convaincre, il fuffit de comparer le fujet de Ré-
gulus avec celui d’Armide. Voye\_ lyrique.
| Depuis que Fon s’occupe en France à perfectionner
la mufique , la théorie du chant a été discutée
par des gens d’efprit de goû t, & leur objet
Mufique* Tome /*
C H A w
commun a été d’examiner fi le chant Italien pouvoit
ou devoit être appliqué à la langue françoife. L’un
des premiers qui' ont examine cette queftion a
cyu la décider en affurant que noir-feulement les
François n'avoient point de mufique, mais que leur
langue n’en auroit jamais. On dit qu’il vient d’avouer
fon erreur; il y a long-temps que cet aveu auroit
dû lui échapper. Nombre d’eftais en divers genres
ont prouvé, par-les faits & par des faits multipliés,
que ni la fyntaxe , ni la profodie , ni les élémens
de notre langue, ni fon génie n’étoient incoaipa-,
tibles avec une bonne mufique.
Nous avons depuis quelques ànnées dès airs
brillans & légers, des airs comiques , d’un caractère
très-fin , très-yif & très-piquant, des airs gracieux
& tendres, des airs touchans & d’un pathétique
allez fort; Sc , dans ces airs , la langue & la
mufique font auffi à leur aife que dans le chant Italien.
Il faut avouer cependant que lesfyncopes , les
prolations Sl les inyerfions de mots que l’Italien
permet plus aifément que notre langue, peut-être
auffi un retour plus frequent des voyelles les plus
fonores , donnent au chant Italien plus de jeu &
plus de brillant que le chant François n’en peut
avoir : mais avec ce défavantage, il eft poffible
encore d’avoir une bonne mufique. Dans cette
langue , dont on dit ta.nt'de mal, Racine & Qui-
naul.t ont fait des vers auffi mélodieux que l’Ariofte
& que Métaftafe. Un Muficien homme de génie, &
un poète homme de goût en yaincront de même
les difficultés, s’ils veulent s’en donner la peine.
Mais l’homme de lettres qui a pris la défenfe de
notre langue contre celui qui vouloit lui interdite
l’efpérance même d’avoir une mufique a été trop
loin, ce me femble, en avançant que la mufique
eft indépendante des langues, a Comment, dit-il,
>3 fait - on dépendre ce qui chante toujours de çe
» qui ne chante jamais ? »
Et quelle eft la langue qui ne chante pas , dès
que l’exprefîion s’anime & peint les mouvement
de Famé ?
cc Je ne conçois pas , ajoute-t-il, la différence
» effentielle qu’on voudroit établir entre le chant
n vocal & l’inftrumental. Quoi 1 celui-ci émanerôit
» des feules loix de l’harmonie & de la mélodie ;
»s & l’autre, dépendant des inflexions de la parole,
» en feroit une imitation ? C eft créer deux arts au
J3 lieu d’un. 33
Ce n’eft qu’un a r t, mais dont l’imitation eft tantôt
plus vague , & tantôt plus déterminée. Il en eft
de îa mufique comme de la danfe ; celle-ci n’eft:
fouveqt qu’un développement de toutes les grâces
dont le corps humain eft fufceptible dans fes pas ,
fes mouvemens, fes attitudes , en un mot, dans
fon aélion de tel ou tel cara&ère, comme la gaieté,
la mélancolie , la volupté, &c. mais fouvent auffi
la danfe eft pantomime , & fe propofe l’imitatiou
précife & propre d’un perfonnage & de fon aâion
I il en eft de même du chant.
G 5