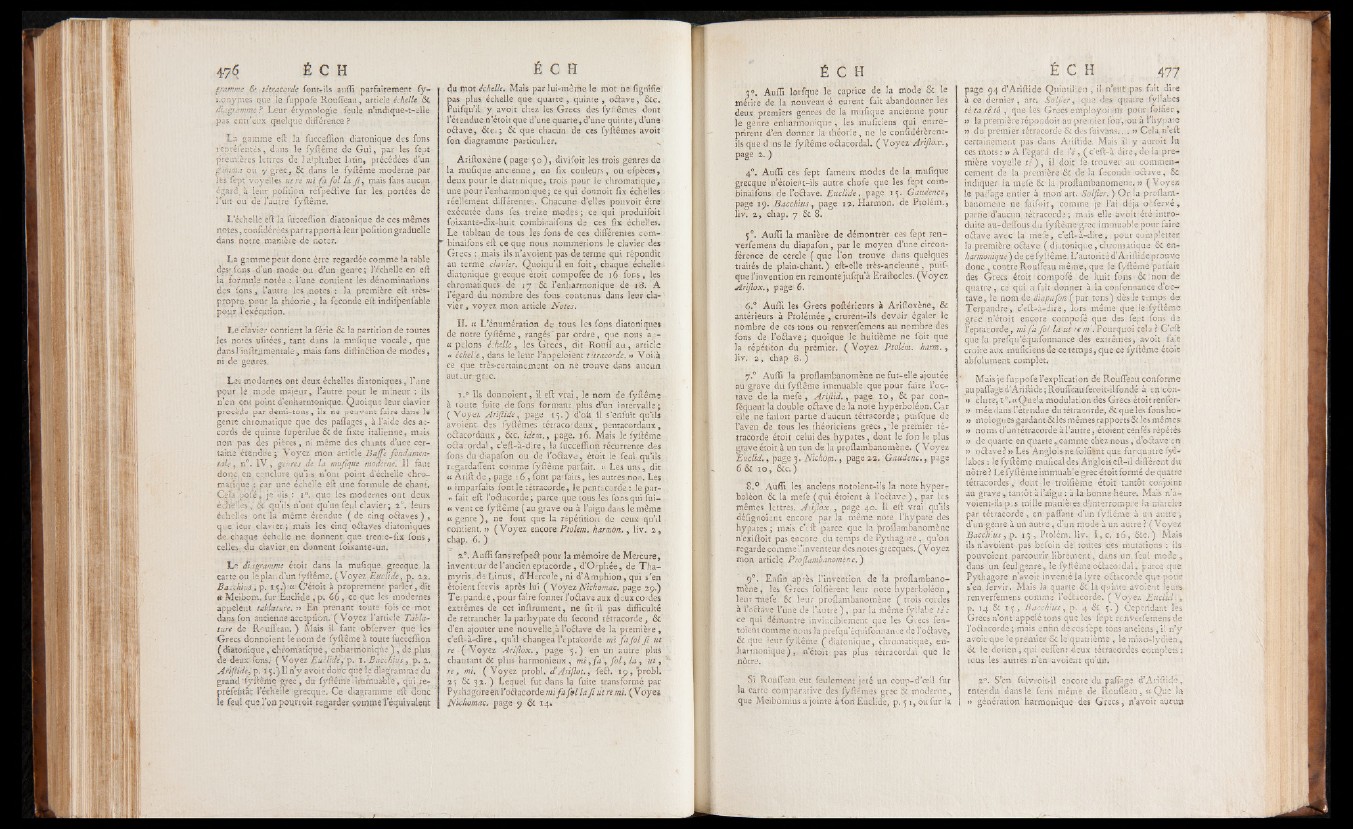
gramme & ■ tètracorde font*-ils aufli parfaitement fy -
t.onymes que le fuppofe Rouffeau, article échelle &
diagramme? Leur étymologie feule n’indique-t-elle
pas entr eux quelque différence ?
La gamme e fl. la fucceffion diatonique des fons
TepréfëRtès, dans le fyflême de Gui, par les . fept
premières kttr.es de l' alphabet latin, précédées d’un
g-i.mma ou y-grec, & dans le fyflême moderne par
Ifcs fept* voyelles ut rs mi fa fol la f i , mais fans aucun
égard, à leur pofition rèfpeéliye fur les portées de
l'un ou' de l’autre fyflême.
L’échelle ëftla fucceffion diatonique de ces mêmes
noîes, confidéréespar rapporta leur pofition graduelle
dans notre manier« de noter.
La gamme peut donc être regardée comme la table
des« fans çfun mo.de ou d'un • genre ; l’échelle en efl
la formule n o té e l'u n e contient les dénominations
des fpns, L’autre- le$;ùiotes: : la première efl très-
propre- pour la théorie , la fécondé efl. indifpenfable
poi^ l'exécution. •
Le'clavier contient la férié & la partition de toutes
les notes ufitées, tant dans la mufique vocale, que
dansrinflrpmentale, mais fans diffinélionde modes,
ni de ge&res.
Les moderne? ont deux échelles diatoniques, l’une
pour le mode majeur, l’autre pour le mineur : ils
n’en ont point d’enharmonique. Quoique leur clavier
procède par demi-tons, iis ne peuvent faire dans le
genre chromatique que des paffages, à-l’aide désaccords
de quinte fuperflue & de fixte italienne * mais
non pas des pièces, ni même des chants d’une certaine
étendue ; Voyez mon article Bajfe fondamentale.
, n°. I V , genres de la mufique moderne. 11 faut
donc, en, conclure qn’iis n’onr point d’échelle chro-
maf îquecar une échelle efl une formule de chant.
Cela poléj je dis : i°. que les modernes ont deux
échelles’,1 <k’ qui!s n’ont qu’un feul clavier; 2°. leurs
échelles ont la même étendue ( de cinq oélaves ) ,
que leur clavier ; mais les cinq oélaves diatoniques
de,chaque échelle ne donnent, que trente-fix fons,
celles, du clavier, en donnent foixante-ün.
lié diagramme étoit dans la mufique grecque la
carte ou le plan d’un fyflême. ( Voyez Euclide, p. 22.
Bac'chius.j p. 13.:)'« C’était à proprement parler , dit
«i Meihom. fur-Euclide , p. 66 , ce que les modernes
appelent tablature.» En prenant toute fois'ce mot
dans fon ancienne acception.'( Voyez l’article Tablature
de Rouffeau.. ) Mais i l faut obferver qué les
Grecs donnoicnt le nom de fyflême à toute fucceffion
( diatonique, chromatique, enharmohïcfùê ) , dé plus
de deux-fons.1 ( Voyez EuUidê, p. 1. Bacchius, p. 2.
Atiftidèi p. ï 5.3 II n’y avoit dohc que lé dïâgfamrne; du
grand -fyfleÉie - grec, du- fÿftêtfifei i i&muaffé , -qui re?.
préfehtât l’échelle grecque. Ce diagramme d l dbnc
le feul que l'on pourroit regarder ççmnie l'équivalent
du mot échelle. Mais par lui-même le mot ne fignlfie
pas plus échelle que quarte , quinte , oélave, Sec.
Puifqu’il, y avoit chez les, Grecs des fyûêmes dont
l’étendue n’étoit que d’une quarte, d’une quinte, d’une •
oélave, & e .; & que chacun de ces fyflêmes avoit
fon diagramme particulier.
Arifloxène ( page- 50 ), divifoit les trois genres de
la mufique ancienne, en fix couleurs, ou efpèces,
deux pour le diatonique, trois pour le chromatique,
une pour l’enharmonique; ce qui donnoit fix échelles
réellement différentes. Chacune d’ell.es pouvoit être-
exécutée dans fes, treize modes ; ce qui produifoit
foixante-dix-huit combinaifons de ces fix échelles.
Le tableau de tous les fons de ces différentes com-
r binaifons efl ce que nous nommerions le clavier des
Grecs : mais ils n’a voient pas de terme qui répondît
au terme clavier. Quoiqu’il en foit, chaque échelle ;
diatonique grecque étoit compofée de 16 fons, les
chromatiques - de 17 & l’enharmonique de 18. A
l’égard du nombre des fons contenus dans leur clavier
, voyez mon article Notes.
II. « L'énumération de tous les fons diatoniques
de notre fyflême, rangés'par ordre, que nous a
« pelons échelle, les Grecs, dit Rouff au , article
« échelle, dans le leur l’appeloient titracorde, » Voi.à
ce que très-certainement on ne trouve dans aucun
autiiir-'-grse.
i.° Ils donnoient, il efl vrai, le nom de fyflême
à toute fuite de fons formant plus d’un intervalle;
(V o y e z Arifiide, page 15.) d’où il s’enfuit qu’ils
avoient. des fyflêmes tétracordaux, pentacordaux,
oélacordàux , &c. idem., page. 16. Mais le fyflême
oélarordàl, c’efl-à-dire, la fucceffion récurrente des
fons du diapafon ou de l’oétave, étoit le feul qu’ils,
regardaient comme fyflême parfait. « Les uns, dit
« Arifiide, page 16 , font parfaits, les autres non. Les
« imparfaits font le tètracorde, le pentacorde : lepar-
« fait efl l’oélacorde ; parce que tous les fons qui fui-
« vent ce fyflême (au grave ou à l’aigu dans le même
« genre ) , ne font que la répétition de ceux qu’il
contient. » (Voyez encore Ptolem. harmon. , liv. 2 ,
chap. 6. )
20. Aufli fans refpeél pour la mémoire de Mercure,'
inventeur de l’ancien eptacorde, d’Orphée, de Tha-
myris. de Linus, d’Herciile, ni d’Amphion, qui s’en
étoient fervis après1 lui ( VoyezNichomac. page 29.)
Terpandre, pour faire fonner l’oélave aux deux coi des
extrêmes de cet infiniment, ne fit-il pas difficulté
de retrancher la parhypate du fécond tètracorde, &
d’en ajouter une nouvelle.à l’oétave de la première,
c’efl-à-dire , qu’il changea l’eptacorde mi fa fo l f i ut
re • ( "Voyez Arifiox., page 5. ) en un autre plus
chantant & plus harmonieux , mi ,fa \ fo l, la , u t ,
re, mi. ( Voyez probl. d'Ariflot., feél. 19 , 'probl.
' 25 .& 32. ) Lequel fut dans la fuite transformé par
Pythâgdreen l’oélacorde mi fa fol la f i dire mi. (Voyez
Nkhomaç. page 9 & 14.
3®. Aufli lorfque le caprice de la mode & le
mérite de la nouveau;« eurent fait abandonner les
deux premiers genres de la mufique ancienne pour
le genre enharmonique, les muficiens qui entreprirent
d’en donner la-théorie, ne le confidérèrem-
ils que dans le fyflême oélacordal. (V o y e z Arifiox.,
page 2. .)
40. Aufli cès fept fameux modes de la mufique
grecque n’écoient-ils autre chofe que les fept combinaifons
de l’oétave. Euclide, page 15* Gaudence,
page 19. Bacchius, page 12. Harmon. de Ptolém.,
liv. 2, chap. 7 & 8.
50. Aufli la manière de démontrer ces fept ren-
verfemens du diapafon G par le moyen d’une circonférence
de cercle ( que l’on trouve dans quelques
traités de plain-chant.) efl-elle très-ancienne, puîf-
que l’invention en remonte jufqu’à Eraflocles. (Voyez
Arifiox., page1 6.
6.° Aufli les Grecs poflérieurs à Arifloxène, &
antérieurs à Ptolémée , crurent-üs devoir égaler le
nombre de ces tons ou renverfemens au nombre des
fons de l’oélave; quoique le huitième ne foit que
la répétiton du premier. ( Voyez Ptolém. harm. ,
liv. 2, chap 8. ) '
7.0 Aufli la proflambanomène ne fut-elle ajoutée
au grave du fyflême immuable que pour faire l'octave
de la mefe, A r i f l i d page. 10 , & par con-.
féquent la double oéiave de la note hyperboléon. Car
elle ne faifoit partie d’aucun tètracorde ; puifque de
l’aveu de tous les théoriciens grecs , le premier té-
tracorde étoit celui des hypates, dont le fon le plus
grave étoit à un ton de la proflambanomène. (V oy e z
Euclid., page 3 . Nichotn., page 22. Gaudenc., page
6 & 10 , &c. )
8.° Aufli les anciens.notoient-i!s la note hyperboléon
& la mefe (qui étoient à l’oélave), par les
mêmes lettres, Arifiox, , page 40. Il efl vrai qu’ils
défignoient encore par la même note l’hypate des
hypates ; mais c’c.fl parce que la proflambanomène
n’exifloit pas encore du temps de Pythagpre, qu’on
■ regarde comme l’inventeur des notes grecques. (Voyez
inon article Proflambanomène. )
90. Enfin après l’invention de la prollambano-
mène, les Grecs foîfièrèht leur note hyperboléon,
leur *mèfe '&C leur proflambanomène ( trois cordes
à l’oélàve l’une de l’autre ) , par la même fyllabe te :
ce qui démontre invinciblement que les Grecs fen-
toient comme nous la prefqu’équifonnancq de l’oélave,
& que leur fyflême (diatonique, chromatique, en-'
harmonique ) , n’étoit pas plus tétracordal que le
.nôtre.
Si Rouffeau eut feulement jeté un coup-d’oeil fur
.la carte comparative des fyflêmes grec & moderne,
que Meibomius a jointe à fort Euclide, p. 5 1, ou fur la
page 94 d’Ariflide Quintilien, il n’eut >pas fait dite
à ce dernier, art. Solfie?, que des- quatre fyllabes
té ta te tô. , que les Grecs employoisnr pour foiner ,
» la première répondoit au premier fon,;où à l’hypate
du premier tètracorde & des fui van s . « Cela, n’eft
certainement pas dans Ariftide. Mais i! y aur.oit lu
ces mots : » A l’égard de i’é , ( c'efl-à dire, de la première
voyelle t é ) , il doit fe trouver au commencement
de la première & de la fécondé oélave, &
indiquer la mefe &• la proflambanomène. » (Voyez
le paiTage entier à mon art. Solfier. ) Or la proflam-
banomene ne faifoit, comme je l’ai déjà ohfervé ,
partie d’aucun tètracorde; mais elle avoit été:intro-
duite au-deflous du fyflême’grec immuable pour faire
oélave avec la mefe, c’efl-à-dire, pour çompletter
la première, oélave ( diatonique, chromatique & en-
harmonique) de ce fyfiême, L’autorité d’Ariffi.deprouve
donc , contre Rouffeau même, que le fyôêmé 'parfait
des Grecs étoit compofé de huit fons & :non dé
quatre ce qui a fait donner à la confonnance d’octave,
le nom àz.diapafon:(par tons) .dès le temps de-
Terpandre, c’efl-à-dire, lors même’ que le-.fyflêmé
grec n’étoit encore compofé que des fept fons de
L’eptacorde, mi fa fol là ut rem:. Pourquoi cela ? G’eff
que la prefqu’équifonnance des extrêmes, avoit fait
croire aux muficiens de ce temps, que ce fyflême étoit
abfolüment complet.-. ' .
Mais je fuppofe l’explication de Roiiffeaii conforme
au paffaged’Ariflide ; Rouffeau feroit-il fondé à encôn-
» dure, i°. «Que1.a modulation des Grecs étoitrenfer-
» mée dans l’étendue du tètracorde; & que les fons ho-
» molcgues gardant ôdés mêmes rapports St les mêmes
» noms d’un tètracorde à l ’autre, étoient cenfés répétés
5? de quarte en quarte „comme chez nous, d’oélave en
v oélave ? » Les Anglois nedolffsnt que fur quatre fyl-
labes : le fyflême mufical des Angloisefl-il différent du
nôtre ? Le fyflême immuable grec étoit formé de quatre
tètracorde^, dont.le troifième étoit tantôt conjoint
au grave, tantôt à l’aigu; à la bonne heure. Mais n’a-
voient-ils pas mille manières d’interrompre la marche
par tètracorde , en paffant d’iin fyflême à un autre,
d’un genre à un autre, d’un mode à un autre ? (Voyez
Bacchius, p. 13 , Ptolém. liv. I ,c. 16, & c .) Mais
ils n’avoient pas befoin de toutes ces mutations : ils.
pouvaient parcourir librement, dans un feul mode,
dans un feul.genre, le fyfiême oélacordal, parce que
Pythagore n’avoir inventé la lyre oélacorde que pour
s’en fervir. Mais la quarte & laq-ainte avoient leurs
renverfemens comme l’oélacorde. (V o y e z Euclid.: „
p. 14 & 15 , Bacchius, p. 4 & 5 .) Cependant les
Grecs n’ont appelé tons que les fept renverfemens de
l’oélacorde pmais enfin de ces fept tons anciens , il n’y
avoit que le premier & le quatrième , le mixo-lydien
Sl le do rien, qui euffent deux tétfàcordes complets 1
tous les autres n’en avoient qu’un.
2°. S’en fuivroitril encore du p.affage d’Ariflide ,
entendu- dans lé fens même de Rouffeau, « Que la
« génération harmonique des Grecs 3 n’avoit aucu»