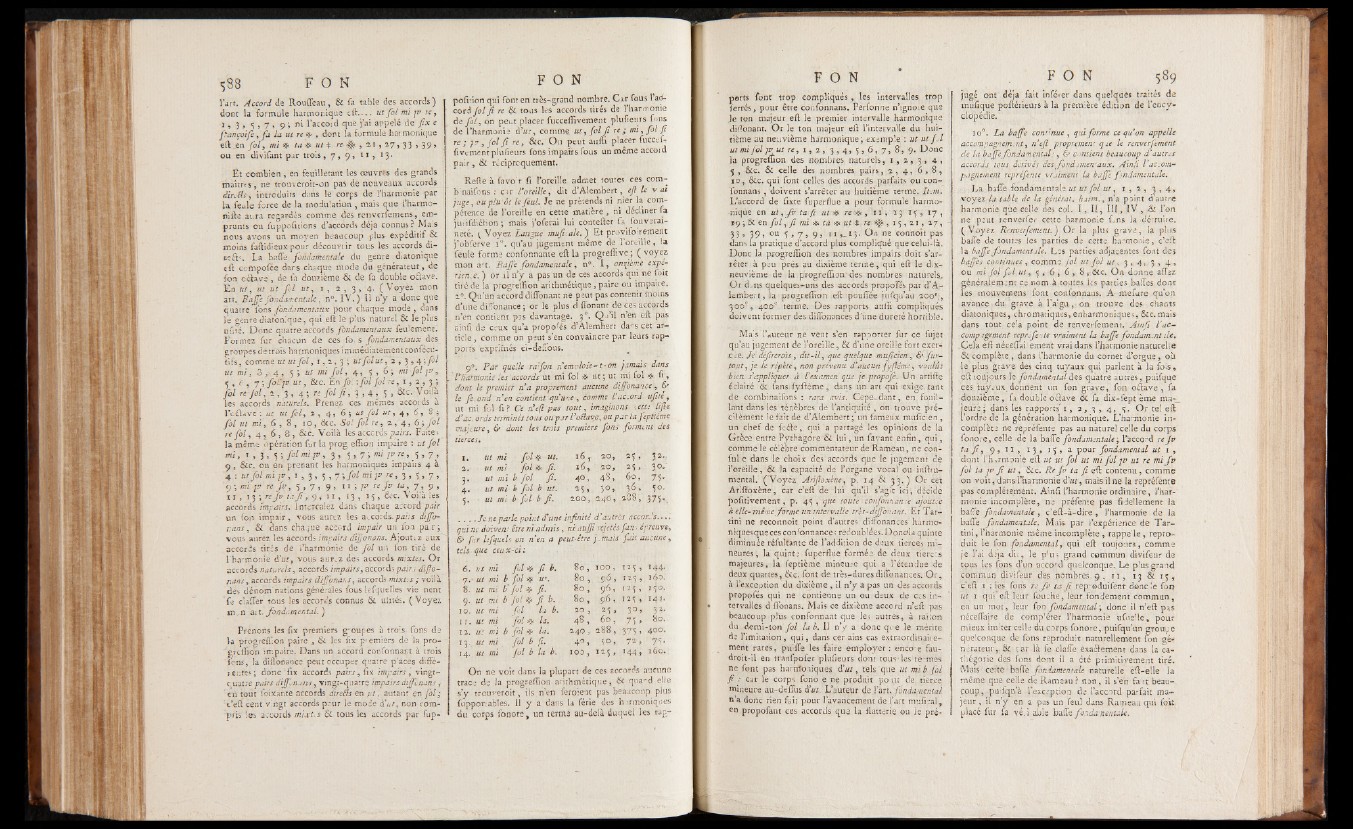
l’art. Accord de Rouffeau , & fa table des accords)
dont la formule harmonique eft— ut fol mi j v re,
1 , 3 , 5 » 7 » 9 * ni- l’accord que j’ai appelé de fix e
fiançai fie, fa la ut re # , dont la formule harmonique
eft „en f o l , mi & ta ❖ ut * re ^ 5 ^ 1 , 2 7 , 3 3 , 3 9 ,
ou en divifant par trois, 7 , 9 , 1 1 , 13.
Et combien, en feuilletant les oeuvres des grands
maîtres-, ne trouvèroit-on pas de nouveaux accords
dirMs, introduits dans le corps de l’harmonie par
la. feule force de la modulation , mais que i’harmo-
nifte aura regardés comme des renveriemens, emprunts
ou fuppofitions d’accords déjà connus ? Mais
nous avons un moyen beaucoup plus expéditif &
moins faftidieux pour découvrir tous les accords di-
f j j j j ï La baffe fondamentale du genre diatonique
eft ccmpofée dars chaque mode du générateur, de
fon céiavs , de fa douzième •& de fa double oétave.
En u t, ut ut fol u t, 1, 2 , 3 , 4 . ( V oyez mon
art. Baffe fondamentale, n°. IV .) 11 n’y a donc que
quatre ions fondamentaux pour chaque mode, dans
le genre diatonique, qui eft le plus naturel & le plus
unie. Donc quatre accords fondamentaux feulement.
Formez fur chacun de ces fo. s fondamentaux des
groupes detrois harmoniques immédiatement confécu-
tifs, comme ut ut fo l, 1 , 2 , 3 ; utf i t “G 2 , 3,4 > fol
ut m i, 3 É 4 , 5 ; ut mi fo l, 4 , 5 , 6 ; mi fo l jz>,
5 , '6 y 7 ; foCjv u t, &c. En fol \ f i l fol re, 1 , 2 , 3 -,
fo l r e fo l, 2, 3 , 4 ; re fo l f i , 3 , 4 , 5 , &c. V oil à
les accords naturels. Prenez ces mêmes accords à
l’c&ave : ut ut fo l, 2 , 4, 6 ; ut fo l u t, 4 , 6 , 8 ;
fo l ut mi', 6 , 8 , 10, &c. Sol fol re, 2, 4, 6; fo l
re fol , 4 , 6 , 8 , &c. Voilà les accords pairs. Faites
la même opération fur la prog effion impaire : ut fo l
mi, T , 3 , 5 ; fo l mi jp, 3 , 5 , 7 ; mi jv re, 5 , 7 ,
9 , &c. ou en prenant les harmoniques impairs 4 à
4 : ht f i l mi j py i , 3 , 5 , 7 ; fo l mi jp re, 3 , 5 , 7 ,
‘9 ; mi jv re J v , 5 , 7 , 9 , 11 ; jp re J p ta, 7, 9,
11 , 13 ; ré Jv ta f ' , ’ 9 ; 11 , 13 , 15 , &c. Voilà les
accords impairs. Intercalez dans chaque accord pair
un fon impaix, vous aurez les accords .pans dijfo-
nans", & dans chaque accord impair un ioa pair;
vous aurez les accords impairs dïfjonans. Ajoutez aux
accords tires de i’harmonie de fol un fon tiré de
1 harmonie d’ut, vous aurez des accords mixtes. Or
accords naturels, accords impairs, accords pairi diforions
, accords impairs diffonans, accords mixtes ; voilà
des dénomnations générales fous lefquelles vie nent
fe claffer tous les accords connus & ulités. ( Voyez
m„n ait. fondamental. )
Prenons les fix premiers g'oupes à trois fons de
la progrefiion paire , & les fix p-entiers de la pro-
grcllion impaire. Dans un accord confonnart à trois
Ions, la diflonance peut occuper quatre p'aces diffé-
j entes; donc fix accords pairs, fix impairs ', vingt-
cuatre pairs dijfinans, vingt-quatre impairs difinans
' en tout foixante accords direfis en ut ; autant en fol;
t ’eft cent vingt accords peur le mode d’ut,, non compris
les accords mixt.s & tous les accords par fuppofition
qui font en très-grand nombre. Car fous Fad-
cord fol f i re & tous les accords tirés de l'harmonie
de fo l, on peut placer fucceflivement plufieurs fons
de l’harmonie d’ut, comme ut, fol f i re ; mi, fol f i
re ; jp , fo l f i re, &c. O11 peut aufli placer fucceff
fivement plufieurs fons impairs fous un même accord
pair, & réciproquement.
Refie à favo r fi l’oreille admet toutes ces com-
b:naifôns : car l’oreille, dit d'Alembert, efl le v ai
juge, ou pluot le fieul. Je ne prétends ni nier la compétence
de l’oreille en cette matière, ni décliner fa
juiifdiélion ; mais j’oferai lui contefter fa fouverai-
neté. ^ Voyez Langue mufkale. ) Et provifo'.rement
j’obferve i° . qu’au jugement même de 1 oreille, la
feule forme confonnante eft la progreflive; (voyez
mon art. Baffe fondamentale, n°. I , onzième expe-
rien.e. ) or il n’y a pas un de ces accords qui ne foie
tiré de la progrefiion arithmétique, paire ou impaire.
2°. Qu’un accord diffonant ne peut pas contenir moins
d’une diffonance; or le plus diffonant de ces accords
n’en contient pas davantage. 30. Qu’il n’en eft pas
ainfi de ceux qu’a proposés d’Alembert daos cet article,
comme on peut s’en convaincre par leurs rapports
exprimés ci-defi’ous.
90. Par quelle rai fon nemploie-1-on jamais dans
VKàrrhonie les accords ut mi fol ❖ ut ; ut mi fol # fi »
dont le premier n a proprement aucune diffonance, 6*
le fe.ond n en contient' quun e , comme L'accord ufite,
ut mi fol fi? Ce n9 efl pas tout, imaginons cette lifte
d’ac. ords terminés tous oupar l ’oêlaye, ou par la fepti'eme
ma<cure, d* dont Ut trois premiers fins forment des
tierces.
ht mi fo l * ut. 1 6 , 20, *5 > 31.
ut ml fol *. 1 x6, 20, 30.
ut mi b fo l 1 40, 48, 60, ■75-
ut mi b fo l b ut. * 5», 3°> 36, 50.
ut mi b f i l b fi- 200, ■ 240, a38, 375-
. . . .Je ne parle point (Lune infinité d’autres accords....
qui ne doivent être ni admis, ni'auffi rejetés fane épreuve,
& fur Ufquels pn n’en a peut-être jamais fait aucune,
tels que ceux-ci :
6. ut mi fol ❖ fi b. 80, IOO , 144.
7.'• ut mi b f i l ❖ ur 80 , , .9fi ’ ' 75.
8. ut mi b fol ❖ fi- 80 , 96, £§g. 150.
9- ut mi b fol ❖ fi b. I 80, 9 6 , 125 . 14.1.
10. ut rni 'f il U b. 20 , 25 . 3° . 3?-
1 j. ut mi ■ fol ❖ la 48, 60, 75. 80,
12. ut mi b fol ❖ U 240, 188, 375 > 400.
p | ut mi . j ü b fi40,
yO, 7* . 7 fi14.
ut mi f i l b la b. IOÔ, l i s , ' 44. lé 0.
On ne voit dans la plupart de ces accords aucune
trace de la progrefiion arithmétique ■, & qua~d elle
s’y trouverait, ils n’en feroient pas beaucoup plus
fupponables. Il y a dans la férié des harmoniques
du corps fonore, un termé au-delà duquel les rapports
font trop compliqués , les intervalles trop
ferrés, pour être confonnans. Perfonne n’ignote que
Je ton majeur eft le premier intervalle harmonique
diffonant. Or le ton majeur eft l’intervalle du huitième
au neuvième harmonique;-exemple : ut ut f i l
ut mi fol jv ut re, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9. Donc
la progrefiion des nombres naturels, 1 , 2 , 3., 4 ,
5 , &c. & celle des nombres, pairs, 2 , 4 , 6 , 8 ,
10 , &c. qui font celles des accords parfaits ou confonnans
, doivent s’arrêter au huitième terme. Item.
L’accord de fixte fuperdue a pour formule harmonique
en ut, Jv ta,fi ut # r e , 1 1 , 13* 1 5 , 1 7 , 119 ; & en fo l, f i mi & ta & ut 4 re , 1 5 , 2 1 , 27,
33, 39, ou 5 , 7 , 9 , n ^13. On ne connoît pas
dans la pratique d’accord plus compliqué que celui-là.
Donc la progrefiion des nombres impairs doit s’arrêter
à peu près au dixième terme, qui eft'le dix-r
neuvième de la progreffion" des nombres- naturels.
Or d.ns quelques-uns des accords propoîes par d’Alembert
, la progrefiion eft ’pouffée jufqu’au 200e],
300“ , 400e terme. Des rapports aufii compliqués
doivent former des diffonancés d ’une dureté horrible.
Ma s l’auteur ne veut s’en rapporter fur ce fujet
qu’au jugement de l’oreille, & d’une oreille fort exer4
,cee. Je déférerais, dit-il, que quelque muficien, & fur-
tout, je le répète., non prévenu, d’aucun fyftême-, voulut
bien s’appliquer à l ’examen que je propofe. Un artifte
éclairé ik fans-fyftême, dans -tin art qui «exige.tant
de combinaifçns : rara avis. Cependant, en fo.uil-
lant dans les ténèbres de l’antiquité , on trouve pré-
cifément le fait de d’Alembert; un fameux muficien ,
un chef de feéïe, qui a partagé les opinions de la
Grèce entre Pytbagore & lui, un fayant enfin, qui,
comme le célèbre commentateur de Rameau, ne con-
ful e dans le choix des accords que le jugement de
l’oreille, & la capacité de l’orgahe vocal ou inftrü-
mental. ('Voyez Arifloxène, p. 14 & 33.) Or cet
Ariftoxène, car c’èft de lui qu’il s’agit ici, décide
pofitivement, p. 45 , que toute confonnante ajoutée
à elle-même forme un intervalle très-diffonant. Et Tar-
tini ne reconnoît point d’autres diffonancés harmo-
niquesqueces conronnance> redoublées. Dondla quinte
diminuée réfui tante de l’addition dé deux tiercés mineures,
la quinte fuperflue formée de deux tierces
majeures, la feptième mineure qui a l’étendue de
deux quartes, &c. font de trèsrdures diffonancés. O r ,
à l’exception du dixième , il n’y a pas un des accords
propofés qui ne contienne un ou deux de c-:s intervalles
d ffonans. Mais ce dixième accord n’eft pas
beaucoup plus confonnant que les autres, à raiîon
du demi-ton fo l la b. il n’y a donc que le mérite
de l'imitation, qui, dans cer.ains cas extraordinairement
rares, pulffe les faire employer: encoe fau-
droit-il en tranfpofer plufieurs dont tousses te mes
ne font pas harrrfoniques d’u t , tels que ut mi b fol
f i : car le corps fono e ne produit po lit de. tierce,
mineure au-deffus d’ut. L’auteur de l’art, fondamental
n’a donc rien fait pour l'avancement de l’art mufical,
en propofant ces accords que la flatterie ou le préjugé
ont déjà fait inférer dans quelques traités de
mufique poftérieurs à la première édition de l'encyclopédie.
10°. La baffe continue , qui forme ce quon appelle
accompagnement, n’efl proprement que le renverfement
de la baffe fondamentalc, & contient beaucoup d’autres
accords tous dérivés des fondumen'aux. Ainfi l ’accompagnement
repréfente vraiment la baffe fondamentale.
La baffe fondamentale ut ut f i l u t , 1 , 2 , 3 , 4 ,
voyez la table de la générât, hirtn., n’a point d’autre
harmonie, que celle des col. I I I , III., IV , & l’on
ne peut renverfer cetfe harmonie Gns la détruire.
(V o y e z Renverfement.) Or la plus grave, la plus
baffe de toutes les parties de cette harmonie, c’eft
la baffe fondamentale. Les parties adjacentes font des
baffes, continues , comme jol ut f i l u t, 3 , 4, 3 , 4 ,
ou mi f i l f i l u t, 5 , 6 j 6 , 8 ,-;&c. On donne allez
généra.leip:nt ce nom à toutes, les parties baffes dont
les, mouvemens font confo,nnans. A mefure qu’on
avance. dff grave à l’aigu , on trouve des chants
diatoniques, chromatiques, enharmoniques, &c. mais
dans tout cela point de renverfement, Ainfi Vac-
compigement repréfente vraiment la baffe fondamentale.
Cela eft néceffai. ement vrai dans l’harmonie naturelle
& complète , dans l’harmonie du cornet d’orgue, oit
le plus grave, des cinq tuyaux qui parlent à la fois,
eft toujours 1 ç fondamental des quatre autres, paifque
çeX.tu-y^ux donnent un fon grave, fon beiave , fa
douzième, fa double olftave Si. fa dix-fept ème majeure
; dans les rapports" 1 , 2 , 3 , 4 , 5- tel
l’ordré de la génération harmonique. L’harmonie incomplète
ne repréfente pas au naturel celle du corps
fonore, celle de la baffe fondamentale ; l’accord rejv
ta f i , 9 , 1 1 , 1 3 , 15 , a pour fondamental ut 1 ,
do,nt 1 h »rmonie eft ut ut fol ut mi fol jv ut re mi Jv
fol ta jv f i ut, &c. Re Jv ta f i eft contenu, comme
on voit, dans l’harmonie d’ut, mais il ne la repréfente
pas complètement. Ainfi l’harmonie ordinaire, l’harmonie
incomplète, ne préfente pas fidellement la
baffe fondamentale , c’eft-à-dire , l’harmonie de la
baffe fondamentale. Mats par l’expérience de Tar-
tini, l’harmonie même incomplète, rappéle, reproduit
le fon fondamental, qui eft toujours, comme
je l’ai déjà die, le pftis grand commun divifeur de
tous les fons d’un accord quelconque. Le plus grand
commun divifeur des nombres.9 , i® 13 & 15 ,
ceïl 1 : jès fons re f o ta f i rep'oduifent donc le fon
ut 1 qui eft leur fourbe, leur fondement commun,
en un mot, leur ton fondamental-, donc il n’eft pas
néceffaire de comp'éter l’harmonie ufue'.le, pour
mieux imiter celle du corps fonore, puifqu’un groupe
quelconque de fons reproduit naturellement ton générateur
,,&• çiar là fe claffe èxaéiement dans la ca-
thégorie des fons dont il a été primitivement tiré.
Mais .cette baffe fondamentale naturelle eft-elle la
même que celle de Rameau ? non, il s’en fa rt beaucoup,
pu-fqu’à l’exception de l’accord parfait majeur
, il n’y en a pas un feul dans Rameau qui foit
placé fur fa yé. fiable baffe fondamentale.