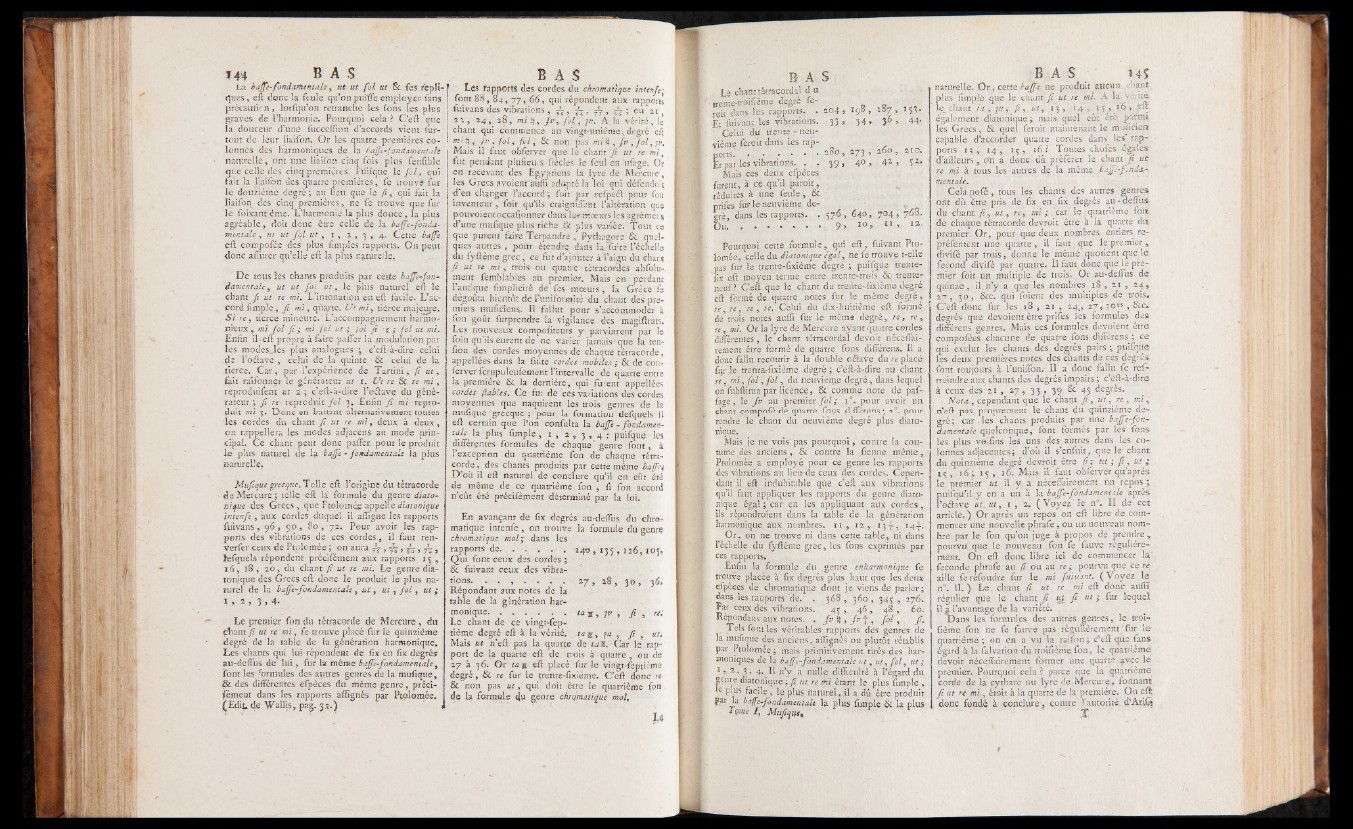
1 4 4 B A S
La baffe-fondamentale, ut ut fo l ut & fes répliqués
, eft donc la feule qu’on puifle employer fans
précauticn, lorfqu’on retranche les fons les plus
graves de l’harmonie. Pourquoi cela ? C’eft que
la. douceur d'une fucceflîon d’accords vient fur-
tout de leur liaifon. Or les quatre premières colonnes
des harmoniques de la baffe-fondamentale
naturelle, ont une liaifon cinq fois plus fenfible
que celle des cinq premières. Puifque le f o l , qui
fait la liaifon des quatre premières, fe trouve fur
le douzième degré; au lieu que le f i , qui fait la
liaifon des cinq premières, ne fe trouve que fur
le foixantiême. L’harmonie la plus douce, la plus
agréable, doit donc être celle de la baffe-fonda-
mentale , ut ut f o l t it , i , 2 , 3 , 4. Cette baffe
eft compofée des plus Amples rapports. Qn peyt
donc afiùrer qy’ellç: eft la plus naturelle,
De to\is les chants produits par cetfe baffe-fondamentale
, ut ut fol u t le plus naturel. eft le
chant fi ut re mi. L’intonation en eft facile. L*ac- 1
çord fimple, f i mi, qùarte. Ut mi, tierce majeure.
S i re, tierce mineure.'L’accompagnement harmo- 1
piteux, mi fo l f i ; mi .fol ut ; fol f i ;e ; fo l ut mi. !
Enfin il-eft propre à faire pafier la modulation par
les modesties plus analogues ; c’eft-à-dire celui
.de l’oéiave , celui de la quinte & celui dé la
tierce. Car, par l’expérience de Tartini, fi ut,
fait raifonner le générateur ut 1. Ut re & re mi,
reproduifent ut 2 ; c’eft-à-dire l’o&ave du générateur
; f i re reproduit fo l 3 .. Enfin f i mi reproduit
mi 5. Donc en battant alternativement toutes
les cordes du chant f i ut re. mi, deux à deux,
on rappellera les modes adjacens au mode principal.
Ce chant peut donc .paffer. pout le produit
le plus naturel de la baffe- fondamental: la plus
naturelle.
Mufique grec que. T elle eft l’origine du tétracorde
de Mercure ; telle eft là formule du genre diatonique
des Grecs, que Ptolomée appelle diatonique
intenfie, aux cordes duquel il aftigne les rapports
fuivans, 96, 90, 80, •72. Pour avoir les rapports
des vibrations de ces cordes, il faut ren-
Verfer ceux de Ptolomée ; on aura
lefquels répondent précifément aux rapports 15 ,
1 6 , 18, 20, du chant fi ut re mi. Le genre diatonique
des Grecs eft donc le produit le plus naturel
de la b affe-fon dament ale, u t , u t , J'ol, ut ;
1 , 2 , 3 , 4 .
Le premier fon du tétracorde de "Mercure , du
chant f i ut re mi, fe trouve placé fur le quinzième
degré de la table de fa génération harmonique.
Les chants qui lui répondent de fix en fix degrés*
au-deflus de lu i, fur la même baffe-fondamentale ,
font les formules des autres genres de la mufique,
& des différentes efpèces du même genre, précisément
dans les rapports afîignés par Ptolomée.
(Eçül de Wallis, pag. 3 2 .) -
B A S
1 Les Rapports des cordes du chromatique intcnfc'y
font 88, 8 4 , 7 7 , 6 6 , qui répondent aux rapports
fuivans des vib rations , ~ , ^ , 7 7 , ou 21
2 2 , '2 4 , 2 8 , mi U, J v , fo l , jp. A la v é r ité , le
chant qui commence au vingt-uniêmeN degré eft
tnif f , fv , fo l, fo l, & non pas mi# , Jv , fo l, ju.
Mais il faut obferver que le chant f i ut re mi,
fut pendant plyficurs fîècles le feul en ufage. Or
en recevant des Egyptiens la lyre de Mercure,
les Gre cs avoient aufli adopté la loi qui défendoi*
d’en changer l’ac cord ; foit par.refpeét pour fou
in v en teu r , foit qu’ils craigniflent l’altération que
pouvoientoççafionner dans les moeurs les agrémerq
d’une mufique plus riche & plus varice. T o u t ce
que purent faire Terpandre , Pythagore & quelques
autres , 'pour étendre dans la/ftfte l’échelle
du fyftême g r e c , ce fut d’ajouter à l’aigu du chant
f i ut re mi, trois; ou quatré tètracordqs abfolu-,
ment femblables au premier. Mais en perdant
l’antique fimpliciré dé fes m oe u r s , la G rè ce Le
dégoûta bientôt de l ’uniformité du chant des premiers
muficiens. Il fallut pour s’accommoder à
fon goût furprendre la vigilance des magiftrats.
Les nouveaux composteurs y parvinrent par le
foin qu ils eurent de n e varier jamais-' que la ten-
fion des Cordes moyennes de chaque tétracorde,
appellées dans la fuite cordes m o b ile s& de con-
feryer fcrupuleufement l’intervalle de quarte entre
la première & la dernière, qui furent appellées
cordes fiables. C e fut de ces variations des cordes
moyennes que naquirent les trois genres de la
mufique grecque ; pour la formation defquels il
eft certain que l’on confulta baffe - fondamentale
la plus fimple , 1 , 2 , 3 , 4 : puifque les
différentes formules de chaque" genre fo n t , à
l’exception du quatrième fon de chaque tétra-
co rd é , des chants produits par cette même baffe]
D ’où il eft naturel de conclure qu’il en eût été
de même de ce quatrième fon , fi fon accord
n’eût été précifément déterminé par la lo i.
En avançant de fix degrés au-deffus du chr<*
matique in ten fe , on trouve la formule du genre
chromatique mol y dans les
rapports de......................... ...... 1 4 0 , 1 3 5 , 1 2 6 , 1 0 5 ,
Q u i font ceux des cordes ;
&. fuiyant ceux des vibrations.
2 7 , 28 , 30 , 36*'
Répondant aux notes de la
table de la génération harmonique.
. . . . • . ta %, jv , f i , rt :
L e chant de ce vingt-feptième
degré eft à la vérité. ta%, ja , f i ut.
Mais ut h’eft pas la quarte de taie. Ca r le rapport
de la quarte eft de trois à quatre , ou de
27 à 36. O r ta g eft placé fur le vingt-feptième
d e g ré , & re fur le trente-fixième. C ’eft donc re
8c non pas u t , qui doit être le quatrième fon
de la formule du genre chrqmatique mol,
U
Le eliant tétracordal d u
trente-troifième degré feroit
dans lés rapports. . 1 0 4 . 190 ,
Et fuivant les vibrations. 33 > 3 4 .
Celui- du tiente -n e u -
vième féroit dans les rapports.
• • ; • • - 4 8 o > 5 7 3 .
Et par les vibrations. . . 399 4 ° >
' Mais ces deux efpèces
furent, à ce qu’il p a ra ît ,
réduites à une fe u le , & -
prifes fur le-neuvième, degré,
dans les rapports. . $ 7 6 , 640,
Du...................................................... 10 »
18 7 ,. 153-
36 4 4 *
2 60 , 210.
4 2 , 52,
7 0 4 , 768.
1 1 , 12.
Pourquoi cette form u le, qui e f t , fuivant Ptolomée,
celle du diatonique égal, ne fe trouve-t-elle
pas fur le trente-fixième degré ; puifque trente-
f a eft moyen terme entre .trente-trois &■ trente-
neuf? C ’eft que le chant du trente-fixième degré
eft formé de quatre notes fur. le même degré ,
re, re, re, re. Ce lu i du dix-huitième eft formé
de trois notes aufli fur le même de g ré, re, re,
re, mi. Or la lyre de Mercure ayant quatre cordes
différentes, ie chant tétracordal devoit néceffai-
rement être formé de quatre fons différens. Il a
donc fallu recourir à la double o&ave du re placé-
fur le trentarfixième degré ; c’eft-à-dire au chant
re, ml, fo l, f o l , du neuvienje de g ré, dans lequel
on fubftitua par licen ce , & comme note de paf-
fage, le fv ait premier f o l ; i ° . pour avoir un
chant compofé de quatre fons différens ; 20. pour
rendre le chant du neuvième degré plus diatonique.
Mais je ne vo is pas p ou rqu o i, contre la coutume
des anciens, & contre la fienne m êm e,
Ptolomée a employé pour ce genre les rapports
des vibrations, au lieu de ceux des cordes. Cependant
il. eft indubitable que c’eft aux vibrations
qu’il faut appliquer les rapports du genre diatonique
égal ; car en les appliquant aux co rd e s ,
ils répondraient dans la table de la génération
harmonique aux nombres. 1 1 , 1 2 , 13 , 1 4 A...
O r , on ne trouve ni dans cette tab le, ni dans
l’échelle du fyftême g re c , les fons exprimés par
ces rapports*
Enfin la formule du genre enharmonique fe
trouve placée à fix degrés plus haut que les deux
efpèces de chromatique dont je viens de parler ;
dans les rapports (le. . 368 , 360 , 345 , 276.
Par ceux des vibrations. 45 , 4 6 , 48 , 60.
Répondans aux notes. . f v § , Jv f , f o l , fi.
T els font les véritables rapports des genres de
la mufique des anciens, afîignés ou plutôt rétablis
par Ptolomée; mais primitivement tirés des harmoniques
de la bafffond amentale u t , ut, fo l, u'(J
1 ? 2 , 3 , 4. Tl n’y a nulle difficulté à l’égard du
genre diatonique ; f i ut re mi étant le plus fimple ,
le plus fa c i le , le plus naturel, il a dû être produit
Çar la baffe-fondamentale la plus fimple & la plus
Tçme I f Mufiqiie,
naturelle. O r , cette baffe ne produit aucun chant,
plus fimple que le chant.y? ut re mi. A la v-rite.
le_ chant ta 4 jv , f i , ut, 13 , 1 4 , 15 , 16 , ,eft
également diatonique ; mais quel eût été parmi
les G re c s , & quel ferait maintenant le muficien
capable d’accorder quatre cordes dans les' rapports
1 3 , 1 4 , 1 5 , 16 ?. Toutes chofes égales-
d’a illeu r s, OU a donc dû préférer le chant f i ut
re mi à tous les autres de la même b.ff-fondamentale.
C e la p o f é , tous les chants des autres genres
ont dû être pris de fix en fix degrés a u -d e f lu s
du chant, f i , u t , re, mi ; car. le quatrième fonde
chaque tétracorde devrait être à la quarte du
premier. O r , pour que deux nombres entiers re-
préfentent une qua rte, il faut que le premier,.
divifé par tro is, donne le même quotient que le
fécond divifé par quatre. Il faut donc que le premier
foit un multiple de trois. O r au-deffus de
q u in ze , il n’y a que les nombres 1 8 , 21 , 24,
2 7 , 3 0 , & c . qui foient des multiples de trois*
C ’eft donc fur les 18 , 21 , 24,, 2 7 ,3 0 e s , &c*
degrés que dévoient être prifes les formules des
différens genres. -Mais ces formules dévoient être
compofées. chacune de quatre fons différens ; c e
qui exclut les cjiants\ des degrés pairs ; puifque
les deux premières notes des chants de ces degrés
font toujours à l’uniflbn.' Il a donc fallu fe ref-
treindre aux chants des degrés impairs; c’eft-à-dire
à ceux des 21 , 27 , 3 3 , 39 & 45 degrés.
Nota , cependant que le charjt f i , ü t, re , mi;
n’eft pas. proprement le chant du quinzième degré;
car les chants produits par une baffe-fondamentale
quelconque, font formés par les fons
les plus veifms les uns des autres dans les colonnes
adjacentes ; d’où il s’enfuit, que le- chant
du quinzième degré devrait être f i j ut ; f i , ut 1
15 , 16 ; 15 , 16. Mais il faut obferver qu’après
le premier ut il y a néceffairement un repos i
puifqu’il y en a un à la baffe-fondamentale après
l’o&ave ut. ut, 1 , 2. (V o y e z T e n°. II de cet
article. ) Or après un repos on eft libre de commencer
une nouvelle phrafe, ou un nouveau nombre
par le fon qu’on juge à/'propos de prendre ,
pourvu que le nouveau fon fe fauve régulièrement.
On eft donc libre ici de commencer la
fécondé phrafe au fz ou au re ÿ pourvu que ce re
aille fe réfoudre fur le mi fuivant. (V o y e z le
n°," II. ) Le chant f i ut re mi eft donc aufli
régulier que le chant f i ut f i ut ; fur lequel
il a l’avantage de la variété.
Dan s les formules des autrès g en re s, le troi-
flème fon ne fe fauve pas régulièrement fur le
quatrième ; on en a vu la rai fon ; c’ eft. que fans
égard à la falvation du troifième fo n , le quatrième
devoit néceffairement former une quarte avec le
premier. Pourquoi cela ? parce que la quatrième
corde de la cythare ou lyre de M ercu re, formant
f i ut re mi, ètoit à la quarte de la première. Qn eft;
donc fondé à co n c lu re , contre l’autorité d’A r i^