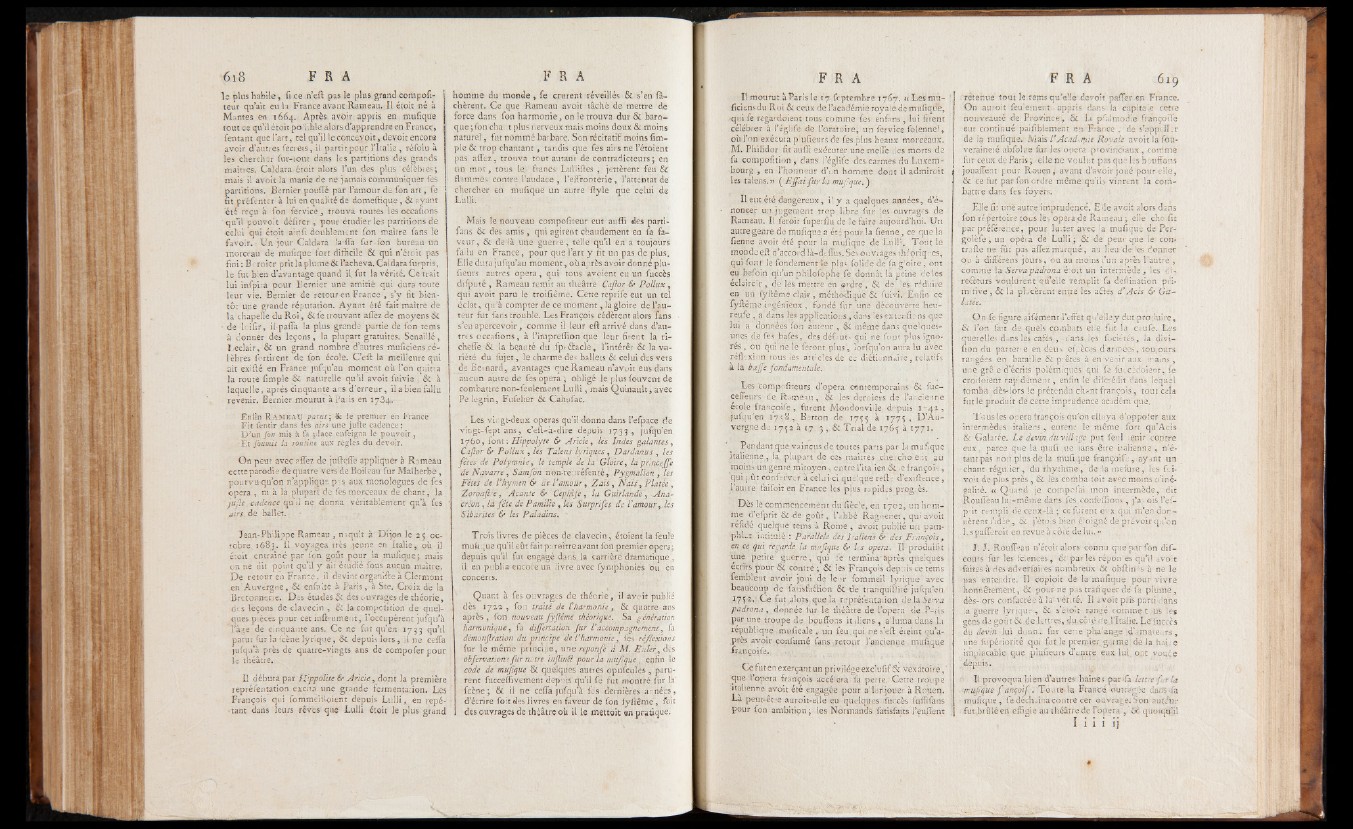
le plus habile, fi ce neft pas le plus grand compofi-
teur qu’ait eu la France ayant Rameau. Il étoit né à
Mantes en 1664. Après avoir appris en mufique
tout ce qu’il étoit poüihle alors d’apprendre en France,
fentant que l’art, tel qu’il leconcevoit, devoit encore
avoir d’autres fecrets, il partit pour l’Italie , réfolu à
les chercher fur-tout dans les partitions des grands
maîtres. Caldara étoit alors l’un des plus célèbres;
mais il avoit la manie de ne jamais communiquer fes
partitions. Bernier pouffé par l’amour de fon art, fe
fit préfente r à lui en qualité de domeftique, & ayant
été reçu à fon fer vice, trouva toutes les occafions
qu’ii pouvoit défirer , pour étudier les partitions de
celui qui étoit ainfi doublement fon maître fans le
favoir. Un jour Caldara la ffa fur fon bureau un
morceau de mufique fort difficile & qui n’étoit pas
fini : Bernier prit la plume & l’acheva. Caldara furpris,
le fut bien d’avantage quand il, fut la vérité* Ce trait
lui infpira pour Bernier une amitié qui dura toute
leur vie. Bernier de retour en France , s’y fit bientôt
une grande réputation. Ayant été fait maître de
la chapelle du Roi, & fe trouvant affez de moyens &
• de loifir, iipaffa la plus grande partie de fon te ms
à donner des leçons, la plupart gratuites. Senaillé,
T éclair, & un grand nombre d’autres muficiens célèbres
fortirent de fon école. C’eft la meilleure qui
ait exifté en France jufqu’au moment Où l’on quitta
la route fimple & naturelle qu’il avoit fuivie , & à
laquelle, après cinquante ar.s d’erreur, il a bien fallu
revenir. Bernier .mourut à Paris en 1734.
■ Enfin R a m e a u parut • & le premier en France'
Fit fér,tir dans les airs une jufte cadence ;
D'un fon mis à fa place enfeigna lé pouvoir,
Et fournit la routine aux règles du devoir.
On peut avec affez de jufteffe appliquer à Rameau
cette parodie de quatre vers de Boileau fur Malherbe,
pourvu qu’on n’applique pis aux monologues de fes
opéra , ni à la . plupart de fes morceaux de chant, la
jufle cadence qu’il ne donna véritablement qu’à fes
airs.àe ballet. •
Jean-Philippe Rameau , naquit à 'Dijon le 2 5 octobre
1683. Il voyagea très jeune en Italie, où-il
étoit entraîné par fon goût pour la mufique; mais
on ne dit point qu’il y ait étudié fous aucun maître.
De retour en France, il devint organifte à Clermont
en Auvergne, & enfume à paris, à Ste. Croix de la
Bretonnepe. Des études & des ouvrages de théorie,
des leçons de clavecin , & .la compétition de quelques
pièces pour cet infiniment, l’occupèrent jùfqu’à
l’âge de cinquante ans. Ce ne fut qu’en 1733 qu’ri
parut fur la fcène lyrique, & depuis lors, il ne ceffa
jufqtià près de quatre-vingts ans de compofer pour
le théâtre.
Il débuta par Rippolite & A'ricie, dont la première
repréfentation excita une grande fermentation. Les
François qui fommeilloient depuis Lulli, en répétant
dans leurs rêves que Lulli étoit le plus grand
homme du monde, fe crurent réveillés & s’en fâchèrent.
Ce que Rameau avoit tâché de mettre de
force dans fon harmonie, on le trouva dur & baroque
;fon cha; t plus nerveux mais moins doux & moins
naturel, fut nommé barbare. Son récitatif moins fimple
& trop chantant, tandis que fes airs ne l’étoient
pas ajfefc, trouva tout autant de contradicteurs; en
un mot, tous le_; francs* Lullifles , jettèrent feu &
flammes contre l’audace, l'effronterie, l’attentat dé
chercher en mufique un autre fi y le que celui de
Lulli.
Mais le nouveau compofiteur eut auffi des parti-
fans & des amis , qui agirent chaudement en fa faveur,
& de'là une guerre , telle qu’il en à toujours
fallu en France, pour que l’art y fit un pas de plus.
Elle dura jufqu’au moment, où après avoir donné plu-
fieurs autres opéra, qui tous avoient eu un fuccès
difputé , Rameau remit au théâtre Caflor & Pollux,
qui avoit paru .le troifième. Cette reprife eut un tel
éclat, qu’à compter de ce moment, la gloire de l’auteur
fut fans troublé. Les François cédèrent alors lans
s’en apercevoir, comme il leur eft arrivé dans d’autres
occafions, à l’imprefïion que leur firent la ri-
cheffe & la be.auté du fpeétaclè, l’intérêt & la variété
du fujet, le charme des ballets & celui des vers
de Bernard, avantages que Rameau n’àvoit eus dans
aucun autre de fes opéra ^ obligé le plus fouVent de
combattre non-feulement Lulli, mais Quinauk, avec
Pe legrin, Fufelier & Cahufac.
Les vifgt-deux opéras qu’il donna dans l’efpace de
i vingt-fept ans , c’eil-à-dire depuis 17.33 ? jufqu’en
1760, font: Hippolyte 6* Aricie, les Indes galantes,
Caflor & Pollux , les Talen 's lyriques , Dardanus , les
fêtes de Polymnie, le temple de là Gloire, la prince ffe
de Navarre, Sam fon non-te préfenté, Pygmalion , les
Fêtes de l’hymen & de l ’amour, Z dis, Nais, Platée,
Zoroaftfe, Acanîe & Cêphife, la Guirlande, Anacréon
, là fête de Pamilie , les Surprifes de l’amour, des
Sibarites & les Paladins. -
Trois livres de pièces de clavecin, étoient la feule
mufique qu’il eût fait pare>ître avant fon premier opéra;
depuis qu’il fut engagé dans, la carrière dramatique ,
il en publia encore un livre avec fyniphônies ou en
concerts.
Quant à fes ouvrages de théorie, il aveit publié
dès 17 2 2 , fon traité de Vharmonie& quatre ans
après , fon nouveau fyflêmé théorique. Sa génération
harmonique, fa dijfertation fur Vaccompagnement, fa
démonflration du principe de L’harmonie, fes réflexions
fur le même principe, une reponfe a M. Eulerj, des
obfervations fur notre inflinül pour la mufique . enfin le
code de mufique & quelques autres opufcules, parurent
fuccefhvement depuis qu’il.fé fut montré fur IV
fcène; & il ne ceffa jufqu’à fis dernières années,
d’écrire foit des livres en faveur de fon fyfiême , l'oit
des ouvrages de théâtre où il le mettoit en pratique.
Il mourut à Paris le 17 feptembre 1767. « Lesrnu-
ficiensdu Roi & ceux de l’académié royale de mufique,
«qui fe reg’ardoient: tous comme fes en fs ns , lui firent
célébrer à Péglife de l’oratoire; un fervice folenne!,
où l’on exécuta p'ufieurs de fes plus beaux morcéaux.
M. Philidor fit auffi exécuter une méfié des morts de
fa compofition , dans l’églife des carmes du Luxembourg
, en l’honneur d’un homme dont il admiroit
les talens. » ( EJfai fur là mufique. à
Il eut été dangereux, il y a quelques années, d’énoncer
un jugement trop libre fur ‘es ouvrages de
Rameau. Il feroit fuperflu de le faire aujourd’hui. U11
autrÇ §®nre de mufique a été potfr la fienne, ce que la
fienne avoit été pour la mufique de'Lulli. Tout le
monde eft d’accord là-diffus. Ses ouvrages theoriqves,
qui font le fondement le plus, folide de fa g’dire, ont
eu befoin qû’un phïlofophe fe donnât la peine de les
éclaircir , de les, mettre en ordre de les réduire
en un fyfiême clair, méthodique & fuivi. Enfin ce
fyfiême ingénieux, fondé fur une découverte fieu-
reufe , a dans les applications.., ’dans les extensions que
lui a données fon auteur , & même dans quelques-
unes de fes bafes, des défaut- qui ne font plus ignorés
, ou qui rie lé feront, plus , lorfqu’on aura lu avec
réflexion tous les articles de ce diâionriuire, relatifs
à la baffe fondamentale.
Les 'compofiteurs d’opera contemporains-& fuc-
ceffeurs-de ,. & les derniers de l’arcienne
école françoife , furent Mondonviile depuis 1 “42 ,
jufqu’en 1758, Berton de 1755 à 1775 , D’Auvergne
de 1752 à 17 3 , & Trial de 1763 à 1771.
Pendant que vaincus de toutes parts par la mufique
italienne,, la, plupart de ces maîtres .chercho eru au
moins un genre, mitoyen, entre l’ita’ien &. françois,
qui pût conferver à celui ci quelque refi-; d’exiftence,
Tau ire faifoit en France les plus rapides progrès.
Dès le commencement du fièc'e, en 1702, un nomme
d’efprit ôc de goût, l’abbé Raguenet, qui avoit
refidé quelque tems à Rome, avoit publié un pamphlet
intitulé : Parallèle des Italiens & des François,
en ce qui regarde la mufique 6* les opéra. Il produit!t
une petite guerre , qui fe termina'âpres quelques
ecriVs pour & contre ; & les François depuis ce tetris
fetribîent avoir joui.de leur fommeil lyrique avec
beaucoup de farisfoélion St de tranquillité jufqu?en
1752.: Ce fut alors.que la reprêfeatafion d elàSe^va
padrona, donnée fur le théâtre de l’opéra c!e P^ris
par une trou.pe de, bpu,ffons italiens , alluma dans l.i
république muficale , un feu,qui,ne s’eft éteint qu’a-
près avoir çonfumé fans .retour l’ancienne , mufique
ftançoife.;.
Ce fut en exerçant un privilège exclufif éc vèxdtoife, '
que Topera frariçois accédera fa perte.'Gette troupe
italienne avoit été engagée pour a’ier jouer à Rouen.
La peut-êt -e auroit-elle eu quelques Fuccès faffifans
pour Ion ambition ; les Normands fatisfaits l’eufient
rêtentie tout le tcrnsqu’elle devoir paffer en France.
On auroit feu’ement appris dans la capitale cette
nouveauté de Province;, & la pfalmodie françoife
eut continué paifibiement eu F: an ce , de s’appcll.r
de la mufique*. Mais l’Acad-.ipie Royale avoit la fou-
veraineté abfolue fur les opera provinciaux , comme
fur ceux de Paris ; elle ne voulut pas qns les bouffons
jouaffent pour Rouen j avant d’avoir joué pour elle,
& ce fut par fon ordre même qu’ils vinrent la combattre
dans fes foyers.
Elle fit une autre imprudence. Elle avoir alors dans
fon répertoire tous lès opera de Rameau ; elle chef fi t
par préférence, pour lutter avec 'a mufique de Per-
golèfe , un opéra de Lulli ; & de peur que le cori-
trafie ne fût pas affez marqué, au lieu de les donner
ou à différens jours, ou au moins t’uri après l'autre ,
comme1 la Servapàdrona étoit un intermède , les di^
reéleurs voulurent qu’elle remplit fa deflination primitive
, ôl la placèrent entre lés aéles d’Acis & Gala
tée. •
On fe figure aifémentTeffet qu’elle.y dut produire,
& l’on fait de quels combats elle fut la caufe. Les
querelles dans les cafés , dansjes fociétés, la divi-
fion du parterie en deux efpèces d armées, toujours
rangées en bataille.& prêtes à en venir aux rrains,
une grêle d’écrits polémiques qui fe finieMoienr, fe
croilbient rapldsment, enfin le diferédît dans lequel
tomba dès-lors le prétèndu chant françois, tout cela
fut le produit dé cette imprudence académique.
Tous les opéra françois qu’on effaya d’oppofer aux
intermèdes italiens , euren: le même fort qu’Acis
& Gala fée. Le devin du village put lenl . enir conrre
eux, parce que la muii aie fans être italienne , n’étant
pas non plus de la mufique françoife, ayant un
chant régulier, du rhythme, de la mefure, les Li-
v-oit de plus près , & les comba toit avec moins a’iné-
galiîé. « Quand je compofai mon intermède, dit
Rouffeau lulrmême dans fes confèifions, j’avois l’ef-
p'it rempli de ceux-là ; ce furent eux qui m’en don-
T.èrent l’idée,, & j’étojs bien éloigné de prévoir qu’on
. 1, s pafferoit en revue à côié de lui. »
J. J. Rouffeau n’étoit alors Connu que par fon dif-
coürs fur les Iciences, & par les répon es qu’il avoit
faites à des-adverfaires nombreux ÖC obfiin -s à ne le
pas entendre. Il copioit de la mufique pour vivre
honnêtement, & pour- ne pas trafiquer dé fa plume,
dès-:ors eonfacrée à la vérité. Il avoit prk parti dans
la guerre lyrique, s’étoît rangé comme t us les
gens de goût&,de lettres, ^u pôfé deJTtalje. Le'fuccès
du devin lui donna fur certe pha’ange .d’amateurs,
une fupériorité qui fut le premier, germe de la hai.e
implacable que plufieurs d’entre eux lui. ont vouée
depuis.
Il provoqua bien d autres haines par fa lettre fur la
mufique f ançoife. Tou té-la Franck. Outragée dan‘S fa
mufique , fe déchaîna contre cet ou vrage: Son autiur
fut .brûlé eri effigie au théâtre de l’opéra , Ôc quoiqu’il
I i i i ij