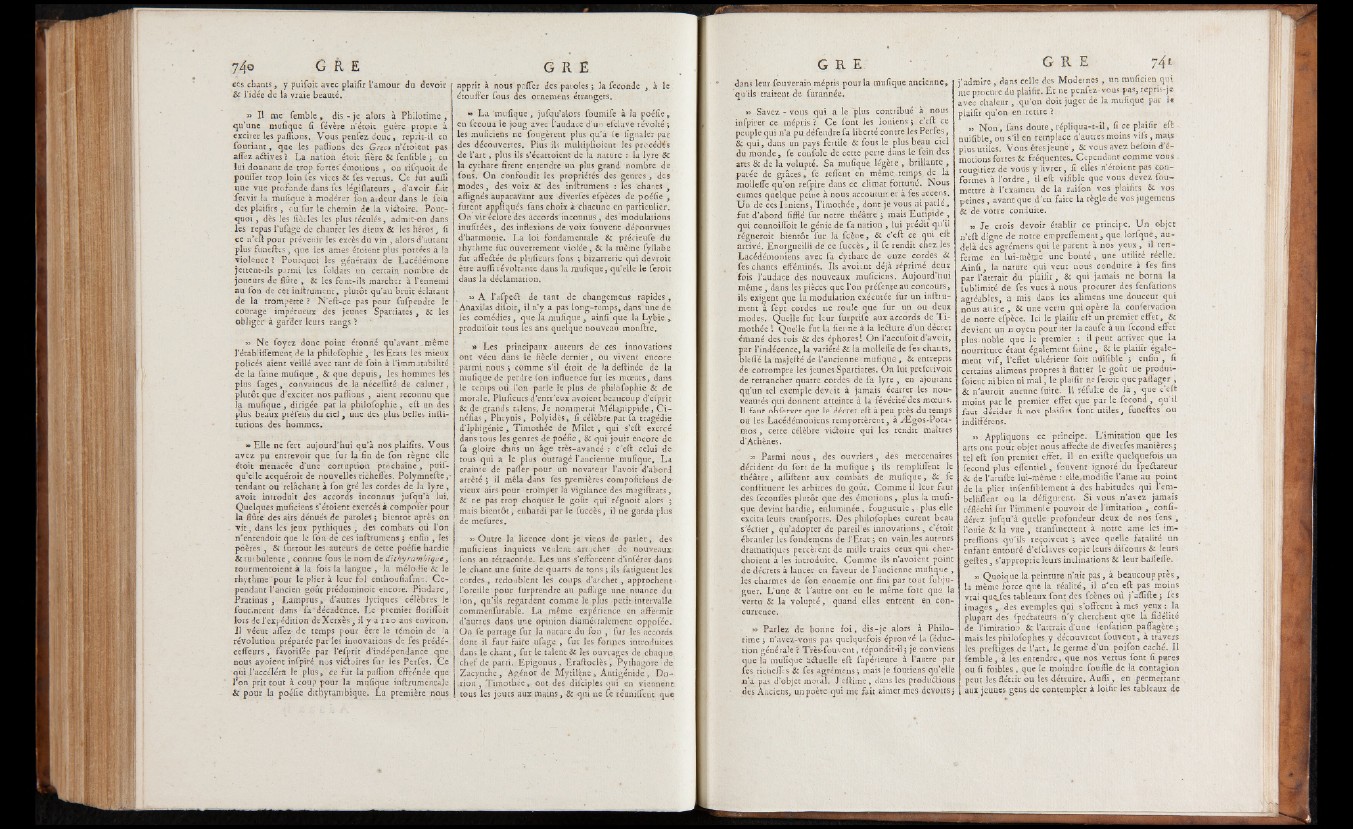
ccs chants • y puifoit avec plaifir l’amour du devoir
êc l’idée de la vraie beauté.
» Il me femble, dis - je alors à Philotimc ,
qu’ une mufique fi févère n’étoit guère propie à
excirer les paffions. Vous penfez donc, reprit-il en
iou r iant, que les paillons des Grecs n’étoient pas
affe za&ives? La nation étoit fière & fenfible ; en
lui donnant de trop fortes'émotions , on rifquoit.de
pouffer trop loin fes vices & les vertus. C e fut auffi
une vue profonde dans fes légiflateurs , d’avoir fait
Ter vir la mufique à modérer l’on ardeur dans le fciia
des plaifiis , ou fur le chemin de la victoire. Pourquoi
, dès les fièçles les plus réculés, admit-on dans
les repas l’ufage de chanter les dieux & les héros, fi
ce n’eft pour prévenir les excès du vin , alors d’autant
plus funeftes, que les âmes étoient plus portées à !a
violence ? Pourquoi les généraux de Lacédémone
jettent-ils parmi les foldats un certain nombre de
joueurs de flûre , & les font-ils marcher à 1’ennemi
au fon de cet inftrument, plutôt qu'au bruit éclatant
de la trompette ? N ’eft-ce pas pour fufpendre le
courage impétueux des jeunes Spartiates, & les.
obliger à garder leurs rangs ?
» N e foyez donc point étonné qu’avant ^même
îétabüffement de la philofophie , les Etats les mieux
policés aient veillé avec tant de foin à l'immutabilité
de la faine mufique , & que depuis, les hommes les
plus fag es , convaincus de la néceflité de ca lm er,
plutôt que d'exciter nos paffions , aient reconnu que
la mufique , dirigée par la philofophie , eft un des
plus beaux préfens du c ie l, une des plus belles infti-
tutions des hommes.
»• Elle ne fert aujourd’hui qu’à nos plaifirs. Vous
a v e z pu entrevoir que fur la fin de fon règne elle
étoit menacée d’une corruption prochaine, püif-
qu’ellc acquéroir de nouvelles richeffes. Polymnefte fj
tendant ou relâchant à fon gré les cordes de la lyre ,
avoit introduit des accords inconnus jufqu’à lui.
Quelques muficiens s’étoient exercés à compofer pour
la flûte des airs dénués de paroles ; bientôt après on
v i t , dans les jeux pythiques , des combats où l’on
n’ entendoit que le fon de ces inftrumcns ; enfin , les
poètes , & furtout les auteurs de cette poéfie hardie
& turbulente, connue fous le nom de dithyrambique,
tourmentoient à la fois la langue , la mélodie & le
rhythme pour le plier à leur fol enthoufiafme. C e pendant
l’ancien goût puédominoit encore. Pindare,
Pratinas , Lamprus, d’autres lyriques célèbres le
foutinrent dans fa ’ décadence. L e premier floriffoit
lors de l'expédition deXerx ès, il y a ï z o ans environ.
Il vécut affez- de temps pour être le témoin de la
révolution préparée par les innovations de fes prédé-
ceffeurs, fayorifée par l’efprit' d’indépendance que
nous avoient infpiré nos viéîoires fur les Pcrfes. C e
qui l ’accéléra le plus, ce fut la paffion effrénée que
l'on prit tout à coup pour la mufique inftrumentale
& pour la poéfie dithyrambique. L a première nous
apprit à nous pr.ffer des paroles ; la fécondé , à le
étouffer fous des ornemens étrangers.
» La ‘mufique, jufqu’alorsToumife à la poéfie,
en fccoua le joug avec l’audace d’un efclave révolté;
les muficiens ne fongèrent plus qu’à (e fignalet par
des découvertes. Plus ils multiplioicnt les procédas
de l’a r t , plus ils s’écartoient de la nature : la lyre 8c
la cychare firent entendre un plus grand nombre de
fons. On confondit les propriétés des genres , des
modes, des voix &: des inftrumens : les chants ,
affignés auparavant aux diverfes efpèces de poéfie ,
furent appliqués fans choix àrchacune en particulier.
On vit éclore des accordsGinconnus , des modulations
inuficées, des inflexions de voix fouvent dépourvues
d’harmonie. L a loi fondamentale 8c précieufe du
îhyrhme fut ouvertement v iolé e, 8c la même fyllabe
fut affeétée de .piufieurs fons ; bizarrerie qui devroit
être auffi révoltante dans la mufique, qu’elle le feroit
dans la déclamation,
v m A l’afpeét de tant de changemens rapides,
Afiaxilas difoit, il n’y a pas long-temps, dans une de
fes comédies, que la mufique , ainfî que la Lybie ,
produifoit tous 4es ans quelque nouveau, monftre,
» Les principaux auteurs de ces innovations
ont vécu dans le fiècle dernier, ou vivent encore
parmi nous ; comme s’il étoit de la deftinée de la
mufique de perdre (on influence fur les moeurs, dans
le temps où l’on parle le plus de philofophie & de
morale. Plufieurs d ’entr’eux avoient beaucoup d’elprit
& de grands talens. Je nommerai Mélajnippide , C i -
néfias, Phiynis, Polyidès, fi célèbre.par fa tragédie
d’Iphigénie, Timothée de M i le t , qui s’eft exercé
dans tous les genres de poéfie, & qui jouit encore de
fa gloire dans un âge très-avancé : c ’eft celui de
tous qui a le plus outragé l’ancienne mufique.. La
crainte de palier pour un novateur l’avoir d’abord
arrêté; il mêla dans fes premières compofitions de-
vieux airs pour tromper la vigilance des magiftrats,
& ne pas trop choquer le goût qui régnoit alors ;
mais bientôt, enhardi par le fuccès, il ne garda plus
de mefures.
« Outre la licence dont je :viens de parler, des
muficiens inquiets veulent arracher de nouveaux
fons au tétracorde. Les Uns s’efforcent d’inférer dans
le chant une fuite de'quarts de tons ; ils fatiguent les
cordes, redoublent les coups, d’archet, approchent •
l’oreille pour furprendre au paflage une nuance du
fon, qu’ils regardent comme le plus petit intervalle
commènfurabie. La même expérience en affermit
d’autres dans une opinion diamétralement oppofée.
On fe partage fur la nature du fon , fur les accords,
dont il faut faire ufage , fur les foripes introduites
dans le chant, fur le talent ôc les ouvrages de chaque
chef de parti. Epigonus, Era ftoclès, Pythagore de
Za cynthe, Âgénor de Mytilène, Antigénide , D o -
.rion , Timothée, ont des, -difciples qui en viennent
, tous les jours aux mains, & qui ne fe réunifient que
dans leur fouverain mépris pour la mufique ancienne,
qu’ils traitent de furannée.
»s Savez - vous qui a le'p lu s contribué'à nous
infpirer ce mépris ? C e font les Ioniens 5 c’eft ce
peuple qui n’a pu défendre fa liberté contre les Per fes,
& q u i, dans un pays fertile & fous le plus beau ciel
du monde, fe confole de cette perte dans le fein des
arts & de la volupté. Sa mufique. légère , brillante ,
parée de grâces, fe reffent ’en même temps,, de la
moileffe qu’on refpire dans ce climat fortuné. Nous
eûmes quelque peine à nous accoutumer à fesa-ccens.
U n de ces Ioniens, Timothée, dont je vous ai parlé,
fu t d’abord fifflé fur notre théâtre ; mais Euripide ,
qui connoiffoit le génie de fa nation , lui prédit qu’il
régneroit bientôt fur la fcèn e, & c’eft ce qui eft
arrivé. Enorgueilli de ce fuccès , il fe rendit chez les
Lacédémoniens avec fa cythare de onze cordes 8c.
fes chants efféminés. Ils avoient déjà réprimé deux
fois l’audace des nouveaux muficiens. Aujourd’hui
mêm e, dans les pièces que l’on préfente au concours,
ils exigent que la modulation exécutée fur un inftm-
ment a fèpt cordes ne roule que fur un ou deux
modes. Quelle fut leur furprife aux accords de T i mothée
1 Quelle fut la fienne à la leéture d’ un décret
émané des rois & des éphores! On l’accufoit d’avoir,
par l’indécence, la variété 8c la moileffe de fes chants,
blefié la majefté de l’ancienne mufique, & entrepris
de corrompre les jeunes Spartiates. On lui.prefcrivoit
de retrancher quatre cordes de fa ly r e , en ajourant
qu’un tel exemple deveit à jamais écarrer les nouveautés
qui donnent atteinte à la févérité’des moeurs.
11 faut obferver que le décret eft à peu près du temps
où les Lacédémoniens remportèrent, à Ægos-Pota-
mos , cette célèbre viéloire qui les rendit maîtres
d’Athènes.
95 Parmi nous , des ouvriers, des mercenaires
décident du fort de la mufique ; ils rempiiffent le
théâtre, affiftenc aux combats de mufique, & fe
conftituent les arbitres du goût. Comme il leur faut
des fecouffes plutôt que des émotions, plus la mufique
devint hardie, enluminée,, fougueule , plus elle
excita leurs tranfports. Des philofophes eurent beau
s’écrier, qu’adopter de pareil!ës innovations, c’étoit
ébranler les fondemens de l’E ta t ; en vain.les auteurs
dramatiques percèrent de mille traits ceux qui cher-
choient a les introduire. Comme ils n’avoient point
de décrets à lancer en faveur de l’ancienne mufique,
les charmes de fon ennemie ont fini par tout fo b j liguer.
L ’une & l ’autre ont eu le même fort que la
vertu & la volupté, quand elles entrent en concurrence.
?» Parlez de bonne foi , dis-je. alors à Philo-
time ; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la féduc-
tion générale i Très-fouvent, répondit-il ; je conviens
que la mufique a&uelle eft fupérieure à l’autre par
les richeffes & fes agrémens; mais je foutiens qu’elle
n ’a pas d’objet moral. J eftime , dans les produftions
des Anciens, un poète qui me fait aimer mes devoirs;
j’admire , dans celle des Modernes , un muficien qui
me procure du plaifir. E t ne penfez-vous pas, repris-je
avec chaleur, qu’on doit juger de la mufique par 1«
plaifir qu’on en retire ï
»9 N o n , fans doute, répliqua-t-il, fi ce plaifir eft
nuifible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs , mais
plus utiles. Vous êtes jeune , & vous avez befoin d’émotions
fortes & fréquentes. Cependant comme vous
rougiriez de vous y livrer, fi elles n’étoient pas conformes
à l'ordre, il eft vifible que vous devez fou -
mettre à l’examen de la raifon vos plaifirs & vos
peines, avant que d ’en faire la règle de vos jugemens
& de votre conduite.
93 Je,, crois devoir établir ce principe. U n objet
n’eft digne de notre empreffement, que lorfque, au-
delà des agrémens qui le parent à nos yeu x, il renferme
en lui-mêçse une b o n té , une utilité réelle.
A in f i, la nature qui veut nous conduire à fes fins
par l’attrait du plaifir, 8c qui jamais ne borna la
fubiimité de fes vues à nous procurer des fenfations
agréables, a mis dans les alimens une douceur qui
nous attire , & une venu qui opère la confervation
de notre efpèce. Ici le plaifir eft un premier effe t, 8c
devient un moyen pour lier lacaufc à un fécond effet
plus-noble que le premier : il peut arriver que la
nourriture étant également fa in e, & le plaifir également
v i f , l’effet ultérieur foit nùîfible ; enfin , fi
certains alimens propres à flatter le goût ne prôdui-
foient ni bien ni m a l, le plaifir ne feroit que paffager ,
& nau roit aucune fuite. Il réfulte de là , que c’eft
moins par le premier effet que par le fécond , qu il
faut décider fi nos plaifirs font utiles , funeftes ou
indifférons.
99 Appliquons ce principe. L ’imitation que les
arts ont pour objet nous affeâie de diverfes manières ;
tel eft fon premier effet. Il en exifte quelquefois un
fécond plus effentiel , fouvent ignoré du fpeélateur
& de l’artifte lui-même : elle,modifie l’ame au point
de la plier infenfiblement à des habitudes qui Fem-
beltiffenc ou la défigurent. Si vous n’av e z jamais
réfléchi fur l’immtnle pouvoit de l'imitation , confi-
dérez jufqu’à quelle profondeur deux de nos fens ,
l’ouie & la vue , tranfmettent à notre ame les im-
preffions qu’ils reçoivent ; avec quelle fatalité un
enfant entouré d’efelàves copie leurs difeours & leurs
gefte s, s’approprie leurs inclinations & leur baflèffe.
59 Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup p rès,
la même force que la réalité , il n’ en eft pas moins
vrai quelles tableaux font des fcènes où j’affifte ; fes
images , des exemples qui s ’offrent à mes yeux : la
plupart des fpeftateurs n’y cherchent que la fidélité
de Limitation & l'attrait d’une (enfation paffagère 5
mais les philofophes y découvrent fou ven t, à travers
les preftiges de l’art, le germe d’un poifon caché. Il
femb le, à les entendre, que nos vertus font fi pares
ou fi foibles , que le moindre fouffle de la contagion
peut les flétrir ou les détruire. A u d i, en permettant
aux jeunes gens de contempler à loifîr les tableaux de