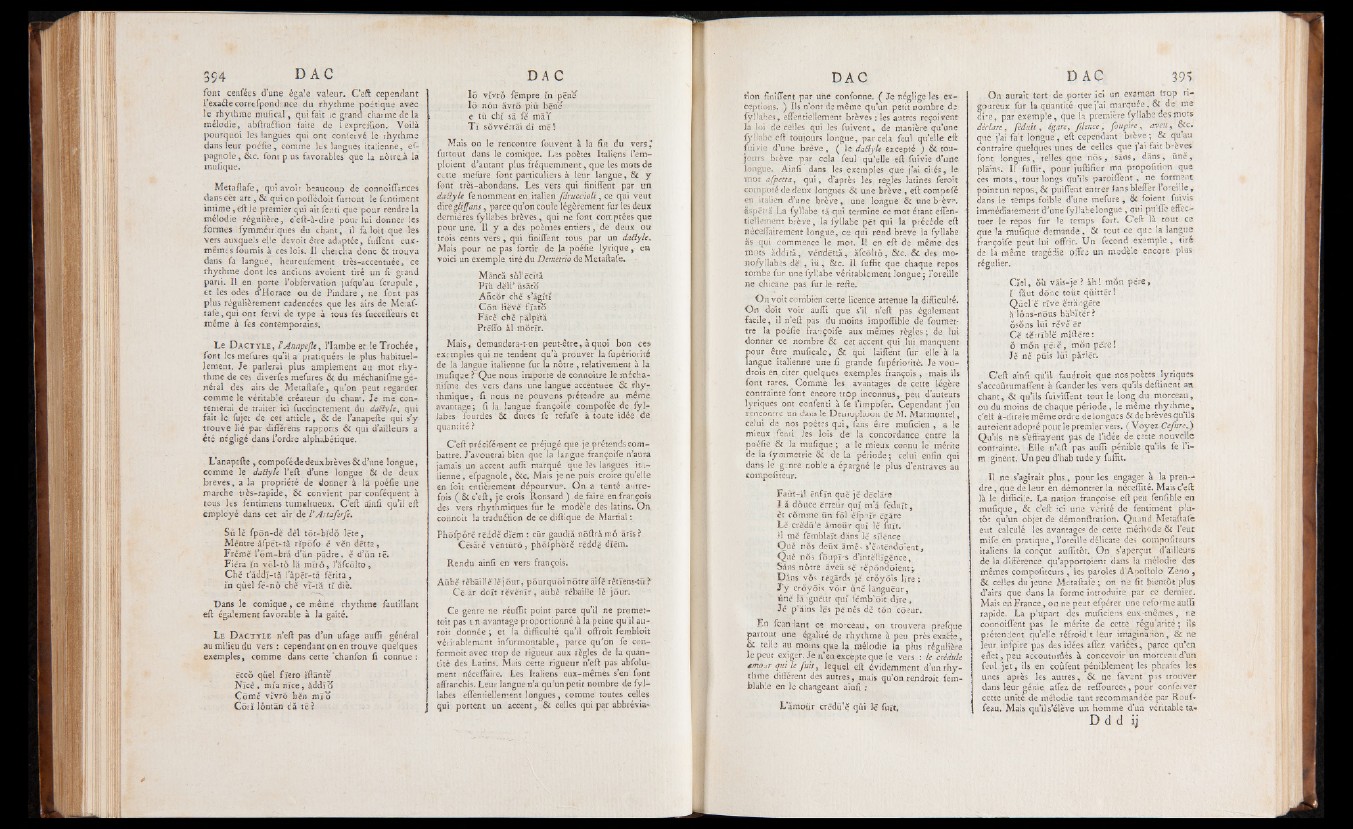
5ç4 DA C
font cenfées d’une égale valeur. C ’eft cependant
l’exaéte correfpond.'nce du rhythme poétique avec
le rhyihme mufical, qui fait je grand charme de la
mélodie, abftraérion faite de lexpreflion. Voilà
pourquoi les langues qui ont confervé le rhythme
dans leur poéfie, comme les langues italienne, espagnole,
&c. font p us favorables que la r.ôtr^à là
mufique.
Metaflafe, qui avoit beaucoup de connoiffances
dans cet art, & qui en poffédoit Surtout le Sentiment
intime, eft le premier qui ait fenti que pour rendre la
mélodie régulière, c'eft-à-dire pour lui donner les
formes fymrnécriques du citant, il fa,loit que les
Vers auxquels elle deyoit être adaptée, ftiffent eux*
mêmes fournis à ces lois. Il cheicha donc & trouva
dans fa langue, heureufement très-accentuée, ce
rhythme dont les anciens avoient tiré un fi grand
parti. Il en porte l’obfervàtion jufqu’au fcrupule,
et les odes d’Horace ou de Pindare , ne font pas
plus régulièrement cadencées que les airs de Me;af-
tafe, qui ont fervi de type à tous fes fucceffeurs et
même à fes contemporains.
Le D a c t y l e , VAnapejle, flambe et le Trochée,
font les mefures qu’il a pratiquées le plus habituellement.
Je parlerai plus amplement au mot rhythme
de ces diverfes mefures & du méchanifme général
des airs de Metaflafe, qu’on peut regarder
comme le véritable créateur du chant. Je me contenterai
de traiter ici fuccinçtement du daElyle, qui
fait le fujet de cet article, & de l’anapefte qui s y
trouve lié par différéns rapports & qui d’ailleurs a
été négligé dans l’ordre alphabétique.
L’anapefte, compofédedeuxbrèves&d’une longue,
comme le daElyle l’eft d’une longue & de deux
brèves, a la propriété de donner à la poéfie une
marche très-rapide, & convient par conféquent à
tous les fentimens tumultueux. C ’eft àinfï qu’il eft
employé dans cet air de l ’Artaferfe.
S u ie fpôn-dé dêl tôr-bïdô lëte,
Mëntre âfpët-tâ rïpôfo ë vën dëtta,
Frëmë l’ôm-brà d’un pâdre, ë d’un rë.
Fiera ïn vôl-tô là mïiô , l’àfcôlto,
Chë t’âddï-tà l’âpër-tâ fërita ,
ïn quel fë-nô chë vï-tâ tï diè.
Dans le comique, ce même rhythme fautillant
eft également favorable à la gaîté.
Le D ac tyle n’eft pas d’un ufage aufîî général
au milieu du vers: cependant on en trouve quelques
exemples, comme dans cette ‘chanfon fi connue :
ëccô quel fïero ïftânte
Nïcë , nua nïce, âddï o
Cômë vïvrô bën ml o
C ô iï lôntân dâ te î
D A C
Iô vïvrô fëmpre ïn pêne
Iô non âvrô piü bëhe
e tu chï sa fë mâY
T ï sôyvërrâi dï mëî
Mais on le rencontre fouvent à la fin du vers}
furtout dans le comique. Les poètes Italiens l’emploient
d’autant plus fréquemment, que les mots de
cette mefure font particuliers à leur langue, & y
font trèfc-abondans. Les vers qui finiffent par un
daElyle fe nomment en italien fdruccioli, ce qui veut
dire gtiffans, parce qu’on coule légèrement fur les deux
dernières fyllabes brèves, qui ne font comptées que
pour une. Il y a des poèmes entiers, de deux ou
trois cents vers , qui finiffent tous par un daElyle.
Mais pour ne pas fortir de la poéfie lyrique , en
voici un exemple tiré du Demetrio de Metaflafe. -
Màncà sôl'ëcïtâ
Pïü dëll’ üsâto
Ancor chë s’âg£tï
Côn liëvë fïato
Fâcë chë palpita
Prëffo âl môrïr.
Mais, demandera-t-on peut-être, à quoi bon ces
exemples quijae tendent qu’à prouver la fupériorité
de la langue italienne fur la nôtre , relativement à la
mufique ? Que nous importe de connoitre le méchanifme
des vers dans une langue accentuée & rhy-
thmique, fi nous ne pouvons prétendre au même
avantage; fi la langue françoife compofée de fyllabes
lourdes & dures fe refufe à toute idée de
quantité ?
C ’eft précifément ce préjugé que je prétends combattre.
J’avouerai bien que la langue françoife n’aura
jamais un accent aufli marqué que les langues italienne,
efpagnole, &c. Mais je ne puis croire qu’elle
en foit entièrement dépourvue. On a tenté autrefois
( & c’eft, je crois Ronsard ) de faire en frar.çois
des vers rhythmiques fur le modèle des latins. On
corinoit la traduélion de ce diftique de Martial :
Phôfpôrë rëddë dïëm : cür gaudïà nôftrâmô ârïs ?
Cësârë vëntürô, phôiphôrë rëddë dïëm..
Rendu ainfi en vers françois.
Aübë rëbâilîë le jour, pourquoi nôtre âifë rëtïens-tü ?
Cë.âr doit rëvënïr, aübë rëbaille lë jour.
Ce genre ne réuflit point parce qu’il ne promet-
toit pas m avantage pipportionné à la peine qu'il au-
roit donnée ; et la difficulté qu’il offroit fembloit
véritablement in fur mon table, parce qu’on fe con-
formoit avec trop de rigueur aux règles de la quantité
des Latins. Mais cette rigueur n’eft pas abfolu-
ment néceffaire. Les Italiens eux-mêmes s’en font
affranchis. Leur langue n’a qu’un petit nombre de fyllabes
effentiellement longues, comme toutes celles
qui portent un accent, & celles qui par abbrévia-
DAC
tien finiffent par une confonne. ( Je néglige les exceptions.
) Ils n’ont de même qu’un petit nombre de
fyllabes, effentiellement brèves : les autres reçoivent
la loi de celles qui les fuivent, de manière qu’une
fyllabe eft toujours longue, par cela feul qu’elle eft
fuivie d’une brève, ( le daElyle excepté ) & toujours
brève par cela feul qu’elle eft fuivie d’une
longue. Ainfi dans les exemples que j’ai cité?, le
mot a/petta, qui, d’après les, réglés latines feroit
compoiéde deux longues & une brève , eft compofé
en italien d’une brève, une longue & une b*èv?\
àspëtrâ La fyllabe ta qui termine ce mot étant effentiellement
brève, la fyllabe pet qui la précédé eft
néceffairement longue, ce qui rend breve la fyllabe
as qui commence le mot. Il en eft de même des
mots àddïta, vëndëttà, âfcôltô, &c. & des mo-
nofyllabes dë!, iü , &c. Il fuffit que chaque repos
tombe fur une fyllabe véritablement longue ; l’oreille
ne chicane pas fur le refte.
On voit combien cette licence atténué la difficulté.
On doit voir aufli que s’il ri’eft pas également
facile, il n'eft pas du moins impofîible de foumet-
tre la poéfie françoife aux mêmes règles ; de lui
donner ce nombre & cet accent qui lui manquent
pour être muficale, & qui laiffent fur elle à la
langue italienne une fi grande fupériorité. Je vou-
drois en citer quelques exemples françois , mais ils
font rares. Comme les avantages de cette légère
contrainte'font encore trop inconnus, peu d’auteurs
lyriques ont confenti à fe l’impbfer. Cependant j’en
rencontre un dans le Demophoon de M. Marmontel,
celui de nos poètes qui, fans être muficien , a le
mieux fenti les lois de la concordance entre la
poéfie & la mufique; a le mieux connu le mérite
de la fymmetrie &. de la période; celui enfin qui
dans le g.nre noble a épargné le plus d’entraves au
compofiteur.
Faut-ïl enfin quë je déclare
Là douce ërreür qui m’a fëduït,
et comme ün fôl ëfpoïr ëgâre
Lë crëdü’e amour qui lë fuît,
il më fëmblaït dans lë silence
Quë nos deux âme* s’ëntëndôient,
Que nos foupï-s d’ïntëllïgënce,
Sans nôtre âveü së rëpôndôient;.
Dans vos regards jë crôyôis lire ;
J’y crôyôis voir une lànguëür,
wnë là tguëur qui fëmblôit dire,
Jë p’âins les pë nës dë ton coeur.
En feaniant ce morceau, on trouvera prefque
partout une égalité de rhythme à peu prèsexaâe,
& telle au moins que la mélodie la plus régulière
le peut exiger. Je n’en excepte que le vers : le crédule
amour qui le fuit, lequel eft évidemment d’un rhythme
difterent des autres, mais qu’on rendroit fein-
blabie en le changeant ainfi ;
L’amofir crëdû’ç qui le fuit.
da c m
On aurait tort de porter ici un examen trop rigoureux
fur la quantité que j’ai marquée, & de me
dire, par exemple, que la première fyllabe des mots
déclare, féduit, égare, filence, foupire, aveu, &c.
que j’ai fa't longue, eft cependant brève ; & qu’au
• contraire quelques unes de celles que j ai fait brèves
font longues, telles, que nos, sans, dans, une,
plains. Il fuffit, pour juftifier ma propofition que
ces mots, tout longs qu’ils paroiffent , ne forment
point un repos, & puiffent entrer ians bleffer 1 oreille ,
dans le temps foible d’une mefure , & foient fuivis
immédiatement d’une fyllabe longue, qui pu ffe effectuer
le repos fur le temps fort. C ’eft la tout ce
: que la mufique demande, & tout ce que la langue
! françoife peut lui offrir. Un fécond exemple, tire
de la même tragédie offre un modèle encore plus
| régulier.
Cïel, où vais-je ? ah. I mon përe,
ï ’ faut donc tout quitter l
Qüel ë rive étrangère
à lôns'-nôus habiter ?
osons lui rëvë ër
Cë tërrïbîë mïftëre:
ô mon pë; ë , mon pë-te!
Jë në püis lui pariër. -
C ’eft ainfi qû’il faudroit que nos poètes lyriques
s’accoû t u m a lient à feander les vers qu’ils deftinént an.
chant, & qu’ils fuivîffent tout le long du morceau,
ou du moins de chaque période , le même rhythme,
ç’eft à-direle même ordre de longues & de brèves qu’ils
auroient adopté pour le premier vers. (V oyez Cefure._)
Qu’ils ne s’effrayent pas de l’idée de cette nouvelle
contrainte. Elle n’c-ft pas aufîî pénible qu’ils fe f i ni
ginent. Un peu d’hab tude y fuffit.
Il ne s’agirait plus, pour les engager à la pren--
dre, que de leur en démontrer la néceffité. Mais c’eft:
là le difficile. La nation françoise eft peu fenfible en
mufique, & c’eft ici une vérité de fentiment plutôt
qu’un objet de démonftration. Quand Metaflafe
eut calculé les avantages de cette méthode & l’eut
nvife en pratique, l’oreille délicate des composteurs
italiens la conçut auflitôt. On s’aperçut d'ailleurs
de la différence qu’apportoient clans la mélodie des
mêmes compoftteurs , les paroles d'Apoftolo Zeno „
& celles du jeune Metaflafe ; on ne fit bientôt plus
d’airs que dans la forme introduite par ce dernier.
Mais en France , on ne peut efpérer une reforme aufli
rapide. La plupart des mufteiens eux-mêmes, ne
connoiffent pas le mérite de cette régu'arité ; ils
prétendent qu’elle réfroid t leur imagination, & ne
leur infpire pas des idées affez variées, parce qu’en
effet, peu accoutumés à concevoir un morceau d’un
feul je t, ils en coûfent péniblement les phrafes les
1 unes après les autres, & ne favent pas trouver clans leur génie affez de reffources, pour conferver
cette unité de mélodie tant recommandée par Rouf»
feau. Mais qu’il s’élève un homme d’un véritable ta-*
Ddd ij