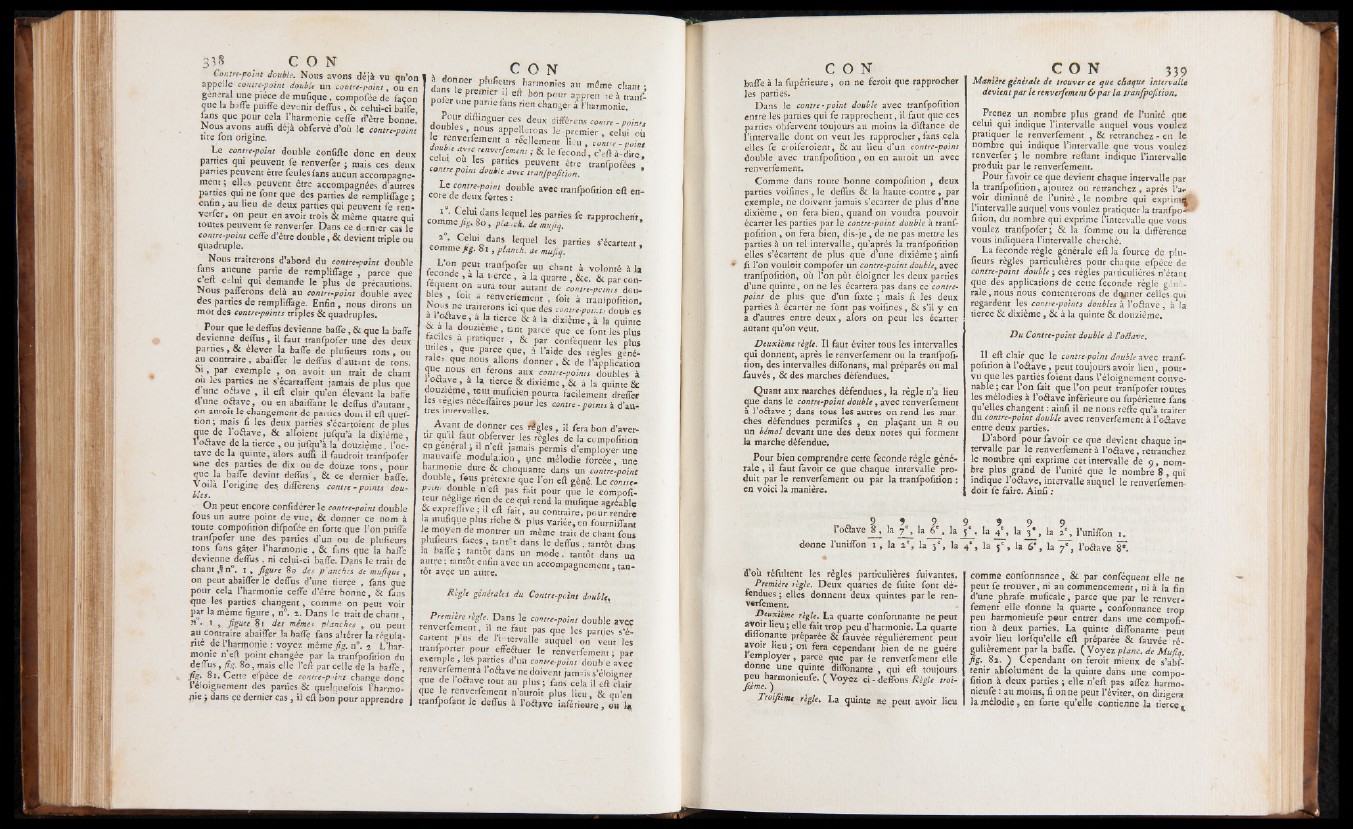
3^8 C O N
Contre-point double. Nous avons déjà vu qu’on
appelle contre-point double un contre-point, ou en
général une pièce de mufique, compofée de façon
que la baffe puifle devenir defful, & celui-ci baffe
fans que pour cela l’harmonie ceffe d’être bonne!
Nous avons auflî déjà obfervé d’où le contre-point
tire ion origine. r
Le contre-point double confiée donc en deux
parties qui peuvent fe renverfer ; mais ces deux
parues peuvent être feules fans aucun accompagne-
ment ; elles peuvent être accompagnées d’autres
parties qui ne font que des parties de rempliflage ;
enfin, au lieu de deux parties qui peuvent fe renverfer,
on peut en avoir trois «même quatre qui
toutes peuvent fe renverfer Dans ce dernier cas le
contre-point ceffe d’être double, & devient triple ou
quadruple. r
Nous traiterons d’abord du contrepoint double
fans aucune partie de rempliflage , parce que
c en c<fluj qui demande le plus, de précautions.
Nous paflerons delà au contre-point double avec
des parties de rempliffage. Enfin , nous dirons un
mot des contre-points triples & quadruples*
Pour que le deflus devienne baffe, & que la baffe
devienne deflus, il faut tranfpofer une des deux '
parties, & elever la baffe de pluficurs tons , ou
au contraire, abaiffer le deflus d’autant de tons.
S i , par exemple , on avoit un trait de chant
ou les parties ne s’écartaffent jamais de plus que
d une oâave , il eft clair qu’en élevant la baffe
d’une o â a v e , ou en abaiffant le deflus d’autant,
qn auroit le changement de parties dont il efl question;
mais fi les deux parties s’ écartoiem deplus
fjue de l’o â a v e , & alloient jufqu’à la dixi ème, .
1 oâave de la tierce , ou jufqu’à la douzième, l’oc-
a v e de la quinte, alors auffi il faudrait tranfpofer
une des parties de dix ou de douze tons, pour
que la baffe devint deffus', & ce dernier baffe.
Voilà l ’originç des différens contre- points doubles.
On peut encore conflderer le contre-point double
fous un autre point de vue, & donner ce nom à
toute compofidon difpofée en forte que l’on puiffe
tranfpofer une des parties d’un ou de plufieurs
tons fans gâter l’harmonie , & fans que la baffe
devienne^deffus , ni celui-ci baffe. Dans le trait de
chant ,5 n°, i , figure 80 des p 'anches de mufique ,
on peut abaiffer le deffus d’une tierce , fans que
pour cela l’harmonie ceffe d’être bonne, & fans
que les parties changent, comme on peut voir
par la même figure , n°. z. Dans le trait de chant,
n • I , figuic.Qi des mêmes planches , ou peut
au contraire abaiffer la baffe fans altérer la régularité
de l’harmoqie : voyez même fig. n°. 2 L ’harmonie
n’eft point changée par la tranfpofition du
deffus , fig 80, mais elle l’eft par celle de la baffe,
fig. 81. Cette efpèce de contre-p ônt change donc
l’éloignement des parties & quelquefois l ’barmo-
pie ; dans çe dernier c a s , il eft bon’pour apprendre
. * c O N
à donner plufieurs harmonies au même chant •
dans le premier il eft bon pour appren ie à tranfpofer
une parue fans rien changer à^l’harmonie.
. f?,ur m i " SUer Ces de"x différens contre - points
doubles nous appel, erons Je premier, « lu i où
le renverfeme.it a réellement lien , contre - point
r‘ nvtrf ‘? lmt ■’ & le fécond, c’eft-à-dite,
celut ou les parties peuvent être tranfpofées ,
contre point double avec tranfpofition. • ’
corLeVe7eru Æ is d:°‘lble aV*C ,ranfPofiti° n » »
comm5 f-1UQdanS !equ,el les comme fig. 80, plar.ck. de mPuafriqr.ies fe rapprochent,
rcoommm’meC ftifglm. 8s 1d a, npSlia nlechcl.u deel mleusfi qp. arties s’écartent,
W m Ê * tranfpofer un chant à volonté à la
fécondé , a la tierce , à la quarte , &c. & par con-
quent on aura tout autant de contre-pemts dou-
_es , oit a renverfement , foit à tranlpofition,
Wous ne traiterons ici que des contrepoints,doub es
a l o ô a v e , a la tterce & à la dixième , à la quinte
« a la douzième , tant parce que ce font les plus
faciles a pratiquer , & par conféqueut les plus
unies , que parce que, à l’aide des tègles générale,
que nous allons donner, & de l’application
que nous en ferons aux contre-points doubles à
1 octave, a la tierce « dixième, & à la quinte fit
douzième, tout muficien pourra facilement dreffer
les réglés neceffaires pour les contre -points à d’autres
intervalles.
Avant de donner ces règles, il fera bon d’aver-
tir qui} faut obferver les règles de la compofition
ep general; il n eft jamais permis d'employer une
mauvaise modulation , une mélodie forcée une
narmpnte dure & choquante darçs un contre-point
double , feus prétexte que l’on eft gêné. Le contic-
potm double n’eft pas fait pour que le eompofi-
teur négligé rien de ce qui rend la mufique agréable
& expreffive j il eft fait, au contraire, pour rendre
a mufique plus riche & plus variée, en fourniffant
le moyen de montrer un même trait de chant fous
plufieurs faces tantôt dans le deffus , tantôt dans
la baffe ; tantôt dans un mode, tantôt dans ua
autre ; tantôt enfin avec un accompagnement tantôt
avçc un autre.
Règle générales du Contre-point double.
Première règle. Dans le contre-point double avec
renverfement ü ne faut pas que les parties s’écartent
pus de In tervalle auquel on veut les
tranfporter pour effeétuer le renverfement : par
exemple , les parties d’un contre-point doub e avec
renverfement a l’oétave ne doivent jamais s’éloigner
que de 1 oôave tout au plus ; fans cela il eft Clair
que le renverfement n’auroit plus lieu, & qu’en
tranfpofant le deffus à l’oflgve inférieure, ou 1*
C O N
baffe à la fupérieure, on ne ferait que rapprocher
les parties.
Dans le contre-point double avec tranfpofition
entre les parties qui fe rapprochent, il faut que ces
parties obfervent toujours au moins la diftance de
l ’intervalle dont on veut les rapprocher, fans cela
elles fe croiferoienr, & au lieu d’un contre-point
double avec tranfpofition, on en auroit un avec
renverfement.
Comme dans toute bonne compofition , deux
parties voifines , le deflus & la haute-contre, par
exemple, ne doivent jamais s’écarter de plus d’ûne
dixième, on fera bien, quand on voudra pouvoir
écarter les parties par Je contre-point double à tranfpofition
, on fera bien, dis-je , de ne pas mettre les
parties à un tel intervalle, qu’après la tranfpofition
elles s’écartent de plus que d une dixième ; ainfi
fi l’on vouloit compofer un contre-point double, avec
tranfpofition, où l’on pût éloigner les deux parties
d’une quinte, on ne les écartera pas dans ce contrepoint
de plus que d’un fixte ; mais fi les deux
parties à écarter ne font pas voifines, & s’il y en
a d’autres entre deux, alors on peut les écarter
autant qu’on veut.
Deuxième règle. Il faut éviter tous les intervalles
qui donnent, après le renverfement ou la tranfpofition,
des intervalles diflonans, mal préparés ou mal
iauvés , & des marches défendues.
Quant aux marches défendues, la règle n’a lieu
que dans le contre-point double, avec renverfement
à l’oâave ; dans tous les autres on rend les marches
défendues permifes , en plaçant un # ou
un bémol devant une des deux notes qui forment
la marche défendue.
Pour bien comprendre cette fécondé règle générale
, il faut favoir ce que chaque intervalle produit
par le renverfement ou par la tranfpofition :
en voici la manière.
C O N 339
Manière générale de trouver ce que chaque intervalle
devient par le renverfement & par la tranfpofition.
Prenez un nombre plus grand de l’unité que
celui qui indique l’intervalle auquel vous voulez
pratiquer le renverfement , & retranchez - en le
nombre qui indique l’intervalle que vous voulez
renvérfer ; le nombre reflant indique l’intervalle
produit par le renverfement.
Pour lavoir ce que devient chaque intervalle par
la tranfpofition, ajoutez ou retranchez, après l’a«*
voir diminué de l’unité, le nombre qui exprime
l’intervalle auquel vous voulez pratiquer la tranfpojl
fition, du nombre qui exprime l’intervalle que vous
voulez tranfpofer; & la fomme ou la différence
vous indiquera l’intervalle cherché.
La fécondé régie générale efl: la fource de plusieurs
règles particulières pour chaque efpèce de
contre-point double ; ces règles particulières n’étant
que des applications de cette fécondé réglé générale,
nous nous contenterons de dqpner celles qui
regardent les contre-points doubles à l’oâave à la
tierce & dixième, & à la quinte & douzième.
Du Contre-point double à loEtave.
Il eft clair que le contre-point double avec tranfpofition
à l’o â a v e , peut toujours avoir lieu, pourvu
aue les parties foient dans l’éloignement convenable
; car l’on fait que l’on peut tranfpofer toutes
les mélodies à l’oâave inférieure ou fupérieure fans
qu’elles changent : ainfi il ne nous refte qu’à traiter
du contre-point double avec renverfement à l ’oâave
entre deux parties.
D abord pour favoir ce que devient chaque intervalle
par le renverfement à l’o â a v e , retranchez
le nombre qni exprime cet intervalle de 9 , nombre
plus grand de l’unité que le nombre 8 , qui
indique l’oâave, intervalle auquel le renyerfemen-
doit fe faire. Ainfi ;
9 9 9
l’ oâave 8 , la 7 e, la 6e , la
donne Tuniflon 1 , la 2% la 3% la
d’où réfultent les règles particulières fui vantes.
Première îègle. Deux quartes de fuite font défendues
; elles donnent deux quintes par le renverfement.
Deuxième règle. La quarte confonnante ne peut
avoir lieu ; elle fait trop peu d’harmonie. La quarte
diflonante préparée & fauvée régulièrement peut
avoir lieu ; on fera cependant bien de ne guère
remployer, parce que par le renverfement elle
donne une quinte diflbnante , qui eft toujours
peu harmonieufe. (V o y e z ci - deflbus Règle troifisme.
) 0
Troifime réglé. La guinte ne peut avoir lieu
i | ta 4% ta 3 * , la 2e, l’uniflon 1.
1* > ta 5e , ta 6 * , la 7 e , l ’oâave 8*.
comme confonnance, & par conféquent elle ne
peut fe trouver, ni au commencement, ni à la fin
d’une phrafe muficale, parce que par le renverfement
elle donne la quarte , confonnance trop
peu harmonieufe peur entrer dans une compofition
à deux parties. La quinte diflbnante peut
avoir lieu lorfqu’elle eft préparée & fauvée régulièrement
par la baffe. (V o y e z plane, de Mufiq.
fig. 82. ) Cependant on feroit mieux de s’abf-
tenir abfolument de la quinte dahs une compofition
à deux parties ; elle n’eft pas aflez harmonieufe
: au moins, fi on ne peut l’éviter, on dirigera
la mélodie, en forte qu’elle contienne la tierce.