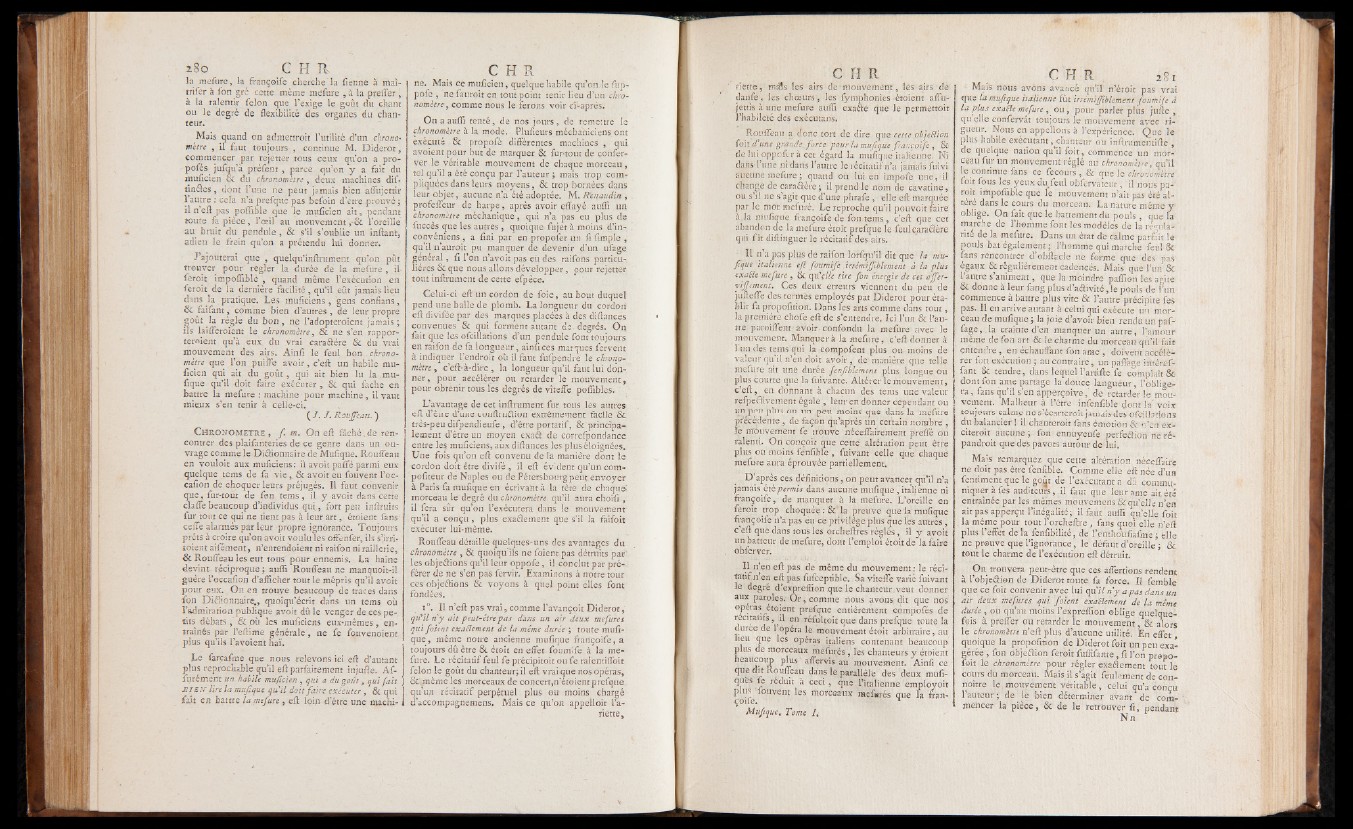
la mefure, la françoife cherche la fienne à niaî-
trifer à Ion gré cette même mefure , à la prefîer ,
à la ralentir félon que l’exige le goût du chant
ou le degré de flexibilité des organes du chanteur.
Mais quand on admettroit l’utilité d’un chronomètre
, il faut toujours , continue M. Diderot,
commencer par rejetter tous ceux qu’on a pro-
pofés jufqu’à préfent , parce qu’on y a fait du
muflcien & du chronomètre -, deux machines dif-
tinéles, dont l’une ne peut jamais bien aflujettir
l ’autre : cela n’a prefque pas befoin d’ëtre prouvé ;
il n’eft pas poffible que le muflcien ait, pendant
toute fa pièce, l'oeil au mouvement l’oreille
au bruit du pendule, & s’il s’oublie un inftanr,
adieu le frein qu’on a prétendu lui donner.
J’ajouterai que , quelqu’inftrument qu’on pût
trouver pour regler la durée de la mefure, il-
feroit impofliblè , quand même l’exécution en
feroit de la dernière facilité, qu’il eût jamais lieu
dans la pratique. Les muflciens , gens confians,
& faifant, comme bien d’autres, de leur propre
goût la règle du bon , ne Padopteroient jamais ;
ils laifleroient le chronomètre, & ne s’en rappor-
teroient qu’à eux du vrai cara&ère 8c du vrai
mouvement des airs. Ainfl le feul bon . chronomètre
que l’on puilfe avoir, c’eft un habile musicien
qui ait. du goût , qui ait bien lu la mu-
fique qu’il doit faire exécuter , 8c qui fâche en
battre la mefure : machine pour machine, il vaut
mieux s’en tenir à celle-ci..
( J. J. Roujfeau. )
C hronométré , f . m. On eft fâché; de rencontrer
des plaifanteries de ce genre dans un ouvrage
comme le Diélionnaire de Muflque. Roufleau
en vouloit aux muflciens : il avoir paffé parmi eux
quelque tems de fa v i e & avoir eu fouvent l’oc-
cafion de choquer leurs préjugés. Il faut convenir
que, fur-tout de fon tems, il y avoir dans cette
cia ffe beaucoup d’individus qui,, fort peu inflruits
fur tout ce qui ne tient pas à leur art, étoient fans'
celle alarmés par leur -propre ignorance. Toujours
prêts à croire qu’on avoit voulu les oôènfer, ils s’irri-
îoiënt aifément, n’entenàoieat ni raifon ni raillerie,
& Roufleau les eut tous pour ennemis. La haine
devint réciproque ; aufli Roufleau ne manquoit-il
guère Poccaflon d’afficher tout le mépris qu’il avoit
pour eux. On en trouye beaucoup de traces dans
lpn Didhon naire., quoiqu’écrit dans un tems où I
l’admiration publique ^voit dû le venger de ces petits
débats , 8c où les muflciens eux-mêmes , ’ entraînés
par l’eftime générale', ne fe fouvenoient
plus qu’ils l’avoient haï.
JLe farçafme que nous relevons ici eft d’autant
plus reprochable qu’il eft parfaitement injufte. Af-
furément un habile muflcien, qui a du goût} qui fait j
B I E N lire la muflque quiil doit faire, exécuter , 8c qui J
fait eu battre la mefure , efl loin d’être une ujachi- 1
ne. Mais ce muflcien, quelque habile qu’onde fup-
pofe , ne fauroit en tout point tenir lieu d’un chronomètre
, comme nous le ferons voir diaprés.
On a aufli tenté, de nos jours, de remettre le
chronomètre à la mode. Plufieurs mécbàhiciens ont
exécuté 8c propofé différentes machines , qui
avoient pour but de marquer 8c fur-tout de çonfer-
ver le véritable mouvement de chaque morceau,
tel qu’il a été conçu par l’auteur ; mais trop compliquées
dans leurs moyens, 8c trop bornées dans
leur objet, aucune n’à été adoptée. M. Renaudin ,
profefleur de harpe, après avoir effayé aufli un
chronomètre méchaniqùe, qui n’a pas eu plus de
fuccès que les autres , quoique- fujet à moins d’in-
convéniens , a fini par en propofer un fl Ample ,
qu’il n’auroit pu manquer de devenir d’un ufage
général, fi l’on n’avoit pas eli des. raiforts particulières
8c que nous allons développer, pour rejetter
tout inftrument de cette efpèce.
Celui-ci efl: un cordon de foie, au bout duquel
pend une balle de plomb. La longueur du cordon
efl divifée par des marques placées à des diflances
convenues 8c qui forment autant de, degrés. On
fait que les ofcillations d’un pendule font toujours
en raifon de fa longueur, ainfl ces marques fervent
à indiquer l’endroit ou il faut fufpendre le chronomètre
> c’efl-à-dire, la longueur qu’il faut lui donner,
pour accélérer ou retarder le mouvement,
pour obtenir tous les degrés de vîtefle poflibles.
L’avantage de cet inftrument fur tous les autres
efl d’être d’une conftru&ion extrêmement facile 8c
très-peu difpendieufe , d’être portatif , 8c principalement
d’être un moyen exaét de correfpondance
entre les, muflciens, aux diflances les plus éloignées.
Une fois qu’on efl convenu de la manière dont le
cordon doit être divifé., il efl évident qu’un com-
poflteur de Naples ou de Pétersbourg peut, envoyer
à Paris fa muflque en écrivant à la tête de chaque*'
morceau le degré du chronomètre qu’il aura choifi ,
il fera sûr qu’on l’exécutera dans le mouvement
qu’il a conçu, plus exaâement que s’il la faifoit
exécuter lui-même.
Roufleau détaille quelques-uns des avantages du
chronomètre , 8c quoiqu’ils ne foient pas détruits par
les objeéHons qu’il leur oppofe, il conclut par préférer
de ne s’en pas fervih Examinons à notre tour
ces objeéHons 8c voyons à quel point elles font
fondées.
i°. Il n’eft pas vrai, comme l’avançoit Diderot,
qu'il n'y ait peut-être pas dans un air deux mefures
qui foient exactement de la même durée ; toute mufi-
que, même notre ancienne mufique françoife, a
toujours dû être 8c étoit en effet foumîfe à la mefure.
Le récitatif feul fe précipitoit ou fe ralentiffoit
félon le goût du chanteur; il efl vrai que nos opéras,
8ccmêmeles morceaux de concert,n’étoienr prefque
qu’un récitatif perpétuel plus ou moins chargé
d’açcompagnemens. Mais ce qu’on appeüoit l’ariette,
C H R
fiette, mâîs les airs de mouvement, les airs de
daiifé, les choeurs, les fymphonies étoient afîu-
jettis à une mefure aufli exaSe que le pefmettoit
l ’habileté des exécutans.
Roufleau a . donc tort de dire que cetieobjeRion
fond une grande, force pour la mufique françoife , 8c
de lui oppofer à cet -égard la mufique italienne. Ni
dansTune ni dans l ’autre le récitatif n’a jamais fuivi
aucune mefure ; quand on lui en impofe une', il
change de caraûère ; il prend le nom de cavatine,
ou s’il ne s’agit que d’une phrafe, elle efl marquée
par le mot mefuré. Le reproche qu’il pouvoit faire
à .la mufique françoife de fon tems , c’eft que cet
abandon de la mefure étoit prefque le feul cara61ère
qui fît diflinguer le récitatif des airs.
Il n’a pas plus de raifon lorfgii’il dit que la mufique
italienne efl foümife irrénûfjiblement à la plus
exalte mefure , 8c qu'elle tire fon énergie de cet a'ffer-
•viffement. Ces deux erreurs viennent du peu de
juflefle des termes employés par .Diderot pour établir
fa propofition. Dans les arts comme dans tout,
la première chofe efl de s’entendre. Ici l’un 8c l’autre
paroiflent avoir confondu la mefure avec le
mouvement. Manquer à la mefure , c’efl donner à
1 un des tems qui la éompofent plus ou-moins de
valeur qu’il n’en doit avoir, de-manière que telle
mefure ait une durée fenfifleinent plus longue ou
plus courte que la fuivante. Altérer le mouvement,
c ’e f l, en donnant à chacun des tems une valeur
relpeélivement égale , leur en donner cependant ou
un peu plus ou un peu moins que dans la mefure
précédente , de façon cju’après un certain nombre ,
le mouvement fe trouve nécefîairement prefle ou
ralenti. On conçoit que cette, altération peut, être
plus ou moins fénfible , fuivant celle que chaque
mefure aura éprouvée partiellement.
D ’après ces définitions, on peut avancer qu’il n’a
jamais été permis dans aucune mufique, italienne ni
françoife, de manquer à la mefure. L’oreille en
feroit trop choquée : 8c la preuve que la mufique
françoife n’a pas eu ce privilège plus que f e autres,
c ’efl que dans tous les orcheflres réglés, il y avoit
un batteur de mefure, dont l’emploi étoit de la faire
obferver.
I l n’en efl pas de même du mouvement : le récitatif
n’en efl pas fufceptible, Sa vîtefle varié fuivant
le degré d1 èxpreflion que le chanteur.veut donner
aux paroles. O r , comme nous avons dit que nos
opéras étoient prefque entièrement cômpofés de
récitatifs, il en réfultoit que dans prefque toute la
duree de 1 opéra le mouvement étoit arbitraire, au
lieu que les opéras italiens contenant beaucoup
plus de morceaux mefürés, les chanteurs y étoient
beaucoup plus affervis au mouvement. Ainfi .ce
que dit Roufleau dans le parallèle des deux mufi-
quès fe réduit à c e c i, que l’italienne employoit
plus fouvent les morceaux mef«rés que la fran-
çoifé. 1
Mufique, Tome 7.
Mais nous avons avancé qu'il n'étoit pas vrai
que la mufique italienne fût irrimijjiblement fourni/e à
la plus exaSe mefure, ou , pour parler plus jufte ,
qu elle confervat toujours le mouvement avec rigueur.
Nous en appelions à l’expérience. Que le
plus habile exécutant, chanteur ou inftrumentifte ,
de quelque nation qu’il foit, commence un morceau
fur un mouvement réglé au chronométré, qu’il
le continue fans ce fecours , & que le chronomètre
foit fous les yeux du.feul obfcrvateur, il nous pa-‘
roît impoflibie que le mouvement n’ait pas été al-
téié dans le cours du morceau. La nature même y
oblige. On fait que le battement du pouls , que la
marche de l ’homme font les modèles de la régularité
de la mefure; Dans un état de calme parfait le
pouls bat également ; l’homme qui marche feul 8c
fans rencontrer d’obflacle ne forme que des pas',
égaux & régulièrement cadencés. Mais que l’un &
l’autre s’animent, que la moindre paffion les agite
& donne à leur fang plus d’aélivité, le pouls de l’un
commence à battre plus vite & l ’autre précipite fes
pas. Il en arrive autant à celui qui exécute un morceau
de mufique ; la joie d’avoir bien rendu un paf-
fage, .la crainte d’en manquer un autre, l’amour
même de fon art & le charme du morceau qu’il fait
entendre , en échauffant fon a nie', doivent accélé-.
ter fon execution ; au contraire, un pafîage intéref-
fant & tendre, dans lequell’artifte fe complaît &■
dont fon aine partage la douce langueur, l’obligera
,. fans qu’il s’en apperçoive,' de retarder le mouvement.
Malheur à l’être infenfible dont la" voix
toujours calme në s'écarterait jamais des ôfrilb ti'ons
du balancier ! il chanterait fans émotion & n’en exciterait
aucune; fon ennuyeüfe perfeâion ne répandrait
que des pavots'autour de lui.
Mais remarquez que cette altération nécèffaire
ne doit pas être fenfible. Comme elle efl née d’un
fentiment que le goût de l’exécutant a dû. communiquer
à fes auditeurs, il faut que leur a nie ait. été
entraînée par les mêmes mouvemens &qujélle n’en
ait pas apperçu l’inégalité;' il faut aufli quelle foit
. la même pour tout l’orcheftre fans quoi'elle n’eft
plus l’effet delà fenfibilité, de renthoiifiafme ; elle
ne prouve que l’ignorance, le défaut d’oreilie ; &
tout le charme de l’exécution efl détruit.
On trouvera peut-être que ces aflertions rendent
à l’objeflisn de Diderot toute fa force. Il femble
que ce foit convenir avec lui qu’il n’y a pas dans un
air deux mefures qui foient exactement de la même
durée , .où qu’au moins l’expreflîon oblige quelquefois
à preffer ou retarder le mouvement, & alors
le chronomètre n’eft plus d’aucune utilité. En effet
quoique la propofition de Diderot foit un peu exagérée
, fon objeflion feroit fufKfante, fi l’on prepo-
foit le chronomètre pour régler exaftement tout le
cours du morceau. Mais il s’agit feulement de con-
noître le mouvement véritable, celui qu’a conçu
l’auteur ; de le bien déterminer avant de commencer
la pièce, & de le retrouver fi, pendant