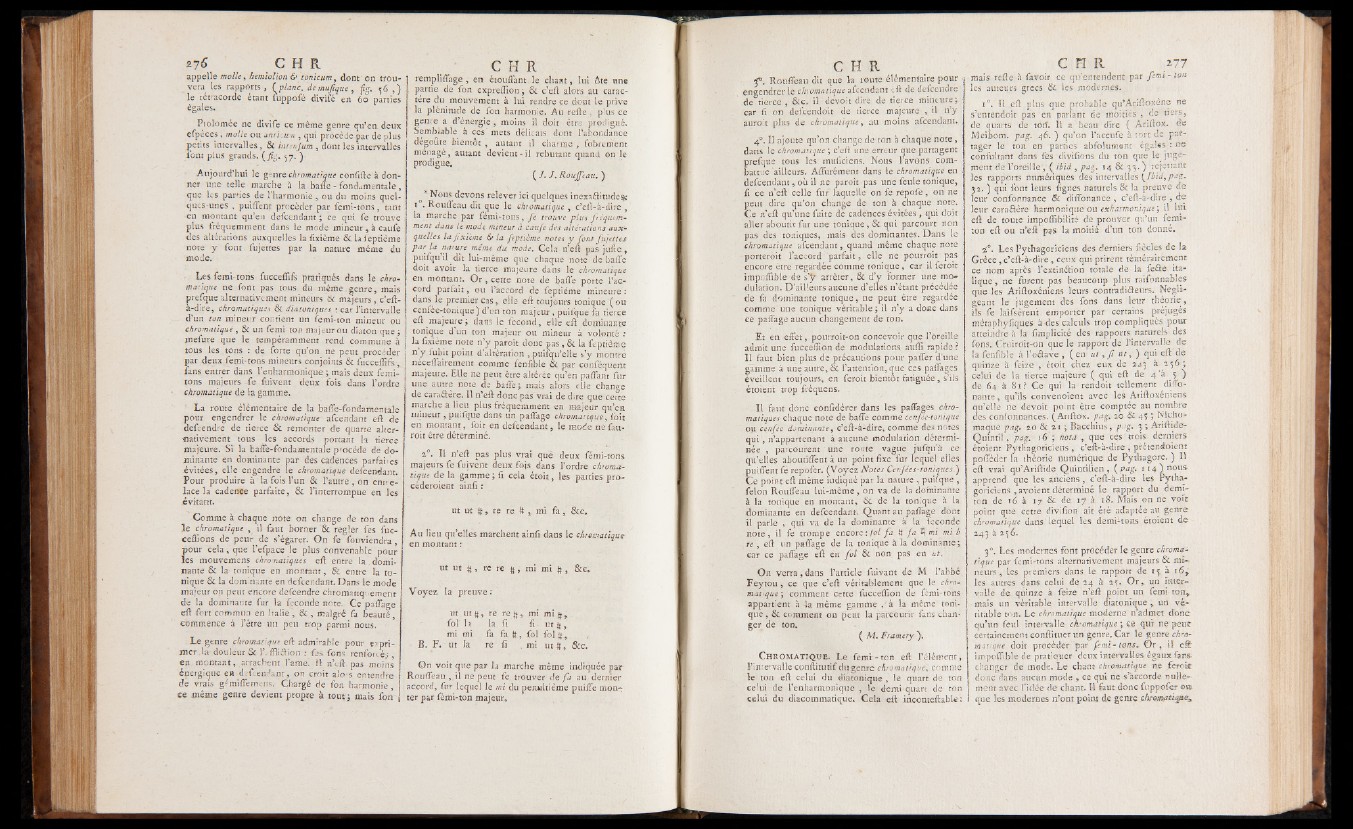
Z7 & C H R
appelle molle, hemiotion 6* tonicum, dont on trouvera
les rapports , (plane, de mujîque , fg. 56 , )
le tétracorde étant luppofé divifé en 60 parties
égales.
Ptolomée ne divife ce même genre qu’ en deux
efpèces , molle ou anticum , qui procède.par de plus
petits intervalles, & intenjum , dont les intervalles
font plus grands. |jfg. 57. )
Aujourd’hui le genre chromatique confifte à donner
une telle marche à la baffe - fondamentale,
que les parues de l’harmonie, ou du moins quelques
unes , puiffent procéder par femi-tons, tant
en montant qu’en defeendant ; ce qui fe trouve
plus fréquemment dans le mode mineur, à caufe
des altérations auxquelles la lixième & la feptième
note y font fu jettes par la nature même du
mode.
Les femi tons fucceflifs pratiqués dans le chro-
ma tique ne font pas tous du même.genre, mais
prefque alternativement mineurs & majeurs, c’eft-
a-dire, chromatiques & diatoniques * car l’intervalle
d’un ton mineur contient un fe mi-ton mineur ou
chromatiqué , & un femi ton majeur ou diaton que ;
mefure que le tempéramment rend commune à
tous les tons : de forte qu’on ne peut procéder
par deux femi-tons mineurs conjoints & fucceffïfs,
fans entrer dans l’enharmonique ; mais deux femi-
tons majeurs fe fuivent deux fois dans l’ordre
chromatique de la gamme.
La route élémentaire de la baffe-fondamentale
pour engendrer le chromatique afeendant eft de
defeendre de tierce & remonter de quarte alternativement
tous les accords portant la tierce
majeure. St la baffe-fondamentale procède de dominante
en dominante par des cadences parfaites
évitées, elle engendre le chromatique defeendant. ;
Pour produire à la fois l’un & l’autre, on entre- •
lace la cadence parfaite, 8c l’interrompue en les j
.évitant.
Comme à chaque note on change de ton dans
le chromatique , il faut borner & regîer fes fuc-
ceflions de peur de s’égarer. On fe fouviendra,
pour ce la , que l’efpace le plus convenable pour
les mouvemens chromatiques eff entre la,dominante
& la tonique en montant, & entre la tonique
8c la dominante en defeendant. Dans le mode
majeur on peut encore defeendre chromatiq'.ement
de la dominante fur la fécondé note. Ce paffage
eff fort commun en Italie , 8c, malgré fa beauté,
commence à l’être un peu trop parmi nous.
Le genre chromatique eff admirable pour exprimer
.la douleur & l’.ffliéïion : fes fons renforcé;,
en montant, arrachent lame. Il n’eft pas moins I
énergique en defeendant, on croit alo'S entendre: I
de vrais gémiffemens. Chargé de fon harmonie
ce même genre devient propre à tout ; mais fon {
C H R
rempliffage, en étouffant le chant, lui ôte une
partie de fon expreflîon ; & c’eft alors au caractère
du mouvement à lui rendre ce dont le prive
la plénitude de fon harmonie. Au reffe, plus ce
genre a d’énergie, moins il doit être prodigué.
Semblable à ces mets délicats dont l’abondance
dégoûte bientôt , autant il charme , fobrement
ménagé, autant devient - il rebutant quand on le
prodigue.
( J. J . Rouffeau. )
* Nous devons relever ici quelques inexactitudes^
1 . Rouffeau dit que le chromatique , c’eft-à-dire ,
la marche par fémi-tons, fe trouve plus fréquemment
dans le mode mineur a caufe des altérations auxquelles
lajixieme 6* la feptième notes y font fujettes
par la nature même du mode. Cela n’eff pas juffe,
puifqu il dit lui-même que chaque note de baffe
doit avoir la tierce majeure dans le chromatique
en montant. O r , cette note de baffe porte l’accord
parfait, ou l’accord de feptième mineure :
dans le premier cas, elle eff toujours tonique ( ou
cenfee-toniq.ue) d’un ton majeur, pùifque fa tierce
eff majeure j dans le fécond, elle eff dominante
tonique d un ton majeur ou mineur à volonté •
la fixième note n’y paroît donc pas, & la feptième
n’y fubi.t point d’altération , puifqu’elle s’y montré
néceffairement comme fenffble & par conféquent
majeure. Elle ne peut être altérée qu’en paffant fur
une autre note de baffe.; mais alors elle change
de caraâère. 11 n’eff donc pas vrai de dire que cette
marche a lieu plus fréquemment en majeur qu’en
mineur , puifque dans un paffage chromatique, foit
en montant, foit en defeendant, le mode ne fau-
roit être déterminé.
2.0. Il n’eff pas plus vrai que deux fémi-tons
majeurs fe fuivent deux fois dans l’ordre chromatique
de la gamme; fi cela étoit, les parties pro-
céderoient ainfi :
ut ut # , re re # a mi f a , & c .
Au lieu qu’elles marchent ainfi dans le chromatique
en montant :
ut ut # , re re # , mi mi # , &€.
Vo yez la preuve:
ut ut# , re re#,.. mi mi#,;
fol la la fi fi • ut #,
mi mi fa fa # , fol fol # ,,
B. F. ut la re fi . mi u t# , &c.
On voit que par la marche même indiquée par
Rouffeau,, il ne peut fe, trouver de fa au, dernier
accord, fur lequel le mi du pénultième purifie mon-
ter par fémi-ton majeur.
C H R
Rouffeau dit que k route élémentaire pour
engendrer le chromatique afeendant eff de defeendre
de tierce , &c. il devoit dire de tierce mineure ; :
car ff on defeendoit de tierce majeure , il n’y
auroit plus de chromatique, au moins afeendant.
40. Il ajoute qu’on change de ton à chaque note,
dans le chromatique", c’eff une erreur que partagent
prefque tous les muffeiens. Nous l’avons combattue
ailleurs. Affurément dans le chromatique en
defeendant, où il ne paroît pas une feule tonique,
fi ce n’eft celle fur laquelle on fe repofe, on ne
peut dire qu’on change de ton à chaque note.
Ce n’eft qu’une fuite de cadehces évitées, qui doit
aller aboutir fur une tonique , & qui parcourt non
pas des toniques, mais des dominantes. Dans le
chromatique afeendant, quand même chaque note
porterôit l’accord parfait, elle ne pourroit pas
encore être regardée comme tonique , car il feroit
impcffible de s’ÿ arrêter, & d’y former une modulation.
D ’ailleurs aucune d’elles n’étant précédée
de fa dominante tonique , ne peut être regardée
comme une tonique véritable; il n’y a doue dans
ce paffage aucun changement de ton.
Et en effet, pourroit-on concevoir que l’oreille
admît une fucceffion de modulations aufîi rapide ?
11 faut bien plus de précautions pour paffer d’une
gamme à une autre, 8c l’attention, que ces paffag.es
éveillent toujours, en feroit bientôt fatiguée , s’ils I
étoient trop fréquens.
Il faut donc cônfidérer dans les paffages chromatiques
chaque note de baffe comme cenfée-tonique
ou cenfie dominante, c’eff-à-dire, comme des' notes
q u i, n’appartenant à aucune modulation déterminée
, parcourent une route vague jufqu’à ce
qu’elles aboutiffent à un point fixe fur lequel elles
puiffent fè repofer. (Voyez Notes Ccnfées-toniques.)
Ce point eff même indiqué par la nature , puifque ,
félon Rouffeau lui-même, on va de la dorninante
à la tonique en montant, 8c de la tonique à la
dominante en defeendant. Quant au paffage dont
il parlé , qui va de la dominante à la fécondé
note , il fe trompe encore : fol fa # fa 4 mi mi b
re , eff un paffage de la tonique à la dominante;
car ce paffage eff en fo l 8c non pas en ut.
On verra , dans l’article fuîvant de M l’abbé.
F e y tou , ce que c’eft véritablement que le chromatique
; comment cette fucceffion de fémi-tons
appartient à 4a même gamme / a la même tonique
, 8c comment on peut la parcourir fans changer
de ton.
( M. Framery f
C hrom a tiq ue . Le femr-ton eff l’élément,
l’Intervalle conftitutif du genre chromatique, comme
le ton eff celui du diatonique , le quart de ton
celui de l’enharmonique , le demi quart de ton
celui du diacommatique. Cela eff inconteftabl«;
C H R 1 7 7
mais reffe à lavoir ce qu’entendent par femi - ton
les auteurs grecs 8c les modernes.
i° . Il eff plus que probable qu’Ariftoxène ne
s’enrendoit pas en parlant de moitiés , de tiers,
de quarts de ton. Il a beau dire ( Ariftox. de
Meibom. pag. 46. ) qu’on l’accufe à tort de partager
le ton en parties abfolument égales : n-e
confultant dans fes divifions du ton que le jugement
de l’oreille, ( ib id , p a o . 14 8c 33. ) remettant
les rapports numériques des intervalles { Ib id , pas:.
32. ) qui font leurs lignes naturels 8c la preuve de
leur confonnance 8c diffonance , c’eft-à-dire , de
leur caraâère harmonique o u exharmonique ; il lui
èft de toute impoflïbilité de prouver qu’un femr-
ton eff ou n’eft pas la moitié d’un ton donné.
2°. Les Pythagoriciens des derniers ficelés de la
Grèce , c’ eft-à-dire , ceux qui prirent témérairement
ce nom après l’extinâion totale de la feâ e italique
, ne furent pas beaucoup plus raifonnables
que les Ariftoxéniens leurs contradicteurs. Négligeant
le jugement des fons dans leur théorie,
ils fe laifsèren't emporter par certains préjugés
métaphyfiques à des calculs trop compliqués pour
atteindre à la fimplicité des rapports naturels des
fons. CroirOit-on que lé rapport de l’intervalle de
la fenfible à l’oéiave , (en u t , f i ut, ) qui eff de
quinze à feize , étoit chez eux de 2.43 à 256»
celui de la tierce majeure ( qui eff de 4 'à 5 )
de 64 à 81? Ce qui la rendoit tellement diffo-
nante, qu’ils convenoient avec les Ariftoxéniens
qu’elle ne devoit point être comptée au nombre
des confçnnances. (Ariftox. ■ pag, 20 8c 45 ; Nicho-
maque pag. 2 0 8c a i ; Bàcchius, pag. 3 ; Ariftide-
Quintil, pag. 16 ; nota , que ces trois derniers
étoient Pythagoriciens , c’eft-à-dire, prétendoient
pofféder la théorie numérique de Pythagore. ) Il
eff vrai qu’Ariftide Quintilien , ( pag. 114 ) nous
apprend que les anciens, c’eft-à-dire les Pythagoriciens
, a voient déterminé le rapport du demi-
ton de 16 à 17 8c de 17 à 18. Mais on ne voit
point que cetre divifion ait été adaptée au genre
chromatique dans' lequel les demi-tons, étoient de
243^256.
30. Les modernes font procéder le genre chroma*
tique par femi-tons alternativement majeurs 8c mineurs
, les premiers dans le rapport de 15, à 1
les autres dans celui de 24 à 25. O r , un intervalle
de quinze à feize n’eff point un femi-ton,
mais un véritable intervalle diatonique , un v é ritable
ton. Le chromatique moderne n’admet donc
qu’un feul intervalle chromatique ; ce qui ne peut
certainement eonftituer un genre. Car le genre chromatique
doit procéder par femi-tons. O r , il ef£
impoffib-le de pratiquer deux intervalles égaux fans
changer de mode. L e chant chromatique ne .feroit
donc dans aucun mode., ce qui ne s’accorde nullement
avec l’idée de chant. 11 faut donc fuppofe? ©va
que les modernes n’ont point de genre chromrtiqpe*