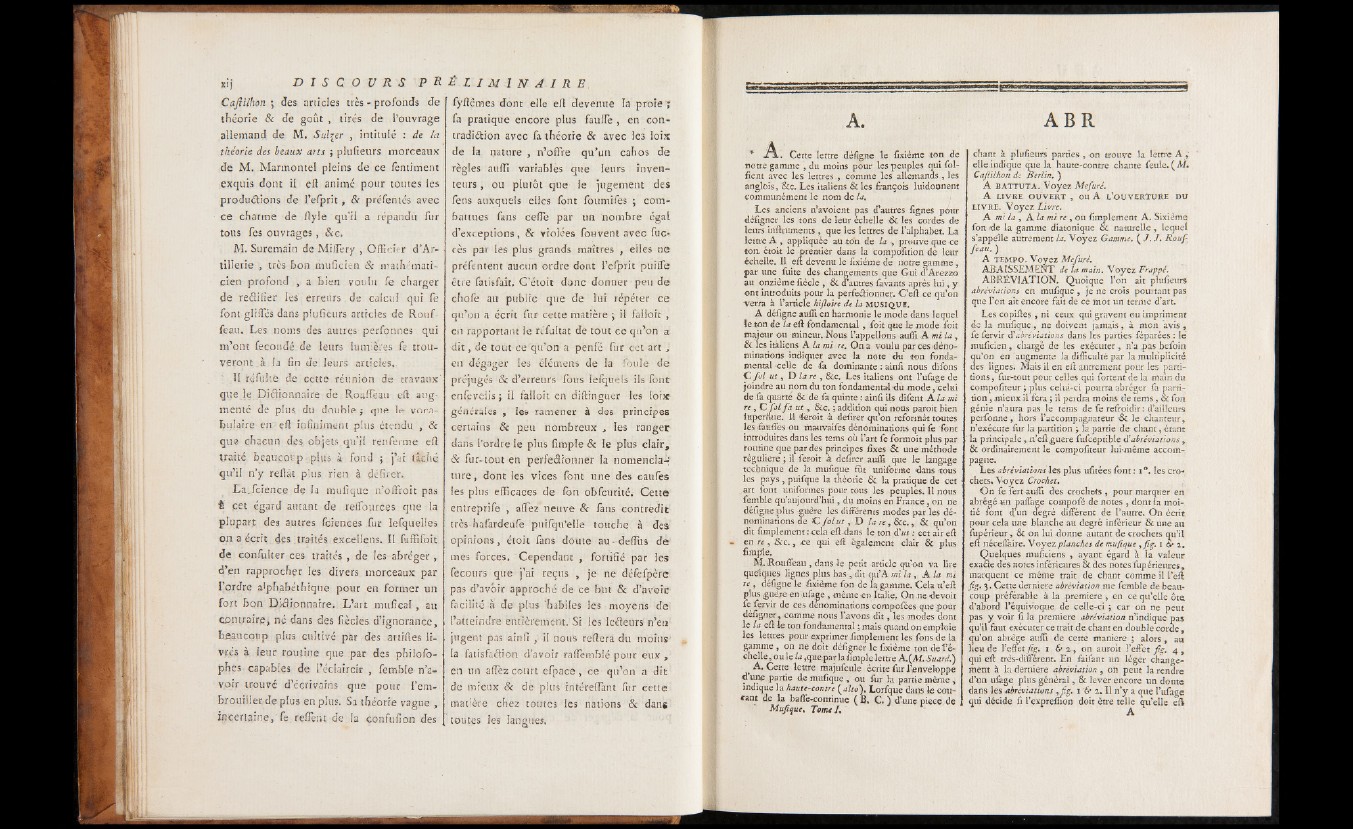
xij D I S C O U R S P R
Caftilhon ; des articles très - profonds de
théorie & de goût , tirés de l’ouvrage
allemand de M. Sulçer , intitulé : de la
théorie des beaux arts ; plufîeurs morceaux
de M. Marmontel pleins de ce lèntiment
exquis dont il eft animé pour toutes les
produirions de Fefprit, & préfentés avec
ce charme de flyle qu’il a répandit fur
tous fes ouvrages, &c.
M. Suremain de Miflèry , Officier d’Ar-
tillerie , très bon muficien & mathématicien
profond , a bien voulu fe charger
de re&ifiér lés erreurs de calcul qui fe
font giitî'és dans plufîeurs articles de Rottf-
feau. Les noms des autres perfonnes qui
m’ont fécondé de leurs lumières fe trouveront^
la fin de: leurs articles,.
Il réfulté de cette réunion de travaux
que le Diâionnaire de Roufteau eft augmenté
de plus, du double ; que le vocabulaire
en eft infiniment plus étendu , &
que chacun des objets.qu’il renferme eft
traité beaucoup plus à fond ; j’ai tâche
qu’il n’y reliât plus rien à délirer.
Eajcience dç la mufique n’offroit pas
■fe pet égard autant de reffources que la
plupart des autres fciences fur lefquelles
on a écrit fies traités, excellens. II fuffifoit
de confulter ces traités , de les abréger ,
d’en rapprocher les divers morceaux par
l’ordre alphabéthique pour en former un
fort bon Dîâionnaire. L ’art mufical, au
contrairej né dans des fiècles d’ignorance,
beiaucopp plus cultivé par des artiftes livrés
à leur routine que par des philofo-
phes capables de l’éclaircir , femble n’a-
voir trouvé d’écrivains que pour l’embrouiller
de plus en plus. Sa théorie vague ,
incertaine, fe reflètu de la confufion des
É L I M l N A I R E,
fyflêmes dont elle eft devenue la proie ;
fa pratique encore plus faulle , en con-
tradiâion avec fa théorie & avec les loix
de la nature , n’offre qu’un cahos de
règles auffi variables que leurs inventeurs
, ou plutôt que le jugement des
fens auxquels elles font fournîtes ; combattues
fans celle par un nombre égal
d’exceptions, & violées fouvent avec lue-
cès par les plus grands maîtres , elles ne
préfentent aucun ordre dont l’efprit puiffe
être fatisfait, C’étoit donc donner peu de
choie au public que de lui répéter ce
qu’on a écrit fur cette matière ; il falloir ,
en rapportant le réfultat détour ce qu’on 3
dit, de tout-ce"qu’on a penfé fur cet art ,
en dégager les étémens de la foule de
préjugés & d’erreurs fous lefquels ils font
enfeveiis ; il falloir en diftinguer les loix
générales , les ramener à des principes
certains & peu nombreux . les ranger
dans l’ordre le plus fimpie & le plus clair,
& fur-tout en perfeâionner la nomencia-;
titre, dont les vices font une des eaufês
les plus efficaces de Ion obfcurité. Cette
entreprife , allez" neuve & fans contredit
très-hafardeufe puilqu’elle touche à des
opinions, étoit fans doute au - deffus de
mes forces. Cependant , fortifié par les
fecours que j’ai reçus , je ne délëfpère
pas d’avoir approché de ce but & d'avoir
facilité à de plus 'habiles les moyens de
l’atteindre entièrement. Si les leéteurs n’en'
jugent pas ainfi , il nous reliera du moins-
la fatisfaâion d’avoir raffemblé pour eux ,
en un allez court efpace , ce qu’on a dit
de mieux & de- plus intérefiant fur cette
matière chez tontes les nations & dans
toutes les langues.
A. A B R
* À . Cette lettre défigne le fixième ton de
notre gamme , du moins pour les peuples qui fol-
fient avec les lettres ., comme les allemands, les
anglois, &c. Les italiens & les irançois luidoonent
communément le nom de la.
Les anciens n’avoient pas d’autres lignes pour
désigner les tons de leur échelle & les cordes de
leurs inftruments., que les lettres de l’alphabet. La
lettre A , appliquée ali to'n de la -, prouve que ce
ton. étok le -premier dans la composition de leur
échelle. Il eft devenu le fixième de notre gamme ,
par une fuite des changements que Gui d’Arezzo
au onzième fiècle , & a autres favants après lui , y
ont introduits pour la perfeâionner. C ’e ftce qu’on
Terra à l’article hifloïre de la MUSIQUI.
A défigne auffi en harmonie le inode dans lequel
ie.ton de /« eft fondamental , .foit que le mode foit
majeur ou mineur. Nous l’appelions auffi À mi la ,
& les italiens A la mi re. On a voulu parces<déno-
minations indiquer avec la note du ton fondamental
celle de fa dominante : ainfi nous difons
C fol u t , D lare , &c. Les italiens ont l’ufage de
joindre au nom du ton fondamental -du mode /celui
de fa quarté & de fa quinte : ainfi ils difent - A la mi
re ., C fol fa u t , & c. ; addition qui nous paroît bien
faperflue. 11 foroit à defirer quon reformât toutes
les fauffes ou mauvaifes dénominations qui fe font
introduites dans les tems où l’art fe formoit plus par
routine que par des principes fixes & une méthode
régulière ; il feroit sl defirer .auffi que le langage
technique de la mufique fût uniforme ffans tous
les pays, puifque la théorie & la pratique de cet
art font uniformes pour tous les peuples. 11 nous
femble qu’aujourd’hui, du moins en France, on ne
défigne plus guère les différents modes par les dénominations
de C fo l u t , D la re, & c . , & qu’on
dit fimplement: cela eft-dans le ton d’ut : cet air eft
en re ^ & c . , c e qui eft également clair & plus
fimpde.
M.jRouffeau , dans le petit article qu’on va lire
quelques lignes plus bas, dit qiï’A mi la , A la mi
te , défigne le fixième fon de la gamme. Cela n’eft
plus guère en ufa^e, même en Italie. On ne -devoir
fe fervir de ces dénominations compofées que pour
défigner, comme nous l’avons d it , les modes dont
le la eft le ton fondamental ; mais quand on emploie
les lettres pour exprimer .fimplement les fonsèe la
gamme , on ne doit défigner le fixième ton de l ’échelle
, ou le la ,q.uepar la fimpie lettre A (M. Suard.)
i !r|s Cette lettre majufcule écrite fur 1 enveloppe
d’une partie de mufique, ou fur la partie m ême,
indique la haute-contre ( alto). Lorfque dans le cou-
cant de .la bafle-continue £ B, C«} d’une pièce de
Mufique, Tamil,
chant à plufieurs parties , on trouve la lettre A i
elle indique que la haute-contre chante feule. ( M,
Caflilhon de Berlin. )
A bat tuta . Vo yez Mefuré.
A LIVRE OUVERT , OU A L’OUVERTURE DU
livre. Vo yez Livre.
A mi la , A la mi re , ou fimplement A. Sixième
fon «le la gamme diatonique & naturelle , lequel
s’appelle autrement la. Voyez Gamme, ( J. J. Rouf
feau. )
A TEMPO. Voyez Mefuré.
ABAISSEMENT de la main. Vo yez Frappé.
ABRÉVIATION. Quoique l’on ait plufieurs
abréviations en mufique , je ne crois pourtant pas
que l’on ait encore fait de ce mot un terme d’art.
Les copiftes , ni ceux qui gravent ou impriment
de la mufique-, ne doivent jamais, à mon avis ,
fe fervir d abréviations dans les parties féparées : lé
muficien, charge de les exécuter , n’a pas befoin
qu’on en augmente la difficulté par la multiplicité
des lignes. Mais il en eft autrement pour les partitions
, fur-tout pour celles qui fortent de la main du
compofiteur ; plus celui-ci pourra abréger la partition
, mieux il fera ; il perdra moins de tems, oc fon
génie n’aura pas le tems de fe refroidir : d’ailleurs
perfonne, hors l’accompagnateur & le chanteur,
n’exécute fur la partition la partie de chant, étant
la principale , u ’eftguere fufceptîble d abréviations ,
& ordinairement le compofiteur lui-même accompagne.
Les abréviations les plus ufitées font : i° . les crochets.
V oyez Crochet.
On felert-auffi des crochets , pour marquer en
abrégé un paffage compofè de notes , dont la moitié
font d’un degré différent de l’autre. On écrit
pour cela une blanche au degré inferieur & une ail
Supérieur, & on lui donne autant de crochets qu’il
eft nécefiàire. Voyez planches de mufique ,fig. i & 2,
Quelques muficiens , ayant égard à la valeur
exaâe des notes inférieures & des notes fupérieures ,
marquent ce même trait de chant comme il l’eft
fil'. 3. Cette derniere abréviation me femble de beaucoup
préférable à la première , en ce qu’elle ôte
d’abord l’équivoque de celle-ci ; car on ne peut
pas y voir fi la première abréviation n’indique pas
qu’il faut exécuter ce trait de chant en double corde,
qu’on abrège auffi de cette maniéré ; alors , au
lieu de l’effet fi%. 1 & 2 , on auroit l’effet fig. 4 ,
qui eft très-différent. En faifant un léger changement
à la derniere abréviation , on peut la rendre
d’un ufage plus général, & lever encore un doute
dans les abréviations, fig. 1 '& 2. Il n’y a que l’ufage
qui décide fi l’expremon doit être telle qu’elle eft