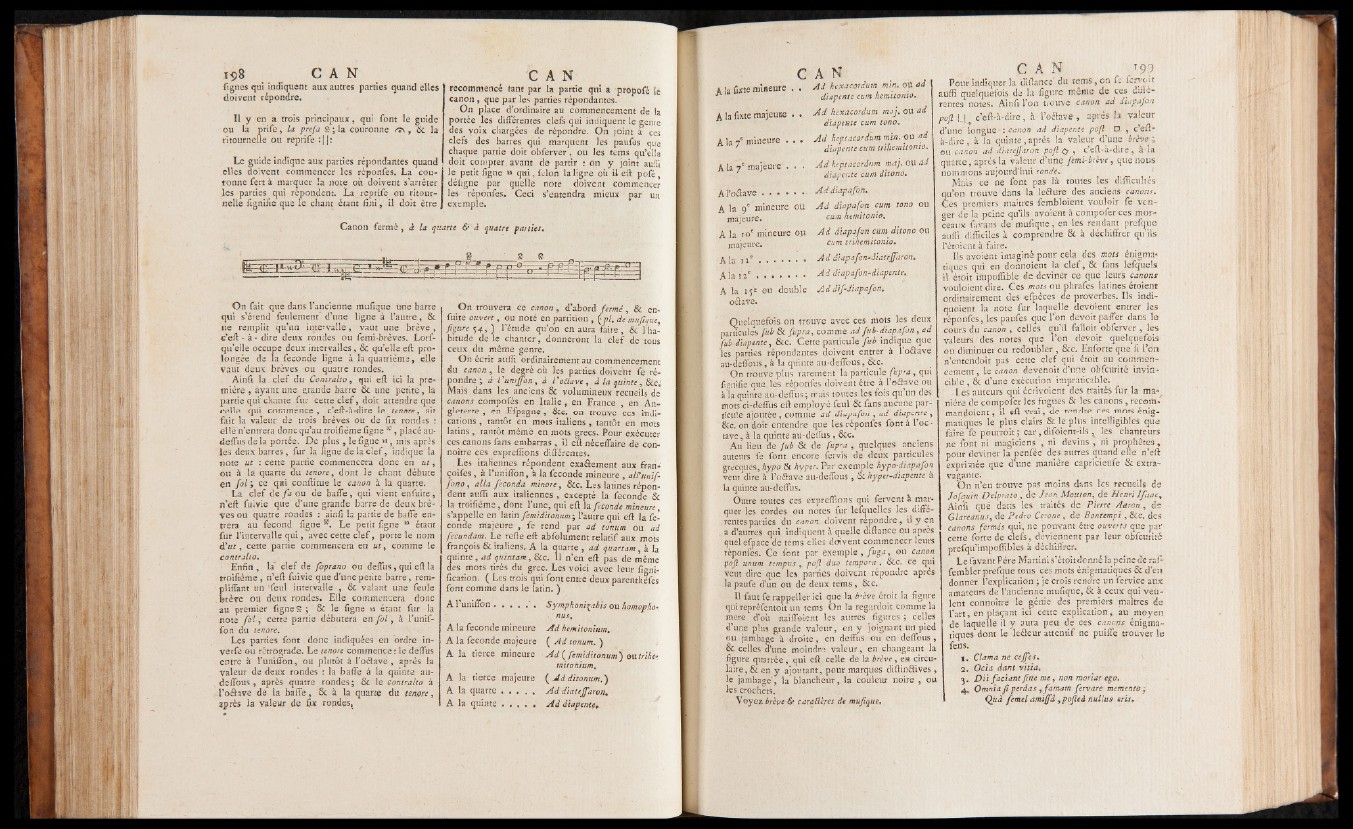
i<>8 C A N
lignes qui indiquent aux autres parties quand elles
doivent répondre.
I l y en a trois principaux, qui font le guide
ou la prife, la prefa S ; la couronne / ï\ , & la
ritournelle ou reprife :|[:
Le guide indique aux parties répondantes quand
elles doivent commencer les réponfes. La couronne
fert à marquer la note où doivent s’arrêter
les parties qui répondent. La reprife ou ritournelle
lignifie que le chant étant fin i, il doit être
recommencé tant par la partie qui a propofè le
canon, que par les parties répondantes.
On place d’ordinaire au commencement de la
portée les différentes clefs qui indiquent le genre
des voix chargées de répondre. On joint à ces
clefs des barres qui marquent les paufes que
chaque partie doit obferver, ou les tems qu’elle
doit compter, avant dè partir : on y joint aufii
le petit figne * q u i, félon la ligne où il efl pofé,
déhgne par quelle note doivent commencer
les réponfes. Ceci s’entendra mieux par un
exemple.
Canon fermé, à la quarte & à quatre parties.
\________________________ J,____ ______ g . g g __
On fait que dans l’ancienne mufique une barre
qui s’étend feulement d’une ligne à l’autre, &
ne remplit qu’un intervalle, vaut une brève ,
c’efl - à - dire deux rondes ou femi-brèves. Lorf-
qu’elle occupe deux intervalles, & qu’elle efl prolongée
de la fécondé ligne à la quatrième, elle
vaut deux brèves ou quatre rondes.
Ainfi la clef du Contralto, qui efl ici la première
, ayant une grande barre & une petite, la
partie qui chante fur cette c le f , doit attendre que
celle qui commence, c’efl-à-dire le tenore, ait
fait la valeur de trois brèves ou de fix rondes :
elle"n’entrera donc qu’au troifième ligne * , placé au-
deffus de la portée. De plus , le figne * , mis après
les deux barres , fur la ligne de la c le f, indique la
note ut : cette partie commencera 4°nc en u t ,
ou à la quarte du tenore, dont le chant débute
çn fo l ; ce qui conflitue le canon à la quarte.
La cle f de fa ou de baffe, qui vient en fuite,
n’eff fuivie que. d’une grande barre de deux brèves
ou quatre rondes : ainfi la partie de baffe entrera
au fécond figne Le petit figne n étant
fur l’intervalle qui, avec cette c le f, porte le nom
d 'u t , cette partie commencera en u t, comme le
contralto.
Enfin , la clef de foprano ou deffus, qui efi la
troifième , n’efl fuivie que d’une petite barre, rem-
pliflant un 'feul intervalle , & valant une feule
brève ou deux rondes. Elle commencera donc
au premier figne g ; & le figne u étant fur la
note fo l , cette partie débutera en f o l , à l’unif-
fon du tenore.
Les parties fo n t . donc indiquées en ordre in-
verfe ou rétrogradé. Le tenore commence: le dèffus
entre à l’uniffon, ou plutôt à l’oélave, après la
Valeur de deux rondes : la baffe à la quinte au-
deffous, après quatre rondes ; & le contralto à
l ’oélave de la baffe, & à la quarte du tenore,
après la valeur de fix ropdes?
On trouvera ce canon, d’abord fermé, & en-
fuite ouvert, ou noté en partition , ( pl. de mufique,
figure 54, ) l’étude qu’on en aura faite, & l’habitude
de le chanter, donneront la cle f de tous
ceux du même genre.
On écrit aufîi ordinairement au commencement
du canon, le degré où les parties doivent fe répondre
; i 1 *uniffon, à ï ’oftave , à la quinte, &c.’
Mais dans les anciens & volumineux recueils de
canons compofés en Italie , en France , en Angleterre,
en jlfp a gn e , &c. on trouve ces indications
, tantôt en mots italiens , tantôt en mots
latins , tantôt même en mots grecs. Pour exécuter
ces canons fans embarras , il efi néceffaire de con-
noître ces exprefîions différentes.
Les italiennes répondent exaâement aux fran-
çoifes, à l’uniffon, à la fécondé mineure, aiïunif-
fono, alla féconda minore, &c. Les latines répondent
aufli aux italiennes , excepté la fécondé &
la troifième, dont l’une, qui efi la fécondé mineure,
s’appelle en latin fiemiditonum; l’autre qui efl la fécondé
majeure , fe rend par ad tonum ou ad
fecundam. Le refie efi abfolument relatif aux mots
françois & italiens. A la quarte , ad quartam, à la
quinte, ad quintam, Çcc. Il n’en efl pas de même
des mots tirés du grec. Les voici avec leur figni-
fication. ( Les trois qui font entre deux parenthèfes
font comme dans le latin. )
A l’unifTon Symphoni^abis ou homopho-
. ' nus,
A la fécondé mineure Ad hemitonium.
A la fécondé majeure ( Ad tonum. )
A la tierce mineure A d {femiditonum) outriher
mitonium,
A la tierce majeure {A d ditonum.)
A la quarte . . . . . A d diatejfaron,
A la quinte . . . . . A d diapenfç.
f i la fixte mineure ,
A la fixte majeuKe
A la 7e mineure .
C A N'
, , Ad kexacordum min. OU ad
diapente cum hemitonio.
, , A d kexacordum maj, OU ad
diapente cum tono. x
, . Ad heptacordurn min. ou ad
diapente cum trîhemitonio.
fi la 7e majeure . . . A d heptacordurn maj. ou ad
diapente cum ditono•
A l’o â a v e .................. Jddiapafem.
A la 9* mineure où Ad diapafon cum tono ou
majeure. cum hemitonio,
A la toc mineure oji Ad diapafon cum ditono ou
majeure. cum trîhemitonio.
fi ]a jg0 .................... A d diapafon-JiatrJfaron,
fi ja ..................... A i diapafon-diapente.
A la i$e ou double Ad d i f diapafon.
o&ave.
Quelquefois on trouve avec ces mots les deux
particules fub & fupra, comme ad fub-diapafon, ad
fub-diapente, &c. Cette particule fub indique que
les parties répondantes doivent entrer à l’oétavé
au-deffous, à la quinte au-deffous, &c.
On trouve plus rarement la particule fupra, qui
fi gui fie quelles réponfes doivent être à l’eâave ou
à la quinte au-deffus ; mais toutes les fois qu’un des
mots ci-deflus efl employé feul & fans aucune particule
ajoutée, comme ad diapafon , ad diapente ,
&c. on doit entendre que les réponfes font à l’oc -
tave, à la quinte au-delfùs , &c.
Au lieu de Jub & de fupra , quelques anciens
auteurs fe'font encore fervis de deux particules
grecques, hypo & hyper. Par exemple hypo-diapafon
veut dire à l’oélave au-deffous , Sl hyper-diapente a
la quinte au-deflus.
Outre toutes ces exprefîions qui fervent à marquer
les cordes ou notes fur lelquelles les differentes
parties du canon, doivent répondre, il y en
a d’autres qui indiquent à quelle diftance ou après
quel efpace de tems elles doivent.commencer leurs
réponfes. Ce font par exemple , faga, ou canon
pofi unum t smp us,, po(l duo tempora , & c. ce qui
veut dire que les parties doivent répondre après
la panfe d’un ou de deux tems, &c.
Il faut fe rappeller ici que la b'ève étoit la figure
qui repréfentoit un tems On la regardoit comme la
mere d’où naiffoient les autres figures ; celles
d’une plus grande valeur, en y joignant un pied
ou jambage à droite, en deffus ou en deffous ,
& .celles d’une moindre valeur, en changeant la
figure quarrée, qui efl celle de la brève, en circulaire,
& en y ajoutant, pour marques diftinélives ,
le jambage', la blancheur, la couleur noire , ou
les crochets.
Voyez, brève & caractères de mufique»
Pour indiquer la clifiancé du tems, on fervent
aufli quelquefois de la figure même de ces differentes
notes. Ainfi l’on trouve canon ad diapafon
pofi U c’efi-à-dire, à l’oélave , après la valeur
d’üne' longue canon ad diapente pofi D. , c’efi*
à-dire, à la quinte, après la valeur d’une brève ;
ou canon ad diateffaron pofi $ , c’efl-à-dire, à la
quarte, après la valeur d’une femi-brève , que nous
nommons aujourd’hui ronde.
Mais ce ne font pas là toutes les difficultés
qu’on trouve dans la leéhire des anciens canons.
Ces premiers maîtres fembloient vouloir fe venger
de la peine qu’ils avoient à compofer ces morceaux
favans de mufique, en les rendant prefque
aufli difficiles à comprendre & à déchiffrer qu’ils
l’étoient à faire.
Us avoient Imaginé pour cela des mots énigmatiques
qui en donnoient la c le f, & fans lefquels
il étoit impoffible de deviner ce que leurs canons
vouloient dire. Ces mots ou phrafes latines étoient
ordinairement des efpèces de proverbes. Ils indi-
quoient la note fur laquelle devôient entrer les
réponfes, les paufes que l’on devoitpaffer dans le
cours du canon , celles qu’il falloit obferver , les
valeurs des notes que l’on devoit quelquefois
ou diminuer eu redoubler, &c. Enforte que fi l’on
n’entendoit pas cette clef qui étoit au commencement,
le canon devênoit d’une obfcurité invinc
ible, & d’une exécution impraticable.
Les auteurs qui écrivoient des traités fur. la ma-y
nière de compofer les fugues & les canons, recoiîi-
mandoient, il efl vrai, de rendre ces mots énigmatiques
le plus clairs & le plus intelligibles que
faire fe pourroit; car, difoient-ils x les chanteurs
ne font ni magiciens , ni devins , ni prophètes,
pour deviner la penfée des autres quand elle n’efl
exprimée que d’une manière capricieufe & extravagante.
t )n n’en trouve pas moins dans les recueils de
Jofquin Delprato , de Jean Mouton, de Henri Ifaac,
Ainfi quë dans les traités de Pierre Aaron , de
Glareanus, de Pedro Cerone , de Bontempi, &c. des
canons fermés qui, ne pouvant être ouverts que par
cette forte de clefs, deviennent par leur obfcurité
-prefqu’impoffibles à déchiffrer.
Le favant Père Martini s’étoitdcnné la peine de rafi
fembler prefque tous ces mots énigmatiques & d’en
donner l’explication ; je crois rendre un fervice aux
amateurs de l’ancienne mufique, & à ceux qui veulent
connoître le génie des premiers maîtres de
l’art, en plaçant ici cette explication, au moyen
de laquelle il y aura peu de ces canons énigmatiques
dont le leâeur attentif ne puiffe trouver le
fens.
1. Clama ne ceffes.
2. Ocia dant vitia.
3. Dit faciant fine me, non moriar ego.
4. Omnia f i perdus 9famam fervare memento 9
Quâ femel amijfâ >pofieà nulius gris.