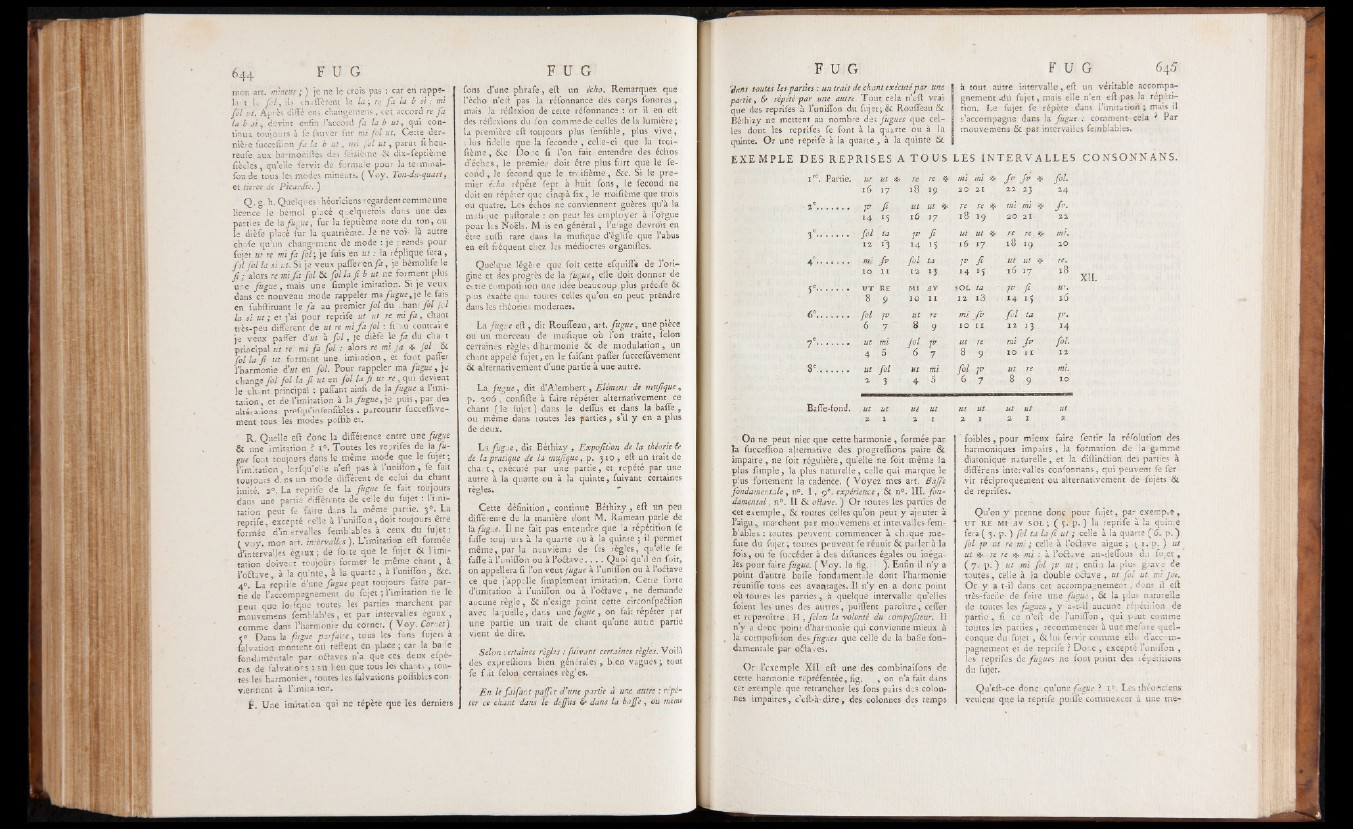
644 F u G
mon art. mineur ; ) je ne le crois pas : car en rappela.
t h: fo l, ils chslièrent le la', re f a la b s i ; mi
f o i ut. Après difféens changemetis , cet. accord re f a
la b -s i, devint enfin .raccord f a la b u t , qui continua
toujours à fe fauver fur m i f o l ut. Cette dernière
fuccefiion f a la b u t , m i f o l u t , parut fiheu-
reufe aux harmonises des feizième & dix-feptieme
fiècles, qu’elle fervit de formule pour la terminai-
fonde tous les modes mineurs. ( Voy. Ton-du-quart,
et tierce de Picardie. )
Q . g. h. Quelques théoriciens regardent comme une
licence le bémol placé quelquefois dans une des
parties de la fu g u e , fur la feptième note du ton, ou
le dièfe placé fur la quatrième. Je ne voit là autre
chofe qu’un changement de mode : je prends pour
fujét u t re mi f a fo l', je fuis en ut : la réplique lera ,
f o l f o l la si ut. Si je veux paffer en f a , je bémolife le
f i ; alors re mi f a f o l & fo l ia f i b u t ne forment plus
une" fu g u e , mais une fimple imitation. Si je veux
dans ce nouveau mode rappeler ma fu g u e ,) e le fais
en fubftituant le f a au premier fo l du vhant fo l fo l
la si u t ; et fai pour reprife u t u t re mi f a , chant
très-peu différent de u t re mi f a fo l : fi'su contraire
je veux paffer d'ut à f o l , je dièfe le fa , du chant
principal u t re m i f a fo l : alors re mi f a ❖ f o l &
f o l la f i ut ferment une imitation, et font paffer
l’harmonie d'u t en fo l. Pour rappeler ma fu g u e , Rechange
fo l fo l la f i u t e n f o l la f i u t re , qui devient
le ch-nt principal : paffant ainfi de la fu g u e a limitation
, et de l’imitation à la fu g u e , je puis, par des
altérations prefqu’infenfibles ; parcourir fucceffiveinent
tous les modes poffib es.
• R. Quelle eft donc la différence entre une fugue
& une imitation ? i° . Toutes les reprifes de la fugue
font toujours dans le même mode que le fujet ;
l’imitation, lcrfqu’elle n’eft pas à l’uniffon, fe fait
toujours d;r.s un mode différent de celui du chant
imité. 2°. La reprife de la fu g u e fe fait toujours
dans une partie différente de celle du fujet : l’imitation
peut fe faire dans la même partie. 3 °.L a
reprjfe, excepté celle a l’uniffon , doit toujours etre
formée’ d’intervalles femblables à ceux du fujet:
/ voy. mon art. intervalles f L’imitation eft formée
d’intervalles égaux ; de forte que le fujet & l imitation
doive:, t toujours former le même chant, à
l’o&ave, à la aunte, à la quarte , à l’uniffon , &c.
4°. La reprife d’une fu g u e peut toujours faire partie
de l’accompagnement du fujet ; l’imitation ne le
peut que lorfque toutes lès parties marchent par
mouvemens femblables, et par intervalles égaux ,
comme dans l’harmonie du corner. ( V o y. Cornet).
ro Dans la fu g u e p a rfa ite , tous les fons fujets à
lalvation montent ou reftent en place •; car la ha-ie
fondamentale par oftaves n’a que ces deux efpè-
ces de falvatiors ; au heu que tous les chant,, toutes
les harmonies, toutes les falvations poffibtesconviennent
à l’imira:ion,
F . U n e imita tion qu i n e répè te q u e le s derniers
F U G
fon s d'un e p h r a fe , eft un écho. Rem a rq u e z que
l’ écho n’eft pas la réfonnance des corps fo n o r e s ,
mais la réflexion de ce tte réfonnance : o r il en eft
dès réflexions du fon comme de ce lles de la lum iè re ;
la prem ière eft toujours plus fe n fib le , plus v i v e ,
t lu s fidelle q ue la fécond é , c e lle - c i q u e la t ro i -
f ièm e , & c . D o n c f i l’on fait entendre des échos
d’é c h c s , le premier doit ê tre plus fort q ue le féco
n d , le fécond que le t ro i fièm e , & c . S i le p r e mier
é:ho répè te fept à huit fo n s , le fécon d ne
doit en répé te r q ue cin q 'à f i x , le tro ifième que trois
ou quatre. L e s écho s ne conv iennent guères qu’à la
mu fiqu e pa ftora le : on peut les em p lo y e r à l’o rgue
p ou r les N o ë ls . M :is en g é n é r a l, l’usage d e v rd it en
être au ffi rare dans la mu fiqu e d’é g life q ue l’abus
en eft fréqu en t ch ez les médiocres o rganiftes.
Q u e lq u e lé g è re que fo it cette efquifl® d e l’origine
et des progrès de la fugue, e lle doit do n n e r d e
e v tte o om p o liû o n une id ée b eau cou p plus précife ÔC
p lu s e x a d e q ue toutes celles q u ’on en peu t prendre
dans les théorie s modernes.
L a fugue e f t , dit R o u f f e a u , ar t. fugue, un e piè ce
ou un mo rce au de m u fiq u e où l’o n t ra ite , félon
c e rta ines règle» d’ha rmonie & de m o d u la t io n , un
chant ap pelé fu je t , en le faifant paffer fucc eflivement
& a lternativ ement d’une pa rtie à une autre.
L a fugue, dit d’A lem b e r t , Elémens de mufique,
p . 206 , co n fifte à faire répéter a lternativ ement ce
chant ( l e fu je t ) dans le deffus et dans la baffe ,
o u m êm e dans toutes les p a r t ie s , s’il y en a plus
de d eux .
L a fugue, dit B é th iz y , Expofition de la théorie fe
de la pratique de la mufique, p . 3 1 0 , eft un trait de
cha. t , ex écuté par u n e p a r t ie , et rép é té par une
autre à la qua rte ou à la q u in te , fu iv an t certaines
règles.
C e t t e d é fin itio n , continu e B é th i z y , eft un peu
différente de la manière dont M . R am e au pa rle de
1 a fugue. I l ne fait pas entendre q ue la répé tition fe
faffe touj 'urs à la qua r te ou à la quinte ; il permet
m êm e , par la neu v ièm e de- fes r è g le s , qu ’elle fe
faffe à l’uniffon ou à l’ o d a v e . . . . Q u o i qu ’il en fo i t ,
on appellera fi l’on v e u t fugue à l’ uniffon ou à l’o& a v e
ce q u e j’ap p elle fimplement imita tion. C e t t e forte
d’ imitation à l’uniffon ou à l’o â a v e , ne demande
aucune règle , & n’exige point ce tte c irco n fp e â îo n
a v e c la q u e lle , dans une fugue, on l'ait répéter par
u n e pa rtie un trait de chant qu’une autre partie
i v ient d e dire.
Selon certaines règles : fuivant certaines règles. V o ilà
! de s expreflion s b ien g én é ra le s , b ien v a g u e s ; tout
fe ta it félon certaines r è g 'e s .
En le faifant paffer d*une partie à une autre : répéter
ce chant dans le deffus & dans la baffe, ou mente
F u G
’iafis toutes les parties : un trait de chant exécuté par une
partie, & répété par une autre. T o u t ce la n’e f t v ra i
que des reprifes à l’uniffon du fu je t; & R ou ffeau &
B é th iz y ne mettent au n omb re des fugues q ue ce lles
dont les rep r ife s fe fon t à la q u a r te o u à la
quinte. O r une reprife à la qua rte , à la qu in te 6c
F U G 645
à tou t autre in t e r v a l le , eft un v é r itab le a c compagn
em en t .du f u je t , mais e lle n ’en e ft pas la rép é tition.
L e fuje t fe rép è te dans l ’imita tion ; mais il
s’a c com p a gn e dans la fugue : com m e n t- c e la ? Par
m o u v em en s & par interv a lle s femblables.
E X E M P L E D E S R E P R I S E S A T O U S L E S I N T E R V A L L E S C O N S O N N A N S .
i te. Partie. ut Ut *< re re «t mi mi ❖ H J v «• f i t .
16 ï 7 18 *9 20 21 22 2 3 24
2*............... F fi ut ut # re re # mi mi «c > •
14 ■s IÖ 17 18 *9 20 2 1 22
3 '.............. f i l E la F f i ut Ut re re. # m i.
12 J 3 14 »5 lé I? 18 *9 20
4e............... mi > . fol ta ;r / ut ut # re.
10 II 12 0 I4 *5 16 '7 18
............. UT RE MI HV SOL ta F f l u t.
8 9 IO II 12 i 3 . I4 *5 16
6 ‘ ......... ... fol F Ut re m i H . f i l ta F •
6 7 8 9 10 i l 12 13• H
7 ' . . . . . . . Ut mi
H F . ut re mi 1 f i l .
4 5 6 7 8 9 10 i l 12
8' .............. ut foi Ut mi f i l F ut re mi.
2 3 4 ■8 ■ • 6 7 8 9 10
Baffe-fond. ut ut ut Ut ut ut Ut ut ut
. 2 i 2 I 2 i 2 i 1 2
O n ne peu t nier q ue cette h a rm o n ie , form é e par
la fuçceffion a lternativ e des pro greffion s paire &
im p a ir e , n e fo it r é g u liè r e , qu’.elle ne fo it m êm e la
plus f im p le , la plus n a tu r e lle , c e lle q u i marqu e le
plus fortement la cadence. ( V o y e z mes ar t. Baffe
fondamentale, n°. 1 , 9 e. expérience, & n ° . II I . fondamental
, n ° . II & oflave. ) O r tou te s les parties de
cet e x em p le , & toutes celles qu’on peut y ajouter à
l’a ig u , marchent p a r mou vemens et intervalle s fem-
b ’ables : toutes p eu v en t commen ce r à c h iq u e m e -
fure du fujet ; tou te s p eu v en t fe réunir & pa rler à la
f o i s , ou fe fuccéder à des diftances égales ou in é g a les
pour faire fugue. ( V o y . la fig. ) . Enfin il n’y a
point d’autre b a ffe fon damenta le dont l’ha rmonie
réü n iffe tou s ces a v an tage s. I l n’y en a donc point
où tom e s les p a r t ie s , à que lqu e inte rv a lle qu’elles
foient les unes des au tre s , puiffent p a ro î t r e , ceffer
et rep a ro ître , H , félon la volonté du compofitèur; 11
n ’y a donc po int d’ha rmonie qui con v ien n e mieux à
la c om p o fi.ion des fugues que ce lle de la baffe fo n damentale
par o é ïa v e s .
O r l’e x em p le X I I e f t une des combinaifons d e
ce tte ha rmonie rep ré fen té e , fig . , on n’a fait dans
cet e x emple que retrancher les fons pairs des co lo n nes
im p a ir e s , c’e f t - à -d ir e , des colonnes des temps
foibles, pour mieux faire fentir la réfolution des
harmoniques impairs, la formation de la gamme
diatonique naturelle, et la diftinction des parties à
différens intervalles confonnans, qui peuvent fe fe r .
vir réciproquement ou alternativement de fujets &
de reprifes.
Qu’on y prenne donc pour fujet, par exemp.e,
ut RE mi hv s o l ; ( 5. p. ) la reprife à la quinte
fera ( 3. p. ) fol ta la f i ut ; celle à la quarte ('6. p. )
fol jv ut re mi; celle à l’o&ave aigue ; q, 1. P- ) ut
ut # re re ^ mi : à l’o&ave au-deffous du fiqet ,
( 7. p. ) ut mi fol iv ut ; enfin la plus grave de
toutes, celle à la double o&ave , ut fo l ut mi Joc.
Or y a t-il dans cet accompagnement, dont il eft
très-facile de faire une fugue , & la plus naturelle
de toutes les fugues, y a-t-il aucune répétition de
partie, fi ce n’eft de l’uniffon, qui peut comme
toutes les parties , recommencer à uns mefure quelconque
du fujet , & lui fervir comme elle d’accompagnement
et de reprife ? Do te , excepté l’uniffon ,
les reprifes de fugues ne font point des îépétitions
du fujet.
Qu’eft-ce donc qu’une fugue ? i° . Les théoriciens
veulent que la reprife puiffe commencer à une me