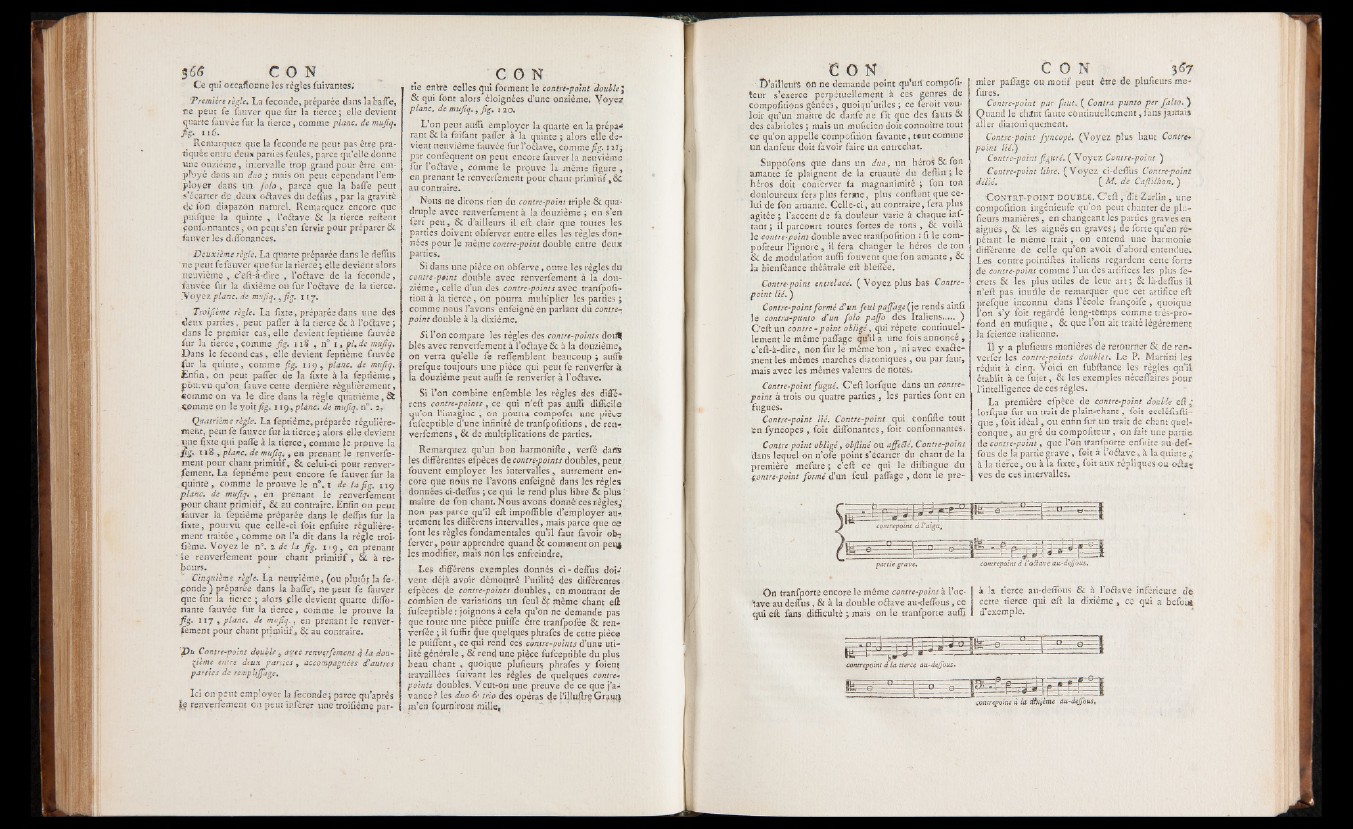
3 6 6 C ON
Ce qui occasionne les règles fuivantes;
‘Première règle. La feçonde, préparée dans la baffe,
ne peut fe fauver que fur la tierce ; elle devient
quarte Sauvée fur la tierce , comme plane, de mujîq.
fig* n 6.
Remarquez que la fécondé ne peut pas être pratiquée
entre deux parties feules, parce qu’elle donne
une onzième, intervalle trop grand pour être eus-
jpîbyé dans un duo ; mais on peut cependant l’employer
dans un jolo-, parce que 1$ Baffe peut
s’éçarter de .deux oélaves du deffus , par la gravité
de fon diapazon naturel. Remarquez encore que
puifque la quinte , l’oérayeN & la tierce reftent
çonfunnantes l'on peut s’en fervir pour préparer &
fauver les diffonances.
Deuxième règle. La quarte préparée dans le deffus
ne peut fe fauver que fur la tierce; elle devient alors
neuvième , c’eft-à-dire , l’oâave de la fécondé,
Sauvée fur la dixième ou fur l’oâave de la tierce.
.Voyez plane, de mujîq. ,fig. 1 1.7.
Troifième règle. La Sixte, préparée dans une des
deux parties, peut paffer à la tierce & à l’pélave ;
dans le premier cas., elle devient feptième fauvéê
fur la tierce , comme.-fig. 1 1S , n° i , p/,de mujîq.
Dans le fécond cas, elle devient feptième fauvée
fur la quinte, comme fig. 1 1 9 , plane, de mujîq.
£nfin, on peut paffer de la Sixte à la feptième,
pourvu qu’on fauve cette dernière régulièrement,
comme on va le dire dans la règle quatrième, fit
çpmme on le yoit fig. 1 19, plane, de mujîq. n°. i r
Quatrième règle. La feptième, préparée régulièrement,
peut fe Sauver fut la tierce ; alors çlle devient
une fixte qui paffe à la tierce’, comme le prouve la
fig- t i8 , plane, de mufiq%, en prenant le renverfe-
ment pour chant primitif, & celui-ci pour renversement.
La feptième peut encore fe fauver fur la
quinte, comme le prouve le n°. 1 de la fig. 119
plane. de mujîq» , en. prenant le renversement
pour chant primitif, & au contraire. Enfin on peut
fauver la feptième préparée dans le deffus fur la
Sixte, pourvu que celle-ci Soit enSiiite régulièrement
traitée , comme on l’a dit dans la règle troisième.
Voyez le n°. 2 de la fig. 1 1 9 , en prenant
ïe renverfement pour chant primitif , & à rebours.
Cinquième règle. L^ neuvième, (ou plutôt la fe-.
ponde ) préparée dans la baffe*, ne peut fe fauver
que fur la tierce ; alors .elle devient quarte diffo-
nante fauvée fur la tierce, comme le prouve la
fig. 117 , plane, de mujîq., en prenant le renversement
pour chant primitif, & au contraire.
Du Contre-point double, avec reqverfement 4 la douzième
entre deux parties, accompagnées d'autres
parties de re/nplijfage.
Ici on peut employer la fécondé; parce qu’après
|f reuveriement on peut inférer une troifième par-
C O N
tie entre celles qui forment le contre-point doubleJ
& qui font alors éloignées d’une onzième, Voyez
plane, de mujîq., fig. i 20.
L ’on peut auSïi employer la quarte en laprépa«
rant & la faifant paffer à la quinte ; alors elle devient
neuvième fauvée furl’oclave, comme fig. n i ;
par conféquent on peut encore fauver la neuvième
fur l’o&ave, comme le prouve la meme figure ,
en prenant le renverfement pour chant primitif
au contraire.
Nous ne dirons rien du contrepoint triple & quadruple
avec renverfement à la douzième ; on s’en
fort peu, & d’ailleurs il e ff clair que toutes les
parties doivent obferver entre elles les règles données
pour le même contre-point double entre deux
parties.
Si dans une pièce on obferve, outre les règles du
contre-point double avec renverfement à la douzième,
celle d’un des contre-points avec tranfpofi-
tion à la tierce , on pourra multiplier les parties ;
comme nous l’avons enfeigné en parlant du contre-
point double à la dixième.
«Si l’on compare les règles des contre-points doiïif
b.les avec renverfement à l’oélaye & à la douzième'*
on verra quelle fè reffemblent beaucoup ; aulfo
prefque toujours une pièce qui peut fe renverfèr à
la douzième peut aufli fe renverfer £ l’o&ave.
Si l’on combine enfemble les règles des diffé-
rens contre-points, ce qüi n’eft pas auffi difficile
qu’on lUmagine , on pourra compofer une pièce
fufceptible d’une infinité de tranfpofitions , de ren-.
verfemens, & de multiplications de parties.
Remarquez qu’un bon harmonise, verfé dalïs
les différentes efpèces de contrepoints doubles, peut
fouvent employer les intervalles, autrement encore
que nous ne l’avons enfeigné dans les règles
données ci-deffus ; ce qui le rend plus libre & plus '
maure de fon chant. Nous avons donné ces règles,*,
non pas parce qu’il eff impoffible d’employer autrement
les différens intervalles, mais parce que ce
font les règles fondamentales qu’il faut favoir ob-
feryer, pour apprendre quand oc comment on peu|
les modifier, mais non les enfreindre.
Les différens exemples donnés ci-deffus doi-‘
vent déjà avpftr démoqtré l’utilité des différentes
efpèces de contrepoints doubles, en montrant de
combien de variations un feul 8f même chant eff
fufceptible : joignons à cela qu’on ne demande pas
que toute une pièce puiffe être tranfpofée & ren-.
verfée ; il fuffit que quelques phrafes de cette pièce
le puiffent, ce qui rend ces contre-points d’une utilité
générale, & rend une pièce fufceptible du plus
beau chant , quoique plufieurs phrafes y foienj
travaillées fuivant les règles de quelques contre-
points doubles. Veut-on une preuve de ce que j’avance
? les duo & trio des opéras 4s l’illuffre Graiu}
m’en fourniront mille^
C O N
IVaiîleufS ôn ne demande point qufuii compofi-
teur s’exerce perpétuellement à ces genres de
compofitions gênées, quoiqifutiles ; ce feroit vouloir
qu’ un maître de danfe ne fît que des fauts &
des cabrioles ; mais un muficien doit connoître tout
ce qu’on appelle compofition favante, tout comme
un danfeur doit favoir faire un entrechat.
Supposons que dans un duo, un héroS &. fon
amante fe plaignent de la cruauté du deffin ; le
héros doit conferver fa magnanimité ; fon ton
douloureux fera’ plus ferme, plus confiant que celui
de fon amante. Celle-ci, au contraire, fera plus
agitée ; l’accent de fa douleur varie à chaque inf-
tant ; il parcowrt toutes fortes de tons, & voilà
le contre-point double avec trarifpofition : fi le com-
pofiteur l’ignore, il fera changer le héros de ton
& de modulation auffi fouvent que fon amante , &
la bienféance théâtrale eff bleffée.
Contrepoint entrelacé. ( Voyez plus bas Contrepoint
lié. )
Contrepoint formé d'un feul pajfage[)e rends ainfi
le contra-punto d'un folo pajfo des Italiens..... )
C ’eft un contre - point obligé, qui répété continuellement
le même paffage qu’il a une fois annoncé ,
c’eff-à-dire, non fur le même fo n , ni avec exactement
les mêmes marches diatoniques, ou par faut,
mais avec les mêmes valeurs de notes;
Contrepoint fugué. C ’eft lorfque dans un contrepoint
à trois ou quatre parties, les parties font en
fugues.
Contrepoint lié. Contre-point qui confifte tout
ïn fyncopes , foit diffonantes, foit confonnantes.
Contrepoint obligé, obfiiné ou ajfeflé. Cont/e-poitit
dans lequel on n’oie point s’écarter du chant de la
première mefure; c’eft ce qui le diftingue du
contrepoint formé d’un feul paffage , dont le pre-
C O N 3 6 7
mier paffage ou motif peut être de plufieurs me*
fures.
Contrepoint par faut. ( Contra punto per Jalto. }
Quand le chant faute continuellement, fans jamais
aller diatoniquement.
Contrepoint fyncopè, (Voyez plus haut Contre*
point liéî)
Centfe-point figuré. ( Voyez Contrepoint. )
Contrè-point libre. (V o y e z ci-deffus Contrepoint
délié. ( M. de Caflilh'on. )
C on trF-poin t double. C ’eft , dit Zarlin , une
compofition ingénieufe qu’on peut chanter de pli;-
fieurs manières, en changeant les parties graves en
aiguës , & les aiguës en graves ; de forte qu’en répétant
le même trait, on entend une harmonie
differente de celle qu’on avoit d’abord entendue»
Les. contre pointillés italiens regardent cette forte
de contre-point comme l ’un des artifices les plus fe-
crets & les plus utiles de leur art ; & là-deffus il
n’eft pas inutile de remarquer que cet artifice eft
prefque inconnu dans l’école françoife , quoique
l’on s’y foit regardé long-têmps comme très-profond
en mufique , & que l’on ait traité légèrement,
la fcience italienne.
Il y a plufieurs manières de retourner & de renverfer
les contrepoints doubles. Le P. Martini les
réduit à cinq. Voici en fubftance les règles qu’il
établit à ce lu jet, & les exemples néceffaires pour
l’intelligence de ces règles.
La première efpèce de contrepoint double eft*
lorfque fur un trait de plain-chant, foit eccléfiafti-
que , foit idéal, ou enfin fur un trait de chant quelconque
, au gré du compofiteur , on fait une partie
de contrepoint, que l’on tranfporte enfuite au-def-
fous de la partie grave , foit à l’oâave,, à la quinte
à la tierce, ou à la fixte, foit aux répliques ou oéla»
yes de ess intervalles.
contrepoint à l’aigu.
E ^ E E E
contrepoint à l’oCiave au-dejfous.
On tranfporte encore le même contrepoint à l’oc-
fave au deffus, & à la double oélave au-deffous, cé
qui eft fans difficulté ; mais on le tranfporte auffi
à la tierce au-deffous & à l’oélave inférieure de
cette tierce qui eft la dixième , ce qui a befoia
d’exemple.
contrepoint à la tierce au-dejfous.
f e — i — 5— P—
contrepoint d la ïtfaième au-deffous,