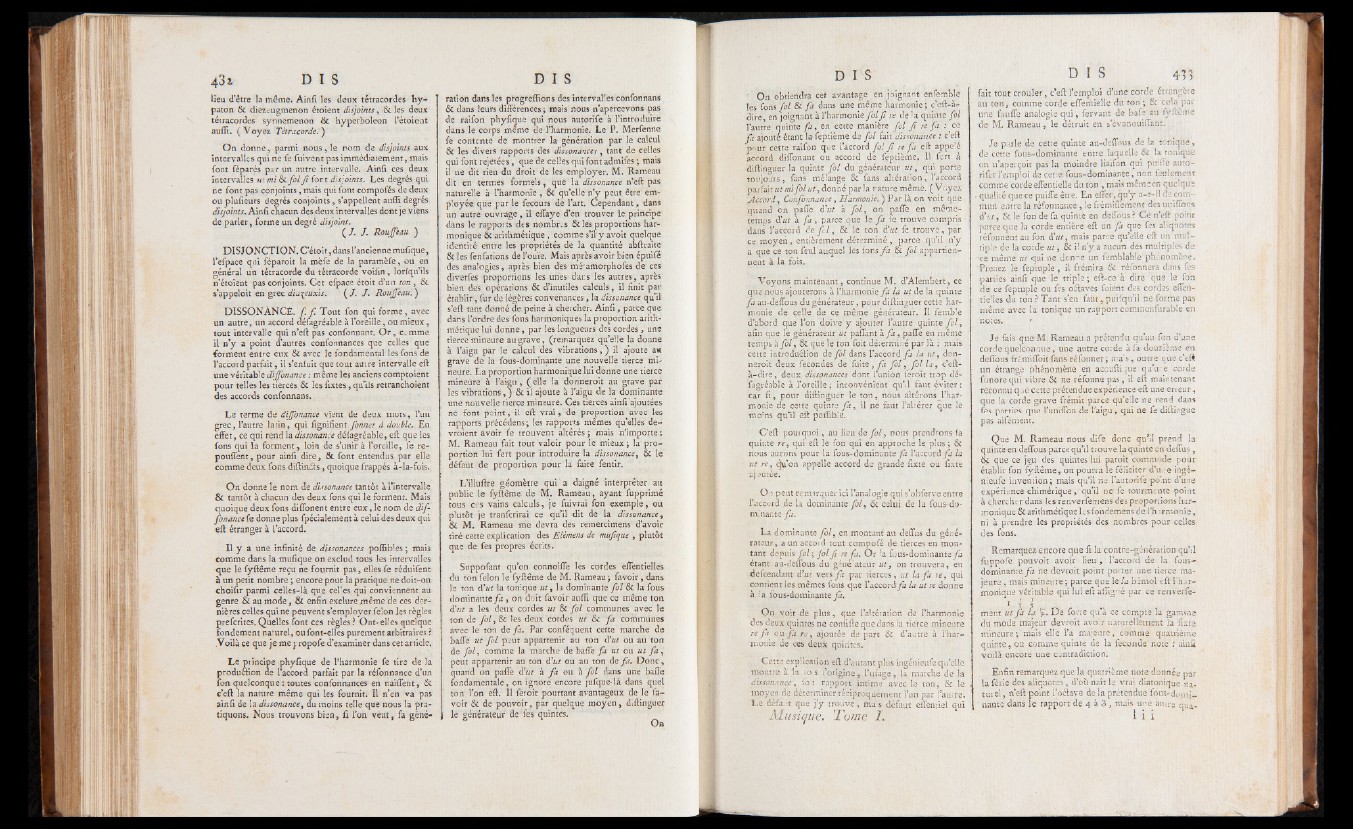
lieu d’être la même. Ainfi les deux tétracordes hy -
paton & diezeugmenon étoient disjoints, & les deux
tétracordes synnemenon & hyperboleon l*étoient
auffi. ( Voyez Tétracorde. )
On donne, parmi nous, le nom de disjoints aux
intervalles qui ne fe fuivent pas immédiatement, mais
font féparés par un autre intervalle. Ainfi ces deux
intervalles ut mi & fo l f i Cont disjoints. Les degrés qui
ne font pas conjoints, mais qui font compofés de deux
ou pîufieurs degrés conjoints, s’appellent auffi degrés
disjoints. Ainfi chacun des deux intervalles dont je viens
de parler, forme un degré disjoint.
( J. J. Rouffeau. )
DISJONCTION. C ’étoit, dans l’ancienne mufique,
l’efpace qui féparoit la mèfe de la paramèfe, ou en
général un tétracorde du tétracorde voifin, lorfqu’ils
n’étoient pas conjoints. Cet efpace étoit d’un ton, &
s’appeloit en grec dia\euxis. ( J. J. Rouffeau. )
DISSONANCE, f f i Tout fon qui forme, avec
un autre, un accord délagréable à l’oreille, ou mieux,
tout intervalle qui n’eft pas confonnant. O r , cc-mme
il n’y a point d’autres confonnances que celles que
forment entre eux & avec le fondamental les fons de
l’accord parfait, il s’enluit que tout autre intervalle eft
une véritable diffonance : même les anciens comptoient
pour telles les tierces & les fixtes, qu’ils retranchoient
des accords confonnans.
Le terme de diffonance vient de deux mots, l’un
grec, l’autre latin, qui lignifient fonner à double. En
effet, ce qui rend la dissonance délagréable, eft que les
fons qui la forment, loin de s’unir à l’oreille, fe repouffent,
pour ainfi dire, & font entendus par elle
comme deux fons diftinéts, quoique frappés à-la-fois.,
On donne le nom de dissonance tantôt à l’intervalle
& tantôt à chacun des deux fons qui le forment. Mais
quoique deux fons diffonent entre eux, le nom de diffonance
fe donne plus fpécialement à celui des deux qui
eft étranger à l’accord.
Il y a une infinité de dissonances poffibles ; mais
comme dans la mufique on exclud tous les intervalles
que le fyftême reçu ne fournit pas, elles fie réduifent
à un petit nombre ; encore pour la pratique ne doit-on
choifir parmi celles-là que cel'es qui conviennent au
genre & au mode , & enfin exclure même de ces dernières
celles qui ne peuvent s’employer félon les règles
prefcrites. Quelles font ces règles? Ont-elles quelque
fondement naturel, ou font-elles purement arbitraires ?
.Voilà ce que je me propofe d’examiner dans cet article.
Le principe phyfique de l’harmonie fe tire de la
produâion de l’accord parfait par la réfonnance d’un
fon quelconque : toutes confonnances en naiffent, &
c’eft la nature même qui les fournit. Il n’en va pas
ainfi de la dissonance, du moins telle que nous la pratiquons.
Nous trouvons bien, fi l’on veut, fa génération
dans les progreffions des intervalles confonnans
& dans leurs différences ; mais nous n’apercevons pas
de raifon phyficjue qui nous àutorife à l’introduire
dans le corps meme de l’harmonie. Le P. Merfenne
fe contente de montrer la génération par le calcul
& les divers rapports des dissonances, tant de celles
qui font rejetées, que de celles qui font admifes ; mais
il ne dit rien du droit de les employer. M. Rameau
dit en termes formels, que la dissonance n’eft pas
naturelle à l’harmonie, & qu’elle n’y peut être employée
que par le fecours de l’art. Cependant, dans
un autre ouvrage, il effaye d’en trouver le principe
dans le rappotts des nombres & les proportions harmonique
& arithmétique , comme s’il y avoit quelque
identité entre les propriétés de la quantité abftraite
& les fenfations de l’ouïe. Mais après avoir bien épuifé
des analogies, après bien des mé'amorphofes de ces
diverfes proportions les unes dat:s les autres, après
bien des opérations & d’inutiles calculs, il finit par
établir, fur de légères convenances, la dissonance qu’il
s’eft tant donné de.peine à chercher. Ainfi, parce que
dans l’ordre des fons harmoniques la proportion arithmétique
lui donne, par les longueurs des cordes 3 une
tierce mineure au grave, (remarquez qu’elle la donne
à l’aigu par le calcul des vibrations, ) il ajoute a«
grave de la fous-dominante une nouvelle tierce mineure.
La proportion harmonique lui donne une tierce
mineure à l’aigu, (elle la donneroit au grave pat
les vibrations, ) & il ajoute à l’aigu de la dominante
une nouvelle tierce mineure. Ces tierces ainfTajoutées
ne font peint, il eft vrai , de proportion avec les
rapports précédens; les rapports mêmes qu’elles devraient
avoir fe trouvent altérés ; mais n’importe :
M. Rameau fait tout valoir pour le mieux ; la proportion
lui fert pour introduire la dissonance, & le
défaut de proportion pour la faire fentir.
L’illuftre géomètre qui a daigné interpréter au
public le fyftême de M. Rameau, ayant fupprimé
tous ces vains calculs, je fuivrai fon exemple, ou
plutôt je tranferirai ce qu’il dit de la dissonance,
& M. Rameau me devra des remercîmens d’avoir
tiré cette explication des Elémens de mufique , plutôt
que de fes propres écrits.
Suppofant qu’on connoiffe les cordes effentielles
du ton félon le fyftême de M. Rameau ; favoir , dans
le ton d’ut la tonique ut, la dominante /o/ & la fous
dominante f a , on doit favoir auffi que ce même ton
d'ut a les deux cordes ut & fo l communes avec le
ton de fo l, & les deux cordes ut & fa communes
avec le ton de fa. Par conféquent cette marche de
baffe ut fo l peut appartenir au ton d’ut ou au ton
de fo l, comme la marche de baffe fa ut ôu ut f a ,
peut appartenir au ton d’ut ou au ton de fa. Donc,
quand on paffe d’ut à fa ou à fol dans une baffe
fondamentale, on ignore encore jufque-là dans quel
ton l’on eft. Il feroit pourtant avantageux de le favoir
& de pouvoir, par quelque moyen, diftinguer
le générateur’de fes quintes.
° 1 A -
• On obtiendra cet avantage^ en joignant enfemble
les fons fol & fa dans une même harmonie ; c’eft-à-
dire, en joignant à l’harmonie fo l f i re de la quinte fol
l’autre quinte fa , en cette manière fo l f i re fa : ce
fa ajouté étant la feptième de fol fait dissonance : c’eft
pour cette raifon que l’accord fol f i re fa eft appelé
accord diffonant ou accord de feptième. Il fert à
-diftinguer la quinte fo l du générateur ut, qui porte
toujours, fans mélange & fans altération, l’accord
parfait ut mi fol ut, donné par la rature même. ( Voyez
Accord, Confonnance, Harmonie. ) Par là on voit que
quand on paffe d’ut à fo l, on paffe en même-
temps d'ut à fa , parce que le fa fe trouve compris
dans l’accord de f o l , & le ton d’ut fe trouve, par
ce moyen , entièrement déterminé, parce qu’il n’y
a que ce ton feul auquel les ions fa & fol appartiennent
à la fois.
Voyons maintenant, continue M. d’Alembert, ce
que nous ajouterons à l’harmonie fa la ut de la quinte
fa au-deffous du générateur, pour diftinguer cette harmonie
de celle de ce même générateur. Il femb'.e
d’abord que l’on doive y ajouter l’autre quinte fo l,
afin que le générateur ut paffant à f a , paffe en même
temps à fo l, & que le ton foit déterminé par là : mais
cette introduélion de fo l dans l’accord, fa la ut, don-
hsroit deux fécondés de fuite, f i f o l , fol la, c’eft-
à-dire, deux disspnances dont l’union feroit trop désagréable
à l’oreille ; inconvénient qu’il faut éviter :
car f i , pour diftinguer le ton, nous altérons l’harmonie
de cette quinte fa , il ne faut l’altérer que le
mo:ns qu’il eft poffible.
C ’eft pourquoi, au lieu de fo l, nous prendrons fa
quinte re, qui eft le fon qui en approche le plus ; &
nous aurons pour la fous-dominante fa l’accord fa la
ut re, qyfon appelle accord de grande fixte ou fixte
ajoutée'.
On peut remarquer ici l’analogie qui s’ohferve entre
l’accord .de la dominante fo l, & celui de la fous-dominante
fa.
La dominante fo l, en montant au deffus du générateur,
a un accord tout compofé de tierces en montant
depuis fol ; Jol f i re fa. Or la fous-dominante fa
étant au-deffous du géné ateur ut, on trouvera, en
defeendant d’ut vers fa par tierces, ut la fa re, qui
contient l es mêmes fons que l’accord fa la ut re donne
à !a fous-dominante fa.
On voit de plus, que l’altération de l’harmonie
des deux quintes ne confifte que dans la tierce mineure
re fa ou f a re, ajoutée de part & d’autre à l’harmonie
de ces deux quintes.
Cette explication eft d’autant plus ingénieufe qu’elle
montre à la ios l’origine, l’ufage, la marche de la
dissonance,, fon rapport intime avec le ton, & le
moyen de déterminer réciproquement l’un par l’ancre.
Le défait que j’y trouve, ma s défaut effentiel qui
Musique. Tome 1.
fait tout crouler, c’eft l’emploi d’une corde étrangère
au ton, comme corde effeniielle du ton ; & cela par
une fauffe analogie qui, fervant de bafe au fyftême
de M. Rameau, le détruit en s’évanouiffant.
Je parlé de cette quinte au-deffous de la tonique,
de cette fous-dominante entre laquelle & la tonique
on n’aperçoit pas la moindre liaifon qui pu’.ffe auto-
rifer l’emploi de cette fous-dominante, non feulement
comme cordeeffentielle du ton , mais même en quelque
qualité que ce puiffe être. En effet', qu’y a-f-sl de commun
entre la réfonnance, le frémiffement des unifions
d’ut, & le fon de fa quinte en deffoüs ? Ce n’eft point
parce que la corde entière eft un fa que fes ahqüotes
réfonnent au fon d’ut, mais parce qu’elle eft un multiple
de la corde ut, & il n’y a aucun des multiples de
ce même ut qui ne donne un femblable phénomène.
Prenez le feptuple, il frémira & réformera dans fés
parties ainfi que le triple; eft-ce à dire que le fon
de ce feptuple ou fes o&aves foient des cordes effentielles
du ton? Tant s’en faut, puisqu’il ne forme pas
même avec la tonique un rapport ccmmenfurabie en
notes. |
Je fais que M. Rameau a prétendu qu’au fon d’une
corde quelconque, une autre corde à fa douzième en
deffous frémiffoit fans r-éfonner ; tna's , outre que c ’e f t
un étrange phénomène en accu fti que qu’une corde
fonorequi vibre & ne réfonne pas, il eft maintenant
reconnu que cette prétendue expérience eft une erreur,
que la corde grave frémit parce qu’e'le ne rend dans
fes parties que Tuniffon de l’aigu , qui ne fe diftingue
pas aifément.
Que M. Rameau nous dife donc qu’il prend la
quinte en deffous parce qu’il trouve la quinte en deffus ,
Ôç que ce jeu des quintes lui paroît commode pour
établir fon fyftême, on pourra le féliciter d’uee ingénieufe
invention ; mais qu’il ne l’autorife point d’une
expérience chimérique, qu’il ne fe tourmente point
à chercher dans les renverfemens des proponions harmonique
& arithmétique les fondemens de l’h • rmo nie,
ni à prendre les propriétés des nombres pour celles
des fons.
Remarquez encore que fi la contre-génération qu’il
fuppofe pouvoit avoir lieu , l'accord de la fous-
dominameq/vz ne devroit point porter une tierce majeure
, mais mineure ; parce que le la bémol eft l’harmonique
véritable qui lui eft affigné par ce renverfe-
C i ?
ment ut fa la £. De forte qu’a ce compte la gamme
du mode majeur devroit avoir naturellement la fixte
mineure : mais elle l’a majeure, comme quatrième
quinte, ou comme quinte de la fécondé' note : ainfi
voilà encore une contradiction.
Enfin remarquez que la quatrième note donnée par
la férié des aliquotes, d’oii naît le vrai diatonique naturel
, n’eft point l’o<ftave de la prétendue fous-dominante
dans le rapport de 4 à 3 , mais une au ire qua