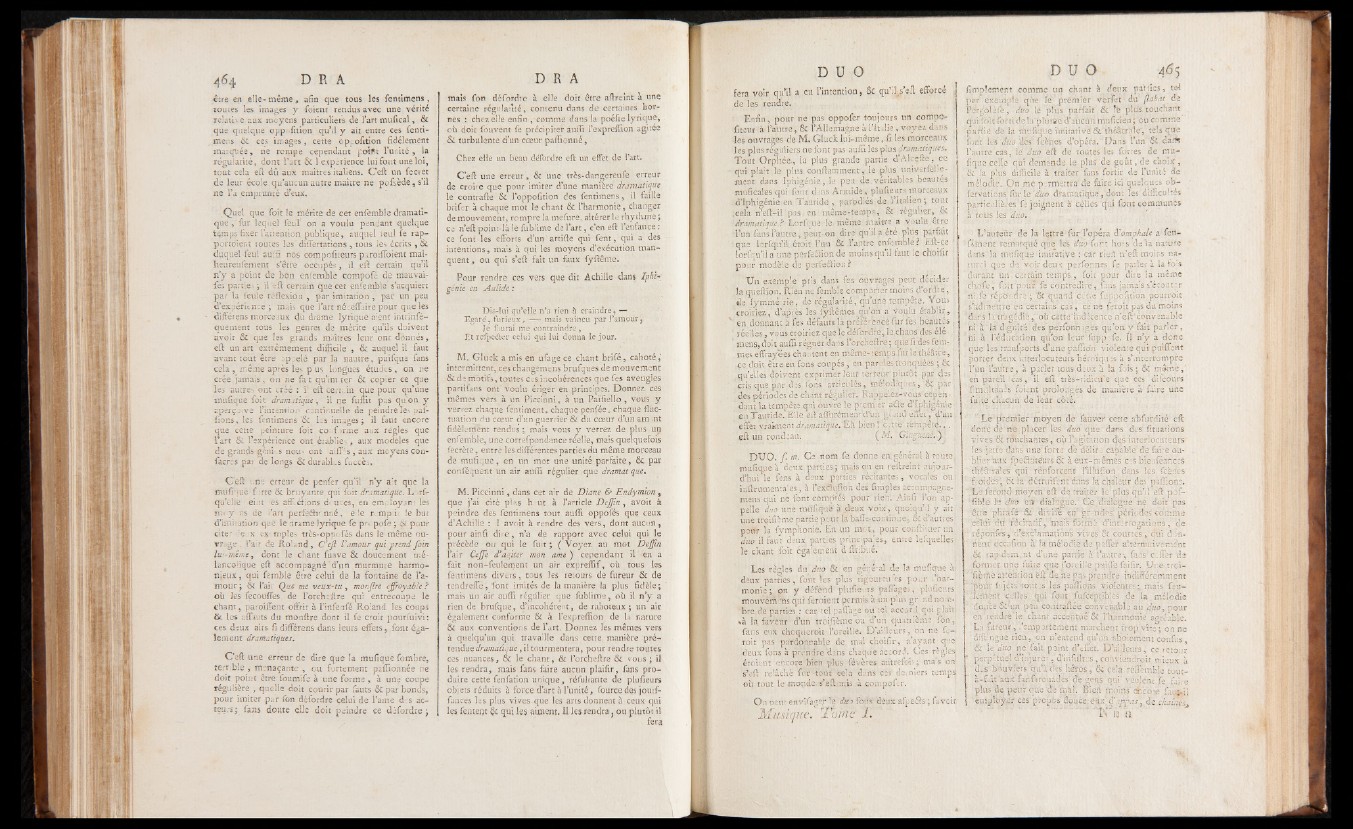
être en elle-même, afin que tous les fentimens,
toutes les images y foient rendus avec une vérité
relatife aux moyens particuliers de l’art mufical, &
que quelque opposition qu’il y ait entre ces fenti-
mens & ces images, cette oppofition fidèlement
marquée, ne rompe cependant point l’unité, la
régularité, dont l’art & 1 expérience lui font une loi,
tout cela eft dû aux maîtres italiens. Ceft un fecret
de leur école qu’aucun autre maître ne pofsède 3 s’il
11e l’a emprunté d’eux.
Quel que foit le mérite de cet enfemble dramatique
, fur lequel feul on a voulu pendant quelque
tqmps fixer l’attention publique, auquel leul fe rap-
portoient toutes les differtations , tous les écrits , &
duquel Seul auffi nos compofiteprs paroiffoient mal-
heureufement s’être occupés, il eft certain qu’il
n’y a point de bon enfemble compofé de mauvaises
partiel ; il eft certain que cet enfemble s’acquiert
par la feule réflexion , par imitation , par un peu
d’expérience ; mais que l’art néceflaire pour que les
différens morceaux du drame lyrique aient intrinfé-
quement tous les genres de mérite qu’ils doivent
avoir & que les grands maîtres leur ont donnés,
eft un art extrêmement difficile , & auquel i l . faut
avant tout être appelé par la nautre, puifqus Sans
cela, même après les p us longues études, on ne
crée jamais , on ne fa t qu’im ter & copier ce que
les autre* ont créé : i! eft certain que pour qu’une
mufique foit dramatique, il ne fumt pas qu'on y
aperçoive l’intention continuelle de peindre les pallions,
les fentimens'& les images ; il faut encore
que cette peinture foit conforme aux règles que
l’art & l’expérience ont piafclies, aux modèles que
de grands géni. s npu* ont laiffés , aux moyens çon-
facrés .par de longs & durables fuccès,
C'eft -ne erreur de penfer qu’il n’y a't que la
müfi’quéSorte & bruyante qui foit dramatique. Ivr f-
qu’elle ; eint es aff. étions d» uces, en employant les
m«.y ns de i’art perfeéhrnné, e-!e rempli le but
d’imitation que le drame lyrique fe prepofe ; & pour
citer deux ex mples très»oppcfés dans le même ouvrage
; l’air d.e Roland, C'ejl l'amour qui prend foin
lu:-même, dont le chant fuave & doucement mélancolique
eft accompagné d’un murmure harmonieux
, qui femble être celui de la fontaine de l’amour;
& l’air Que me veux-tu, monjlre effroyable ?
où les fecoufles de l’orchefire qui entrecoupe le
chant, parodient offrir à l’infenfé Roland les coups
& les affauts du monftre dont il fe croit pourfuivi:
ces deux airs fi différens dans leurs effets, font également
dramatiques.
C ’eft une erreur de dire que la mufique fombre,
terrible , menaçante , ou fortement paflionnée ne
doit point être foumife à une forme, à une coupe
régulière , quelle doit courir par fauts & par bonds,
pour imiter par fon défordre celui de l’aine des acteurs;
fans doute elle doit peindre ce défordre;
mais fon défordre à elle doit être aftreint à une
certaine régularité, contenu dans de certaines bornes
: chez elle enfin , comme dans la poéfie lyrique,
ou doit fouvent fe précipiter auffi l’exprefîion agitée
& turbulente d’un coeur paflionné,
Chez elle un beap défordre eft un effet de l’art.
C ’eft une erreur , & une très-dangereufe erreur
de croire que pour imiter d’une manière dramatique
le contrafte & l’oppofition des fentimens, il faille
brifer à chaque mot le chant & l’harmonie, changer
de mouvement, rompre la mefure, altérer le rhythmè ;
ce n’eft point-là lè fubürne de l’art, c’en eft l’enfance :
ce font les efforts d’un artifte qui fent, qui a des
intentions, mais à qui les moyens d’exécution manquent
, ou qui s’eft fait un faux fyftême.
Pour rendre ces vers que dit Achille dans Iphigénie
en AuLide :
Dis-lui qu’elle n’a rien à craindre, — ■
Egaré, furieux, ■— mais vaincu par l’amour.
Je finirai me contraindre,
Et reîpeder ceiui qui lui donna le jour.
M. Gluck a mis en ufage ce chant brifé , cahoté ,'
intermittent, ces ch ange mens brufques de mouvement
& de motifs, toutes ces incohérences que fes aveugles
partions ont' voulu ériger en principes. Donnez ces
mêmes vers à un Piccinni, à un Païfièllo, vous y
verrez chaque fentiment, chaque penfée, chaque fluctuation
du coeur d’un guerrier & du coeur d’un amant
fidèlement rendus; mais vous y verrez de plus un
enfemble, une correfpondance réelle, mais quelquefois
fecrète, entre les différentes parties du même morceau
de mufique, en un mot une unité parfaite, & par
conféquent un air auffi régulier que dramat que.
M. Piccinni, dans cet air de Diane & Endymion ,
que j’ai cité plk.s h ut à l’article DeJJin, avoit à
peindre des fentimens tout auffi oppofés que ceux
d’Achille : 1 avoit à rendre des vers, dont aucun,
pour ainfi dire, n’a de rapport avec celui qui le
récède ou qui le fuit ; ( Voyez au mot DeJJin
air Ceffe d'agiter mon ame ) cependant il en a
fait non-feulement un air expreflif, où tous les
fentimens divers, tous les retours de fureur & de
tendrefle, font imités de la manière la plus fidèle;
mais un air auffi régtflier que fublime, où il n’y a
rien de brufque, d’incohérent, de raboteux; un air
également conforme & à l’expreflion de la nature
& aux conventions de l’art. Donnez les mêmes vers
à quelqu’un qui travaille dans cette manière prétendue
dramatique, il tourmentera, pour rendre toutes
ces nuances, & le chant, & l’orcheftre & vous ; il
les rendra, mais fans faire aucun plaifir, fans produire
cette fenfation unique, réfultante de plufieurs
objets réduits à force d’art à l’unité, fource des jouif-
fances Iss plus vives que les arts donnent à ceux qui
les fentent & qui les aiment. Il les rendra, ou plutôt il
fera voir qu’il a eu l’intention, & qu’ij^s’efl efforcé ..
de les rendre.
Enfin, pour ne pas oppofer toujours un compo-
fiteur-à l’autre, & l’Allemagne à L’Julie, voyez dans •
les ouvrages de M. Gluck lui-même, fi les morceaux •
les plus réguliers ne font pas auffi les plus dramatiques.
Tout Orphée-, la plus grande partie d’Alcefte, ce
qui plaît le plus conftammént ,../le plus;univerfêlie- '
ment dans Iphigénie , 1e .peu de.véritables beautés
muficales qui font dans Armide, plufieurs morceaux
d’Iphigénie en Tauride , parodiés de.l’Italien ; tout
;cela n’eft-il pas > en même-temps, & .régulier, *
dramatique,?■ Lorfque le, meme maître a voulu,etre :
l’un fans l’autre, peut-on dire' qu’i l#. été-plus parfait j
que lorfqu’il étoit l’un & l’antre enfemble! Eft-ce *
lorfqu’il a une perfeéfionde moins qu’il faut le choifir ;
pour modèle de perfeétion?
Un exemple pris dans fes ouvrages peut décider
la.quëftiôn. Rien ne femble comporter moins d’ordre,
de fymmé'i'iè, de régularité , qu’ùnê tempête. Vous
croiriez, d’après les fyftêriies cjupfi a Voulu .établir, ,
en donnant à fes défauts la préférencé fur fes beautés .
; réelles -, vous croiriez que le défordre, le chaos des éle -
mens, doit auffi régner dans l’orcheftre ; que fi des femmes
effrayees chantent en même-temps.fur le théâtre, '
ce doit, être en fions coupés, en par olès tronquées ; & •;
qu’elles doivent exprimer leur terreur'plutôt par des ) I
cris que par des ions articulés, mélodiques, & par L :
des périodes de chaut réguiiefi. Rappélëz^vous ce.péh-
dant la tempête qui ouvré le premier'acle d’Iphigéiïie <
enTaiiride. Elle éfi aflurémènr d’un grand effet, d’un
effet vraknent dramatique. Eli bien î' .cçttëitëtnpêté.. .
eft un rondeau. . (M. Gingiiene. ) i
DUO. f m. Ce nom fe donne en, général à touteb
mufique- à deux, parties ; mais on en reftremt aüjoar-1
d’hui le fen-s à deux parties récitantes, vocales ou;,
inftrumenta’.es, à l’exêluftoh des {impies accompagne^
mens qui ne font comptés pour rien'. Ainfi l’on ap-1
pelle duo une mufique' à deux voix, quoiqu’il y ait -
une trqifième partie pe ur la baiïs-çontinue-, & d’autres î
pour la fymphonie. En un mot, pour conftiuier un
duo il faut deux parties principales, entre lesquelles;
le chant foit également d ftribué.
Les régies du duo & en gépé-al de la mufique àjï
deux parties, font les plus rigoureufes pour i’iiar-;
monie; on y défènd plufieurs paffages, plufieurs;
mouvérnr'ns qui'feroientpermisà.;un plus gr adnom-j
'bre.de parties : car- tel paÇage ou tel accord qui-plaît;
*à la faveur d’un troifième ou d’un quatrième fon ,;
fans eux chcqueroit l’oreille* D’ailleurs , on ne fe-j
' roit pas pardonnable de mal choifir, n’ayant que;
deux fons à prendre dans chaque accord. Ces règles
étoient encore bien plus févères autrefois; ma.s onj
s’eft relâché fut tout cela dans ces derniers temps*
où tout le monde. s’ èlEmis .à comppfcr.
On peut en vifag'ejr !e duo forîs deux afp e61s ; faveir
M -U s i( jiie . 'T om e 1 .
fimpîement comme un chant à deux parties, tel
par exemple qùe lé ' premier verfet • dif (labat dé
PeVgolefè, duo lô pîiis paffait & ïe plut touchant
qui.foit forti de La p 1 urne d’aucùh muficien ; ou comme
paffiê dë la mufique Vniitàtivè' S^'in^âtr’ale^ tels que
font les duo dés fcèhes d’opéra. Dans l’un & darfç
l’autre cas, l é duo eft de routes les fortes de mufique
celle qui demande le plus de goût, de choix ,
& fa plus difficile à traiter fans fortir de l’unité de
mélodie. On me permettra'de faire ici quelques ob-
ïervaiions' fur le ’dîio dramatique, dont les difficultés
articùliè.-es Tè joignent a Cçlies qui font communes
tous les' duo.
L’auteur de la lettre fur l’opéra d'omphale a fen-
- filment remarqué que les dùo lor.t hois: delà nature •
dans'la mu fiqu.e i ni i r at ive : car rie il n’eft moins naturel
que de voir deu x perfonnes fie parler à la fois
durant uni certain temps,, foie pour dire la même
chofe, fiôit pour fe cônîréairë, fans jamais s’écouter
ni.fie répondre’; & quand cefie fiappofition pourroit
s’admettre én certains casce ne feroît pas du moins
'dansLVtrsgëdïë,' où cëtteffîïdécëricè'n’eft'cônvenable
:ni'a la dignité des perfonhâges qii’on y fait parler,
ni à réducation qu’on leurTuppofe. Il n’y a donc
que les rranfports d’une paffio'n violente qui puiffent
porter deux interlocuteurs héroïques à s’interrompre
l’un l’autre, à parler tous.deux à la fois; & même,
en pareil fcas,- il eft 'très-ridicu'e que ces difeours
fifmühàn-S foient prolongés de manière » faire une
■ fui#! chacun de leur côté.
Le:premier moyen dé'faùvef cette abfurdité eft
donc de ne . placer Les duo que dans desSituations
vives & touchantes, ou l’agitation des interlocuteurs
les jettè dans une' forte de delir-:- capable' de faire oublier
'aux fpe&àtëurs & à eux- mêmes ce s bieaféances
‘ théâtfâles 'qui renforcent l’illufion ; dans lès ficèues
■ ftoider, & la détruifient dans fa chaleur des'pafti'ons.
Le fécond rrioyen'eft dé traiter le plus qu’il eft pof-
•fible lé duo • dialogue.'; Ge /<Mlbgüè- nç doit pas
être pHfàfé- '& . dTyifiê• en::gfmdes.; périodes-comme
• cêiiiv dtt récitatif, maiVformé d’interrogatioris , cle
: répeinfés, d’ëxèlamàtiôns vives 8t courtes, qui don-
nenf cccafion;à'la mélodie de paffer alternativement
& rapidem.nt d’une partie à l’autre-, fans; c:ffer de
fqrmer une luité que l’oreille paiiTe faifir. Une- trei-
' fi^tné attention eft de.,he pas prendre indifféremment
' "pour fujéts nout js'lés pallions violentes; mais feu-
.'lement celles, qüi font fufcéptiblès de la mélodie
" .douce Sl un peu contrâftéé .Cqn'ye^blê'aü duo, pour
éh '..rendre le. cliant accentué & rharmonie agréable.
La fiirëur,, /emportement marchent trop vite ; on ne
diftîngüe rien, on n-’entend qu’un aboiement confiis
: fk U duo 'ne fait, point d’effet. D’ailleurs, ce retour
; perpétuel d’in'juféf4’inftlltcs, coiivlendroù mieux à
d s bouviers qu’a d'és héros, & cela reffembîe tout-
à-f-it’aûfefanfàro'nâdésî <fe:gen$'; qqT ycujent Te faire
plus àe peuf que de mal! Éien moins efacofe fa^teii
employer ces propos douce; e u x q’rÿ^£. de chaînes