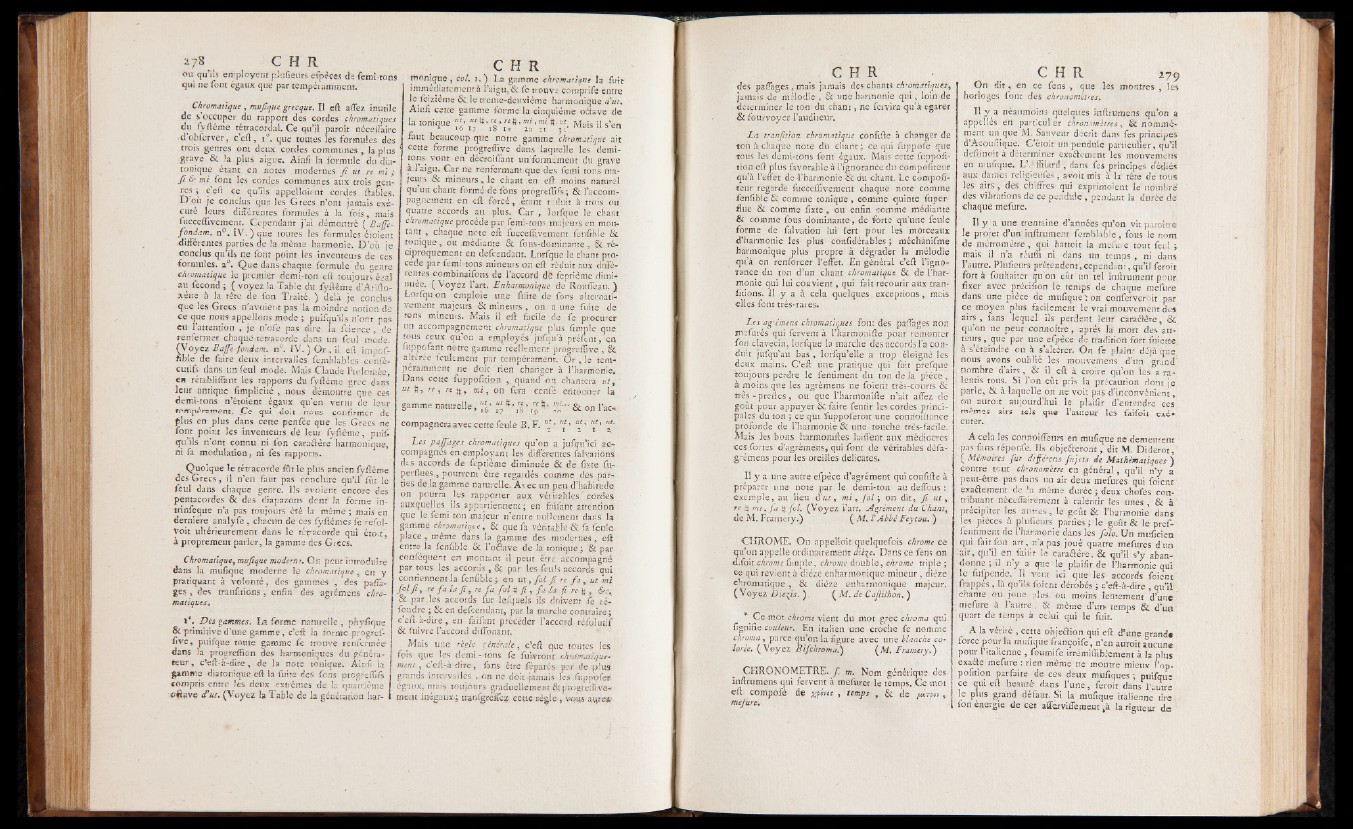
278 C H R
ou qu’ils errployem plufieurs eipèces de femi-ton»
qui ne font égaux que par tempéxamment.
Chromatique , mufique grecque. Il eft aflez inutile
de s’occuper du rapport des cordes chromatiques
du fÿftême tétracQr-dal. Ce qu’il paroît néceffaire
d oblerver, c’eft, i°. que toutes les formules des
trois genres ont deux cordes communes , la plus
grave & la plus aigue. Ainfi la formule du diatonique
étant en notes modernes f i ut re mi ;
f i & mi font les cordes communes aux trois «*en-
re? ’ ce qu’ils appelloient cordes .fiables,
D.cii je conclus que les Grecs n’ont jamais exécuté
leurs différentes formules à la fois , mais
fucceffivement. Cependant j ’ai démontré ( Baffe-
fondam. n°. IV . ) que toutes les formules étoiem
différentes parties de la même harmonie. D ’où je
conclus qu’ils ne font point les inventeurs de ces
formules. 2°. Que dans chaque, formule du genre
chromatique le premier demi-ton eft toujours és»al
au fécond ; ( voyez la Table du fyftême d’Ariflo-
xène à la tête de fon Traité, ) delà je conclus
que les Grecs n'avoient pas la moindre notion de
ce que nous appelions mode ; puifqu’ils n’ont pas
eu l’attention , je n’ofe pas dire la fcience , de
renfermer chaque-tétracorde .dans un féul mode.
(V oyez Baffe-fondant. n°. IV. ) Or ., il eft impof-
nble de faire deux intervalles femblables cenfé-
cutifs dans un feul mode. Mais Claude Ptoloméç,
en rétabli fiant les rapports du fyftême grec dans
leur antique fimplicité , nous démontre que ces
demi-tons n’étoient égaux qu’en vertu de leur
tempérament. Ce qui doit nous confirmer de
plus en plus dans cette penfée que les Grecs ne
font point les inventeurs dé leur fyftême, & S 3
qu’ils n’ont connu ni fon caraâère harmonique,
ni fa modulation, ni fes rapports.
Quoique le tétracorde fût le plus ancien fyfiême
des Grecs, il n’en faut pas çonclurè qu’il fût le
feul dans chaque genre. Ils avoient encore des
pentacordes & des diapazons dont' la forme in-
trinfeque n’a pas toujours été la même ; mais en
dernière analyfe , chacun de ces fyftêmes fe refol-
voit ultérieurement dans le tétracorde qui étoit
à proprement parler, la gamme des Grecs.
Chromatique, mufique moderne. On peut introduire
dans la mufique moderne le chromatique, en y
pratiquant à volonté, des gammes , des pafia-
g e s , des tranfitions, enfin des agrémens chromatiques^
i®. Des gammes. La forme naturelle , phyfique
& primitive d’une gamme, c’eff la forme progref-
fiv e , puifque toute gamme fe trouve renfermée'
dans la progreffion des harmoniques du générateur
, c’eft-à-dire, de la note tonique. Ainfi la
gamme diatonique eff la fuite des fons progreffifs
compris entre les deux extrêmes de la quatrième
0$ave <f ut. (Voyez la Table de la génération harc
H R
monîqitc, col. i . ) La gamme chromatique la fuît
immediatementà l’aigu, & fe trouve comprife entre
le feizième & J e trente-deuxième harmonique d'ut.
Ainfi cette gamme forme la cinquième oétave de
la tonique A Mais il s’en
faut beaucoup que notre gamme chromatique ait
cette forme progreflive dans laquelle les demi-
tons vont en décroi fiant uniformément du grave
à l’aigu. Car ne renfermant que des femi tons majeurs
.& mineurs , le chant en eft moins naturel
qu un chant formé de fions progreffifs; & l’accompagnement
en eff forcé, .étant réduit à trois ou
quatre accords au plus. Car , lorfque le chant
chromatique procède par femi-tons majeurs en montant
, chaque note eff fucceffivement fenfible &.
tonique, ou mediante & fous-dominante, & réciproquement
en defeendant. Lorfque le chant pro^
cédé par femi-tons mineurs on eff réduit aux différentes
combinaifons de l’accord dS feptième diminuée.
(V o y e z l’art. Enharmonique de Roufteau. \
Lorfqu on emploie une fuite de fons alternativement
$ majeurs & mineurs, on a une fuite de
tons mineurs. Mais il eff facile de fe procurer
un accompagnement chromatique plus fimple que
tous ceux qu’on a employés jofqu’à préfent, S
fuppofant notre gamme réellement progreffive , &
altérée feulement par tempérament. Or , 1e tem-
perazïiment ne doit rien changer à l ’harrflonie*
Dans cette fuppofition quand on chantera ut,
ut re, re%, mi, on fera cenfé entonner la
amine naturelle Él re y jBRJ i6 17 i3 19 ' & on l’ac-v
compagnera avec cette feule B. F. j | | “*» “É* “*•
Les pajfiages chromatiques qu’on a jufqu’ici ac-»
çompagnés en employant les différentes falvatiöns
dis accords- de feptième diminuée & de fixte fu-
perflues., pourront être regardés comme des par-,
fies de la gamme naturelle. Avec un peu d’habitude
on pourra les rapporter aux véritables^ cordes
auxquelles ils appartiennent; en faïfant attention
que le femi ton majeur n’entre nullement dans la
gamme chromatique, & que fa véritable & fa feule
place , même dans la gamme des modernes , eff
entre la fenfible & l’oSave de la tonique ; & par
confisquent en montant il peut être accompagné
par tous les accords , & par les-feuîs accords qui
contiennent la fenfible ; en u t, fo l f i re f a , ut mi
fo l f i , re fa la f i , re fa fo l $ f i , fa la fi re # , JSfa
& par .les accords fur iefquels ils doivent fe ré-
foudre ; & en defeendant, par la marche contraire ;
c’eff -à-dire, en faifant précéder l’accord réfolutif
& fuivre l’accord diffonànt,
Mais une règle cénérale, c’eff que toutes les.
fois que les demi - tons fe fuivront càfo~Muïi.q,tu-
ment, c’eff-à-dire, fans être féparcs prr de .plus
grands intervalles , on ne doit jamais les fuppofep.
égaux, toujours graduellement & progreffi ve-
ment inégaux; tçanfgreffez cette règle, vous atpe*'
c H R
des paflsges,mais jamais des chants chromatiques,
jamais de mélodie , & une harmonie q u i, loin de
déterminer le ton du chant, ne feivira qu’à égarer
& fourvoyer--l’auditeur.
La tranfition chromatique confiffe à changer de
ton à, chaque note du chant ; ce qui fuppofe que
tous les demi-tons font égaux. Mais cette ftippofi-
tion eff plus favorable à l’ignorance du compofiteur
qu’à l’effet de l’harmonie & du chant. Le compofiteur
regarde fucceffivement chaque note comme
fenfible & comme tonique , comme quinte fuper-
flue & comme fixte, ou enfin comme médiante
& comme fous dominante, de forte qu’une feule
forme de falvatiori lui fert pour les morceaux
d’harmonie les plus confidérables ; méchânifme
harmonique plus propre à dégrader la mélodie
qu’à en renforcer l’effet. En général c’eft l’ignorance
du ton d’un chant chromatique & de l’harmonie
qui lui convient, qui fait recourir aux trari-
fitions. il y a à cela -quelques exceptions, mais
elles font très-rares.
Les ag’émens chromatiques font des paffages non
snefurés qui fervent à l’harmoniffe pour remonter
fon clavecin, lorfque la marche des accords l’a conduit
jüfqu’au bas , lorfqu’elle a trop éloigné les'
deux mains. C ’eff une pratique qui fait prefque
toujours perdre le fentiment du ton de la pièce, j
à moins que les agrémens ne foient très-courts & !
îrès-preffes, ou que l’harmoniffe n’ait aflez - de I
goût pour appuyer & faire fentir les cordes princi- j
pales du ton ; ce qui fuppoferoit une connoiffance
profonde de l'harmonie & une touche très-facile.
Mais les bons harmoniffes laiffent aux médiocres j
•ces fortes d’agrémèns, qui font de véritables défa-
grémens pour les oreilles délicates.
Il y a une autre efpècc d’agrément qui confiffe à :
préparer une note par le demi-ton au deffous i
exemple, au lieu à'ut, m i, fo l', on dit, f i u t ,
re a nu, fa $ fol. (Voyez F art. Agrément du Chant,
de M. Framery.) ( M. l'Abbé Feyt&u. )
CHROME. On appellait'quelquefois chrome ce
qu’on appelle ordinairement diè^e. Dans ce fens on
difoit chrome fimple, chrome double, chrome triple ;
ce qui revient à dièze enharmonique mineur , dièze
chromatique , & dièze enharmonique majeur.
(V o y e z Diefis. ) . ( M. de Cafiilhon. )
Ce mot chrome vient du mot grec chroma qui
fignifie couleur. En italien une croche fe nomme
chroma, parce qu’on la figure avec une blanche colorée.
(V o y e z B i f chroma.) (M. Framery.)
CHRONOMETRE, ƒ m. Nom générique des I
inftrumens qui fervent à mefurer le temps. Ce mot
eff compofé de #poW , temps , & de /*rp«v,
mejure•
On d it, en ce fens , que les montres , les
horloges font des chronomètres.
11 y a néanmoins quelques inftrumens qu’on a
appelles en partxiil.er chronomètres, & nommément
un que M. Sauveur décrit dans fes principes
d’Acouüique. C ’étoit un-pendule particulier, qu’il
déftinoit à déterminer exaélcment les mouvemens
en mufique. L’Affiiard , dans fes principes dédiés
aux dames religieufes, avoit mis à la tête de tous
les airs , des chiffres qui exprimoient le nombre*
des vibrations de ce pendule , pendant la durée de
chaque mefure.
Il y a une trentaine d’années qu’on vit paroître
le projet d’un infiniment femblab'e, fous le nom
de métromètre , qui battoir la mefure tout feul ;
mais il n’a réufit ni dans un temps , ni dans
l’autre. Plufieurs prétendent,cependant,qu’il feroit
fort à foubaiter qu’on eût un tel infiniment pour
fixer avec précifion le temps de chaque mefure
dans une pièce de mufique Aon coriferver.it par
ce moyen plus facilement le vrai mouvement des
■ airs , fans lequel ils perdent leur caractère, &
qu’on ne peut connoître, apres la mort des au-
| teurs, que par une efpèce de tradition fort {mette
à s’éteindre ou à s’altérer. On fe plaint déjà que
nous avons oublié les mouvemens d’iiri grand
. nombre d’airs, & il efi à croire qu’on les a ra-
f lentis tous. Si l’on eût pris la précaution dont je
parle, & à laquelle on ne voit pas d’inconvénient,
011 aurait aujourd'hui le plaifir d’entendre ces
mêmes airs tels que l’auteur les faifoit exécuter.
A cela les connoiffeurs en mufique ne demeurent
pas-fims réponfe. Ils objecteront, dit M. Diderot,'
’ ( Mémoires fur difé-ens fujets de Mathématiques )
contre tcut chronomètre en général, qu’il n’y a
peut-être pas dans un air deux mefures qui foient
exactement de la même durée ; deux chofes contribuant
nécefîairement à ralentir les unes , & à
précipiter les autres , le gcût & l’harmonie dans
les pièces à plufieurs parties ; le goût & le pref-
fentiment de l'harmonie dans les folo. Un muficien
qui fait fon art, n’a pas joué quatre mefures d'un
*,aif, qu’il en^faifit le earaâère, & qu’il s’y abandonne
; il n’y a que le plaifir de l’harmonie qui
le fufpende. Il veut ici que les accords foient
frappés , là qu’ils foient dérobés ; c’eft-à-dire , qu’il
chante ou joue plus ou moins lentement d’une
mefure a l’autre , 6c même d’un, temps & d’ua
quart de temps à celui qui le fuit.
A la vérité, cette objeâion qui efi d'une grande
force pour la mufique françoife, n’en aurait aucune
pour l’italienne , foumife irrémiffiblement à la plus
exaéte mefure : rien meme ne montre mieux l’op-
pofitiqn Darfaite de ces deux mufiques ; puifque
ce qui eft beauté dans l’une,' feroit dans l ’autre
le plus grand défaut. Si la mufique italienne tire ,
fon énergie de cet afferviffement jà la rigueur de