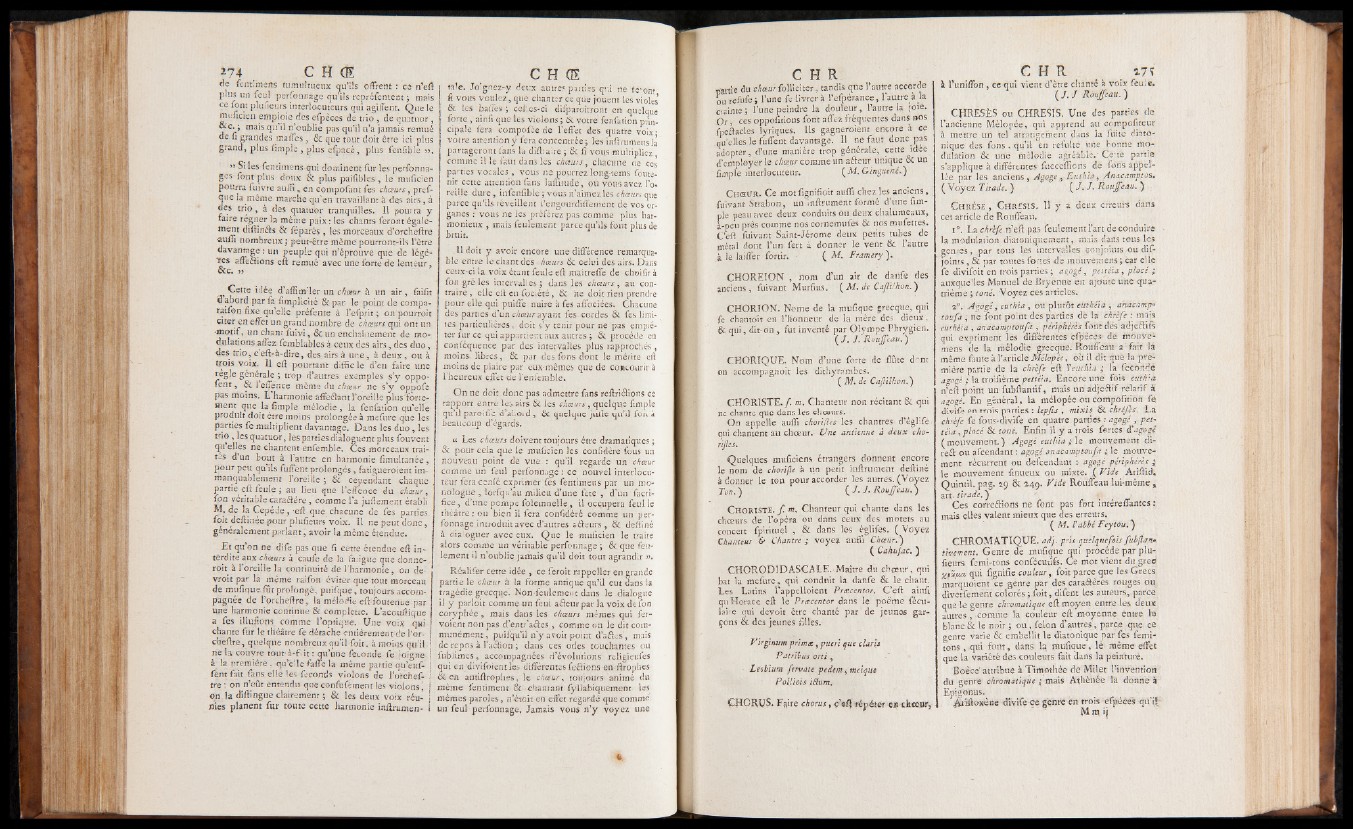
274 C H <È
de fentimens tumultueux qu’fis offrent : ce n’eft
plus un feul perfonnage qu’ils repréfentent ; mais
ce font pliiHeurs interlocuteurs qui agi fient. Que le
muficien emploie des efpèces de trio , de quatuor ,
& c . ; mais qu’il n’oublie pas qu’il n’a jamais remué
de fi grandes inaffes , & que tout doit être ici plus
grand, plus fimple, plus efpaçé, plus fenfible ».
» Si les fentimens qui dominent fur les perfonna-
ges font plus doux & plus paifibles , le muficien
pourra fuivre aufïi, en compofant fes choeurs, pref-
que la même marche qu'en travaillant à des airs, à
des trio, à des quatuor tranquilles. Il pourra y
faire régner la même paix: les chants feront également
diftinôs & féparés , les morceaux d’orcheftre
■ auffi nombreux ; peut-être même pourront-ils l’être
davantage : un peuple qui n’éprouve que de légères
affe&ions eft remué avec une forte de lenteur,
&c. »
_ ? Cette idee d’affim'ler un choeur à un air, fàifit
d abord par fa fimplicité & par le point de compa-
raifon fixe qu’elle préfente à l’efprit ; on pourroît
citer en effet un grand nombre de choeurs qui ont un
-motif, un chanr fmvi, 8c un enchaînement de modulations
affez femblables à ceux des airs, des duo,
des trio, c eft-à-dire, des airs à une, à deux, ou à
tj”ois voix. Il eft pourtant difhc le d’en faire une
générale ; trop d’autres exemples s’y oppo-
fén t, & l’efjence même du choeur ne s’y oppofe
pas moins. L harmonie affeélant l’oreille plus'forre-
ment que la fimple mélodie, la fenfation qu’elle
produit doit etre moins prolongée à mefure que les
parties fe multiplient davantage. Dans les duo, les
trio , les quatuor, les parties dialoguent plus fouvent
qu elles ne chantent enfemble. Ces morceaux traites
d’un bout à l’autre en harmonie fimultanée,
pour peu qu ils fuffent prolongés, fatigueroient im-
irianquablement l’oreille ; & cependant chaque
partie eft feule ; au lieu que l’elfence du choeur,
fpn véritable cara&ère, comme l’a juftement établi
M. de la Cepéde, eft que chacune de fes parties,
foit deftinée pour plufieurs voix. Il ne peut donc,
généralement parlant, avoir la même étendue.
Et qu’on ne dife pas que fi cette étendue eft interdite
aux choeurs à caule de la faiigue que donne-,
roit à l’oreille la continuité de l'harmonie, on de:
vroit par la même raifon éviter: que tout morceau
de mufique. fut prolongé, puifqûe, toujours accom-.
pagnée de l’orcheftre, la mélodie eft foutenüe par
une harmonie continue & complette. L’acouftique
a fes illusions comme l ’optique. Une voix qui
chante fur le théâtre fe détache entièrement d e l’or.
cbeftre, quelque nombreux qu’il foit. à moins qu’il
rie la couvre tout à-f it: qu’une fécondé fe joigne
à la première , qu’elle faffe la même partie qu’euf-
fènt fait fans elle les féconds violons de l’orohéf- !
tre ; on n’eût entendu queconfüfement les violons
on la diftingue clairemenr ; & les deux voix réu-
riies planent fur toute cette harmonie inftrumen-
C H OE
taie. Jo’gnez-y deux autre? paitie-s qui ne feront •
fi vous voulez, que chanter ce que jouent les violes
& les baffes ; celles-ci difparoîtront en quelque
forte, ainfi que les violons ; tk votre fenfation principale
fera compofée de l ’effet des quatre voix ;
votre attention y fera concentrée ; les inftrumensla
partageront fans la difttaire ; & fi-veus multipliez ,
comme il le faut dans les choeurs:, chacune cie ces
parties vocales , vous ne pourrez long-tems foute-
nir cette attention fans laffmide, ou vous avez l’oreille
dure, infenfible ; vous n’aimez les choeurs que
parce qu’ils réveillent i’engoufdilTeincnt de vos organes
: vous ne les préférez pas comme plus harmonieux
, mais feulement parce qu’ils font plus de
bruit.
.11 doit y avoir encore une différence remarquable
entre le chant des choeurs & celui des airs. Dans
ceux-ci la voix étant feule eft maitreffe de choifir à
fon gré les intervalles; dans les choeurs, au contraire,
elle eft en fociété, 8c rie doit rien prendre
pour elle qui puiffe nuire à fes aftbciées. Chacune
des parues d’un choeur ayant fes cordes & fes limites
particulières , doit s’y tenir pour ne pas empiéter
fur ce qui appartient aux autres ; & procède en
conféquence par des intervalles plus rapprochés ,
moins* libres, & par des fons dont le mérite eft
moins de plaire par eux-mêmes que de concourir à
l’heureux effet de fenfemble.
On ne doit donc pas admettre fans reftriélions ce
rapport entre les airs & les choeurs, quelque fimple
qu’il paroifie d’abord, 8c quelque jufte qu’il fon à
beaucoup d’égards.
« Les choeurs doivent toujours être dramatiques ;
& pour cela que le muficien les confidèré fous un
nouveau point de vue- : qu’il regarde un choeur
comme un feul perfonnage : ce nouvel interlocuteur
fera cenfé exprimer fes fentimens par un monologue
, iorfqu’au milieu d’une fête , d’un facri-
fice, d’une pompe folemnelle, il occupera feul le
théâtre : ou bien il fera confidéré comme un perfonnage
introduit avec d’autres séleurs, & deftiné
à dialoguer avec eux. Que le muficien le traite
alors comme un véritable perfonnage ; & que feulement
il n’oublie, jamais qu’il doit tout agrandir ».
Réalifer cette idée , ce feroit rappeller en grande
partie le choeur à la forme antique qu’il eut dans la
tragédie grecquei Non-feulement dans le dialogue
il y partait comme un feul aâeur par la voix de Ion
coryphée, mais dans les choeurs mêmes qui fer-
voient non pas d’en triades , comme on le dit communément,
puifqu’il n’y avoir point d’aéles', mais
de repos à ladion ; dans ces odes touchantes ou
fublimes, accompagnées d’évolutions religieufes
qui en divifoientles différentes fedions en ftropbes
& en antiftrophes, le choeur, toujours animé du
même fentiment & chantant fyllàbiquemenc les
mêmes paroles, n’étoit en effet regardé que comme'
un feul perfonnage. Jamais vous n’y voyez une
U
C H R
partie du choeur {o\\\citer, tandis que l’antre accorde
ou refufe; l’une fe livrer à l’efpérance, l'autre à la
crainte ; l’une peindre la douleur, l’autre la joie.
O r , ces oppofitions font affez fréquentes dans nos
;fpedacles lyriques. Ils gagneraient encore à ce
quelles le fuffent davantage. Il ne faut donc pas
adopter, d’une manière trop générale, cette idée
d’employer le choeur comme un adeur unique & un
fimple interlocuteur. {M.GingucnéT)
C hoeur. Ce mot fignifioit aufii chez les anciens, ,
fuivant Strabon, un infiniment formé d’une fimple
peau avec deux conduits ou deux chalumeaux,
à-peu près comme nos cornemufes & nos mufettes.
C ’eft fuivant Saint-Jérome deux petits tubes de
métal dont l’un fert à donner le vent & l’autre
à le laiffer for tir. - ( M. Framery).
CHOREION , nom d’un air de danf® des
anciens-, fuivant Murfius. {M . de Cajliihon.')
CHORTON. Nome de la mufique grecque, qui
fe chantait en l’honneur de la mère des dieux ,
8c qui, dit-on, fut inventé par Olympe Phrygien.
( J. J. Rouffeau.)
CHORIQUE. Nom d’une forte de flûte d nt
on accompagnoit les dithyrambes.
( M. de Caflilhon. )
CHORISTE. f m. Chanteur non récitant & qui
ne chante que dans les choeurs.
On appelle auffi chorifles les chantres d’êglife
qui chantent au choeur.- Une antienne à deux cho-
fiftes.
Quelques muficiens étrangers donnent encore
le nom de chorifie à un petit infiniment deftiné
adonner le ton pour accorder les autres. (Voyez
Ton, ) ( / . J. Rouffeau.)
C horiste, f m, Chanteur qui chante dans les
choeurs de l’opéra ou dans ceux des motets au
çoncert fpirituel , & dans les églifes. ( Voyez
Chanteur & Chantre ; voyez auffi Choeur. )
( Cahujac. )
CHORODIDA.SCALE. Maître du choeur, qui
bat la mefure, qui conduit la danfe & le chant.
Les Latins l’appelloient Proscentor. C ’eft aiiifi
qu Horace eft le Prcecentor dans le poème fécu-
laire qui devoit être chanté par de jeunes garçons
8c des jeunes filles.
Virginum primée, pue ri que claris
Patribus orti ,
Lesbium fervate pedern s rnciqut
Pollicis ittum.
CHORUS. Faire chorus, répéter «? eheeur,
C H R 2-7T
à l’uniffon, ce qui vient d’être chanté à voix feule.
( / . / R o u f eau.)
CHRÉSÈS ou CHRESIS. Une des parties de
l’ancienne Mélopée, qui apprend au compofiteur
à mettre un tel arrangement dans la fuite diatonique
des fons , qu’il en refulte une bonne modulation
& une mélodie agréable.' Ce-t'e partie
s’applique à différentes fucceffioris de fons appel-
lée par les anciens , Agoge i9 Euihiàj Anacamptcs,
( Voyez Tirade. ) ( /. ƒ. Rouffeau. )
C hrese , C h r Esis. Il y a deux erreurs dans
cet article de Rouffeau.
i°. La chrèfe n’eft pas feulement l’art de conduire
la modulation diatoniquement, mais dans tous les
genres, ,par tous les intervalles conjoints ou disjoints
, & par toutes fortes de mouvemens ; car elle
fe divifoit en trois parties ; azogè, pettèia, placé ;
auxquelles Manuel de Bryenne en ajoute une quatrième
; tonè. Vo yez ces articles.
2°. Açoge , çuthia , ou plutôt eütkêia , anncàmp**
toufa ; ne font point des parties de la ch'rèfe : niais
euthèia , ah a camp toufa■ ; périphérès font des adjéflift
qui expriment les différentes efpèces de riibuve-
mens de la mélodie grecque. Rouffeau a fait la
même faute à l’article Mélopée, ôü il dit que la première
partie de la chrefe eft Ve ut fila ; la fécondé
agogè } la troifième pettéia. Encore une' fois euihia
n’efî point un fubftantif, mais un àdjeélif relatif â
agogé. En général, la mélopée ou compofitiori fé
divife en trois parties : lepfis , mi xi s & chréfis.. La
chrèfe fe fous-divife en quatre parties : a gagé , pet-
téia, plocé & tonè. Enfin il y a trois fortes iïagogé
(mouvement.) Agogé euihia ;• le mouvement di-
reél ou afeendant : agogé anac amp toufa ; le mouvement
récurrent ou descendant : agogé périphérès ;
le mouvement finueux ou mixte. ( Vide Ariftid,
Quintil. pag. 29 & 249. Vide Rouffeau lui-même ,
art. tirade. ) | '
Ces correélions ne font pas fort intéreffantes î
mais elles valent mieux que des erreurs.
( M. Vabbé Feytou. )
CHROMATIQUE, adj. pris quelquefois fubfian«
tivement. Genre de mufique qui procède par plufieurs
femi-tons confécutifs. Ce mot vient du grec
x fîy '1*' qui fignifie couleur, foit parce que les Grecs
marquoient ce genre p r des caraâères rouges ou
diverfement colorés ; loit, difent les auteurs, parce
que le genre chromatique eft moyen entre les deux
autres, comme la couleur eft moyenne entre fe
blanc 8c le noir ; o u , félon d’autres , parce que ce
genre varie & embellit le diatonique par fes femi-
tons , -qui font, dans la mufique, le même effet
que la variété des couleurs fait dans la peinturé.
Boecé attribue à Timothée de Milet l’invention
du genre chromatique ^ tims Athénée la donne à
Epigo'nus.
^riftoxene diyife ce genre en trois efpèées qü’i!
M m ij