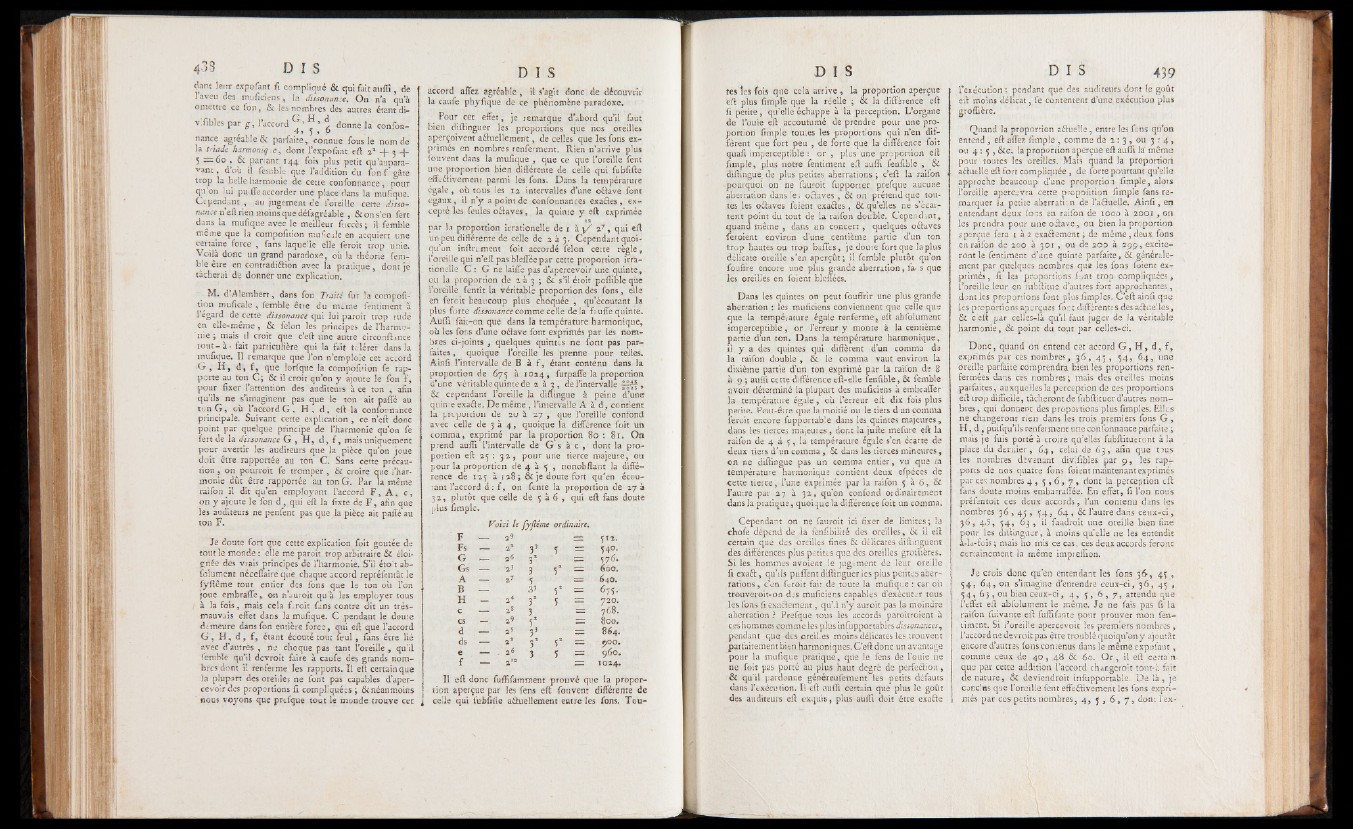
cjant l«itr expofant fi compliqué & qui fait auffi, de
l’aveu des muficiens, la dissonance. On n’a qu’à
omettre ce fon, & les nombres des autres étant divlfibles
par g , l’accord 9 ’ £ donne la confonnance
agréable & parfaite, connue fous le nom de
la triade harmoniq.e, dont l’expo faut eft 2a -j- j -j-
5 — « & partant 144 fois plus petit qu’auparavant
, q ou il femble que l’addition du fon f gâte
trop la belle harmonie de cette confonnance, pour
qu'on lui pu-fle accorder une place dans la mufique.
Cependant , au jugement de i’oreille cette dissonance
n’eft rien moins que défagréable , & on s’en fert
dans la mufique avec le meilleur fuecès ; il femble
même que la compofition muficale en acquiert une
certaine force , fans laquelie elle feroit trop unie.
Voilà donc un grand paradoxe, où la théorie femble
être en contradiction avec la pratique, dont je
tâcherai de donner une explication.
M. d’Alembert, dans fon Traité fur la compofition
muficale , femble être du même fentiment à
l’egard de cette dissonance qui lui paroît trop rude
en elle-même , & félon les principes de l’harmonie
; mais il croit que c’eft une autre circonftmce
tou t-à - fait particulière qui la fait tolérer dans la
mufique. Il remarque que l’on n’emploie cet accord
•G" » H , d , f , que lorfque la compofition fe rapporte
au ton C ; & il croit qu’on y ajoute le fon f ,
pour fixer l’attention des auditeurs à ce ton , afin
qu’ils ne s’imaginent pas que le ton ait paffé au
ton G , où l’accord G , H , d , eft la confonnance
principale. Suivant cette explication , ce n’eft donc
point par quelque principe de l’harmonie qu’on fe
fert de la dissonance G , H, d, f , mais uniquement
pour avertir les auditeurs que la pièce qu’on joue
doit etre rapportée au ton C. Sans cette précaution
s on pourrait fe tromper , & croire que i’har-
monie dût être rapportée au ton G. Par la même
raifon il dit qu’en employant l’accord F , A , c ,
on y ajoute le fon d , qui eft la fixte de F , afin que
les auditeurs ne penfent pas que la pièce ait paffé au
ton F.
Je coûte fort que cette explication foit goûtée de
tout le monde : elle me paroît trop arbitraire & éloignée
des vrais principes de l’harmonie. S’il éto t ab-
folument néceffaire que chaque accord repréfentât le
fyfiême tout entier des fons que le ton où l’on
joue emb raffeon n’aurait qu'à les employer tous
: à la fois, mais cela Trait fans contre dit un très-
mauvais effet dans la mufique. C .pendant le doute
demeure dans fon entière force, qui eft que l’accord
G , H , d , f , étant écouté tout feul , fans être lié
avec d’autres , ne choque pas tant l’oreille , qu’il
femble qu’il devrait faire à caufe des grands nombres
dont il renferme les rapports. Il eft certain que
la plupart des oreilles ne font pas capables d’apercevoir
des proportions fi compliquées ; & néanmoins
nous voyons que prtfque tout le monde trouve cet
accord affez agréable , il s’agit donc de découvrir
la caufe phyfique de ce phénomène paradoxe.
Pour cet effet, je remarque d’abord qu’il faut
bien diftinguer les proportions que nos oreilles
aperçoivent actuellement, de celles que les fons exprimés
en nombres renferment. Rien n’arrive plus
1ouvent dans la mufique , que ce que l’oreille fènt
une proportion bien différente de celle qui fubfifte
effectivement parmi les fons. Dans la température
égale , où tous les 12 intervalles d’une oCtave font
égaux, il n’y a point de confonnances exaCtes, excepté
les feules oCtaves, la quinte y eft exprimée
par la proportion irrationelle de 1 à | / 27 , qui eft
un peu différente de celle de 2 à 3. Cependant quoiqu’un
infiniment foit accordé félon cette règle,
l’oreille qui n’eft pas blefféepar cette proportion irr’â-
tionelle C : G ne laiffe pas d’apercevoir une quinte,,
ou la proportion de 2 à 3 ; & s’il étoit poflible que
l’oreille fentît la véritable proportion des fons, elle
en feroit beaucoup plus choquée , qu’écoutant la
plus forte dissonance comme celle delà fs uffe quinte.
Auffi fait-on que dans la température harmonique,
où les fors d’une oCtave font exprimés par lès nombres
ci-joints , quelques quintes ne font pas parfaites
, quoique l’oreille les prenne pour telles.
Ainfi l’intervalle de B à f , étant contenu dans la
proportion de 673 à.10 24, furpaffe la proportion
d’une véritable quinte de 2 à 3 , de l’intervalle •|££f,
& cependant l’oreille la diftingue à peine d’une
quinte exaCte. De même, l’intervalle A à d, contient
la proportion de 20 à 2 7 , que l’oreille confond
avec celle de 3 à 4 , quoique la différence foit un
comma, exprimé par la proportion 80 : 81. On
prend auffi l’intervalle de G s à c , dont la proportion
eft 23 : 3 2 , pour une tierce majeure, ou
pour la proporticn de 4 à 3 , nonobftant la différence
de 123 à 128; & je doute fort qu’en écoutant
l’accord d : f , on fente la proportion de 27 à
32, plutôt que celle de 3 à 6 , qui eft fans doute
plus fimple.
Voici le fyfiême ordinaire.
F — 29 m gf* .
Fs — aa É 5 = 540.
G — 26 3 = 57<S.
Gs — % 3 5’ = OÔO.
A — 2^ 5 = 640.
B — 3> 5’ = 675.
H — a4 3* 3 — 720.
c --- 28 3 = 768.
CS - kg 5* = 800,
d _ 2.5 3; ~ 864«
ds --- 2* 3 = 9OO.
e --- . 26 3 5 222 960.
f — 2'° 2= IO24.
Il eft donc fuffifamment prouvé que la proportion
aperçue par les fens eft fouvent différente de
celle qui fubfiüe actuellement entre les fons. Toutes
les fois que cela arrive , la proportion aperçue
eft plus ftmplè que la réelle ; & la différence eft
fi petite, qu’elle échappe à la perception. L’organe
de l’ouie eft accoutumé de prendre pour une proportion
fimple toutes les proportions qui n’en diffèrent
que fort peu , de forte que la différence foit
quafi imperceptible : or , plus une proportion eft
fimple, plus notre fentiment eft suffi fenfible , &
diftingue. de plus petites aberrations ; c’eft la raifon
-pourquoi on ne fauroit fupporter prefque aucune
aberration dans le; oClaves , & on prétend que toutes
les oCtaves foient exaCtes, & qu’elles ne s’écartent
point du tout de la raifon double. Cepe;ïdànt,
quand même , dans un concert , quelques oCtaves
feraient environ dune centième partie d’un ton
trop hautes ou trop baffes, je doute fort que la plus
délicate oreille s’en aperçût; il femble plutôt qu’on
fouffre encore une plus grande aberration, fa.:s que
les oreilles en foient bleffées.
Dans les quintes on peut fouffrir une plus grande
aberration : les muficiens conviennent que celle que
que la température égale renferme 2 eft abfolument
imperceptible, or l’erreur y monte à la centième
partie d’un ton. Dans la température harmonique,
il y a des quintes qui diffèrent d’un comma da
la raifon double , & le comma vaut environ la
dixième partie d’un ton exprimé par la raifon de 8
à 9 ; auffi cette différence eft-elle fenfible, & femble
avoir déterminé la plupart des muficiens à embraffer
la température égale, où l’erreur eft dix fois plus
petite. Peut-être que la moitié ou le tiers d un comma
feroit encore fupportable dans les quintes majeures,
dans les tierces majeures, dont la jufte mefure eft la
raifon de 4 à 5, la température égale s’en écarte de
deux tiers d’un comma , & dans les tierces mineures,
on ne diftingue pas un comma entier, vu que la
température harmonique contient deux efpèces de
cette tierce, l’une exprimée par la raifon 5 à 6 , &
l’autre par 27 à 32, qu’on confond ordinairement
dans la pratique, quoique la différence foit un comma.
Cependant on ne fauroit ici fixer de limites; la
chofe dépend de la fenfibiiité des oreilles, & il eft
certain que des oreilles fines & délicates diftinguent
des différences plus petites que des oreilles groihères.
Si les hommes avoient !e jugement de leur oreille
fi exaCt, qu’ils puffent diftinguer les plus petites aberrations,
c’en feroit fait de toute la mufique : car où
trouverait-on des muficiens capables d’exécuter tous
les fons fi exactement, quM n’y auroit pas la moindre
aberration ? Prefque tous les accords paroît raient à
ceshomm.es comme les plus infupportables dissonances,
pendant que des oreihes moins délicates les trouvent
parfaitement bien harmoniques. C ’eft donc un avantage
pour la mufique pratique, que le fens de fouie ne
ne foit pas porté au plus haut degré de perfection,
& qu'il pardonne généreufement les petits défauts
dans l’exécution. Il eft auffi certain que plus le goût
des auditeurs eft exquis, plus auffi doit être exaCte
l’exécution ; pendant que des auditeurs dont le goût
eft moins délicat, fe contentent d’une exécution plus
groflière.
Quand la proportion aétuelle, entre les fens qu’on
entend, eft affez fimple, comme de 2: 3 , ou 3 : 4 ,
ou 4 : 3 , &c. la proportion aperçue eft auffi la même
pour toutes les oreilles. Mais quand la proportion
aétuelle eft fort compliquée , de forte pourtant qu’elle
approche beaucoup d’une proportion fimple, alors
l’oreille apercevra cette proposition fimple fans remarquer
la petite aberration de l’aCtuelle. Ainfi, en
entendant deux Ions en raifon de 1600 à 2001 , on
les prendra pour une oftaye, ou bien la proportion
aperçue fera 1 à 2 exactement ; de même, deux fons
en raifon de 200 à 301 , ou de 200 à 299, exciteront
le fentiment d’une quinte parfaite, & généralement
par quelques nombres que les fons foient exprimés,
fi les proportions font trop compliquées,
l’oreille leur en iùbftitue d’autres fort approchantes,
dont les proportions font plus fimpies. C ’eft ainfi que
les proportions aperçues font différentes des actuelles,
&. c eft par celles-là qu’il faut juger de la véritable
harmonie, & point du tout par celles-ci.
Donc, quand on entend cet accord G , H , d , f ,
exprimés par ces nombres, 3 6, 43 , 34, 64, une
Oreille parfaite comprendra bien les proportions renfermées
dans ces nombres; mais des oreilles moins
parfaites , auxquelles la perception de ces proportions
eft trop difficile, tâcheront de fubftituer d’autres nombres,
qui donnent des proportions plus (impies. Elles
ne changeront rien dans les trois premiers fons G ,
H , d , puifqu’ils renferment une confonnance parfaite ;
mais je fuis porté à croire qu’elles fubftituer ont à la
place du dernier, 6 4 , celui de 63, afin que tous
les nombres devenant divifibles par 9 , les rapports
de nos quatre fons foient maintenant exprimés
par cet nombres 4 , 3 , 6 , 7 , dont la perception eft
fans doute moins embarraffée. En effet, fi l’on nous
préfentoit ces deux accords, l’un contenu dans les
nombres 36, 4 5 , 54, 64 , & l’autre dans ceux-ci,
36, 4«5, 54, 6 3 , il faudrait une oreille bien fine
pour les diftinguer, à moins quelle ne les entendît
à-la-fois ; mais ho. mis ce cas, ces deux accords feront
certainement la même impreffion.
Je crois donc qu’en entendant les fons 36, 45 ,
54, 64, on s’imagine d’entendre ceux-ci, 36, 45 ,
54, 63 , ou bien ceux-ci, 4 , 3 , 6 , 7 , attendu que
l’effet eft abfolument le même. Je ne fais pas fi la
raifon fuivante eft fuffifante pour prouver mon fentiment.
Si i’oreille apercevoit les premiers nombres,
l’accord ne de vroit pas être troublé quoiqu’on y ajoutât
encore d’autres fons contenus dans le même expofant,
comme ceux de 40 , ,48 & 60. Or , il eft certain-
que par cette addition l’accord changerait tout-à fait
de nature, & deviendrait infupportable. De là , je
conclus que l’oreille fent effectivement les fons exprimés
par ces petits nombres, 4 , 3 , 6 , 7 , don: l'ex