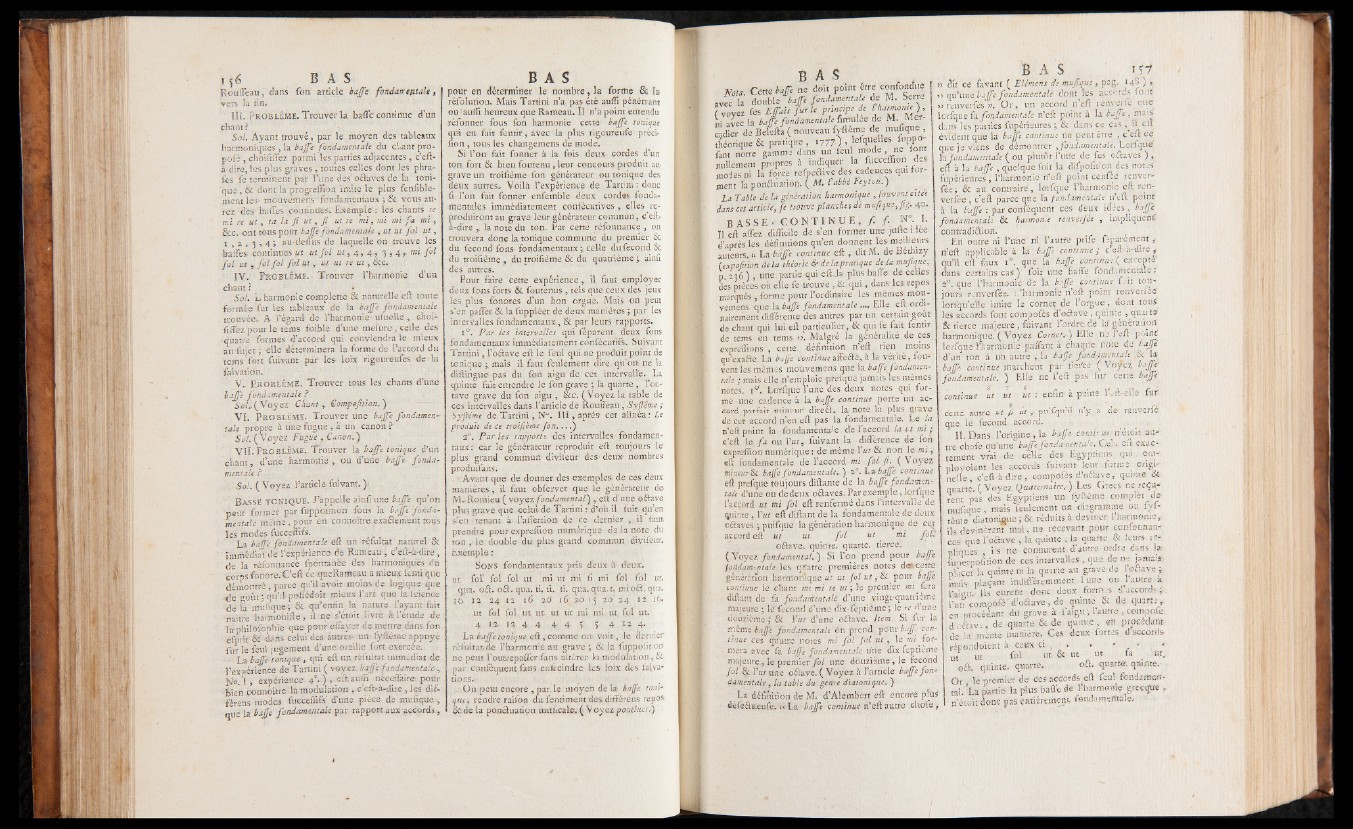
i $6 B A S
Rotiffeau, dans fou article baffe fondamentale,
vers la fin.
I II . Problème. Trouver la baffe continue d’un
chant ? ' . •
Sol. Ayant trouvé, par le moyen des tableaux
harmoniques , la baffe fondamentale du chant pro-
pofé , choififfez parmi les parties adjacentes , c’eft-
à-dire, les plus graves »toutes celles dont les' phra-
fes fe terminent par Tune clés' oâaves de la toniqu
e , & dont la progreiffion imite le pins fenfible-
ment les- mouvemens fondamentaux ; & vous aurez
dès baffes continues. Exemple : les chants rc
mi re u t , ta la f i u t , f i ut re mi, mi mi fa mi,
&C. ont tous pour- baffe fondamentale , ut ut fol u t ,
i , 2 , 3 , 4 ; au-deffus de laquelle on trouve les
baffes- continues ut ut fo l ut, 4 , 4 , 3 ,4 r mi fol
fo l ut , fo l fol fo l ut y- ut ut re u t , &c.
IV . Problème. Trouver l’harmonie d’un
chant ? , . •
Sol. L harmonie complette & naturelle eft toute
formée fur les tableaux de la baffe fondamentale
trouvée; A l’égard'de l’harmonie-ufuelle , choi-
fiffezpourle tems foible d’une mefùre , celle des
■quatre formes d’accord qui conviendra le. mieux
an-fujet ; éllë déterminera la forme de l’accord du
tems fort fuivant par les- loix rigoureufes de la
falvàtion.
V. . Problème. Trouver tous les chants d’une
baffe fondamentale ?
Sol..(V o y ez ' Chant ,. Composition.);
V f. Problème. Trouver une baffe fondamentale
propre à une fu g u e , a un canon È
So/.X Voyez Fugue , Canon.)
VII. Problème- Trouver la baffe tonique d’un
chant, d’une harmonie ou d’une b a fffo n d a mentale
? ||
Sol. ( Voyez l’article-fuivant. )i
BASSE to n iq u e . J’appelle ainfiune baffe qu’on
peut formef par fuppoiition fous la baffe fondamentale
même, pour en connoître exademènt tous
lés modes fucceffifs. .
La baffe fànddmentale eft un refultat naturel de
Immédiat dé i expérience- de Rameau , c eff—a-dire,
de la réfonnance fpontanée des harmoniques du
corps fonore. C*eft ce queRameau a mieux- Cmü que
démontré , parce j p ’il avoir moins de logique que
de goût;- qu’ilpoflédoit mieux l’art que la fcience
dè la mufique ; & qu’enfin la. nature l’ayant.fait
naitre hârmohifte r il ne s’étoit livré à l’étude de
la- philofop'hië que pour effayer de mettre dans fon
efprit & dans celui des autres- un- fyfféme appuyé
fur le feul jugement d’une;oreille fort exercée.; >
- La baffe tonique » qui eff un réfultat immédiat de
l’expérience de Tartini ( voyez baffe fondamentale y
No. I , expérience 4V) néceffaire pour
bien connoître la modulation , c’eft-à-dire , les dif-
férens modes fucceffifs d’une pièce de mufique,
que la baffe fondamentale par rapport aux accords,
BAS
pour en déterminer le nombre, la forme & fa?
réfolution. Mais Tartini n’a: pas été auffi pénétrant
ou 'auffi heureux que Rameau. Il n’a point entendu
réfonner fous fon harmonie cette baffe tonique
qui en fait fentir, avec la plus rigoureufe préci-
fion , tous les changemens de mode.
Si l’on fait fonner à la fois deux cordes d’un
ton fort & bien foutenu, leur concours produit au»
grave un troifième fon générateur ou tonique des
deux autres.- Voilà l’expérience de Tartini: donc
fi l’on fait fonner enfemble deux cordes fondamentales
immédiatement confécutives , elles reproduiront
au grave leur générateur commun, c’eft-
à-dire la note du ton. Par cette réfonnance , on
trouvera donc la tonique commune du premier 8c
du fécond'fons fondamentaux celle du fécond &
du troifième , du troifième & du quatrième ; ainfi
des autres.
Pour faire cette expérience, il faut employer
d'eux- Ions forts & foutenus , tels que ceux des jeux
les plus fonores d’iin bon orgue. Mais on peut
s’en paffer- 8c la fuppléer de deux manières ; par les
intervalles fondamentaux8c par leurs rapports.
i° . Par les intervalles qui réparent deux fons
fondamentaux immédiatement confécutift- Suivant
Tartini, Poétave eff le feül qui ne produit point de
tonique mais il- faut feulement dire. qu’oif ne la
diffihgùè pas du fon aigu dé cet intervalle. La
quinte fait entendre le fon grave ; la quarte , l’octave
grave du fon aigu , &c. (V oyez la table de
ces intervalles dansl’article de Rouffeau, Syfieme ;
Syfbême de Tartini, N^. I I I , après cet alinéa: Le
; produit de ce troifième fon .. . . ) .
cl0. Par les rapports des intervalles- fondamentaux:
car le; générateur reproduit eff toujours le’
plus grand commun’ divileur des- deux nombres
produifans.
Avant que de donner des exemples de ces déux
manières-, il faut obferver que le générateur de
M^Romieu ( voyez fondamental) , eff d’une oétave
plus grave que celui de Tartini : d’où il fuit qu’en
s’en tenant à- l’affertion de ce dernier , il faut
prendre pour expreffion numérique de la note ; du
ton , le double du plus grand- commun divileur.
Exemple :
Sons fondamentaux pris deux à- deux,
ut fol’ foi fol- ut mi ut mi fi mi fol fol ut.
qua. oéh o£L qua. ti. ri. ti. qua. qua.t. mioét. qua.
16 12 24. 12 16 20'. 16; 2,0 11 10*24; 12 16.
ut fol fol ut ut ut- vit mi mi ut fol 11t.
4 12, 12 4 4 4 4 5 5. 4 ï-2. 4*
La baffe tonique e ff, comme on- v o it , le dernier
réfultatde l’harmonie au grave ; 8c la fuppofiton
ne peut Poutrepaffer Jans altérer la. modulation, &-
par confisquent fans .enfreindre les loix des f al varions.:.
On peut encore , par le moyen de là baffe toru-
, quey rendre raifon du fentiment des. différons repos
8c de la ponctuation muficaLe, (• Voyez pouliner.)
B A S
Km . Cette baff' ne doit point être confondue'
avf c la double baff' foaiamcntaU de: M. Serre
( voyez fes Effais fur le pnnapede Ihannonu'),
ni avec la: baffe fondamentale &nnùèe de M. Mer
radier de Beîefta ( nouveau fyfleme de mufique ,
théorique & pratique , 1777-) , lefquelles fupp ~
faut notre gamme dans un ieirl mode ne iont
nullement propres à indiquer la focceffiofl des
modes ni la force refpè&ive des cadences qui forment
la ponctuation. (, M. l'abbé Feytou.)
La Table delà génération harmonique ,fouvent citée
dans cet article, fe trouve planches de mufique, fig. 40.
B A S S E « 1 C O N T I N U E , f i f i N°- L
Il eff affez difficile de s’en former une jutte i-Jee-
d’après les définitions-qu’en donnent les meilleurs
auteurs. « La baffe continue eff , dit- M. de Béthizy
(,expédition de là théorie & de la pratique de là mufique,
p. 236 ) , une partie qui eft-Ja plus baffe de celles
des pièces où elle fe trouve , & .q u i, dans les repos
marqués » forme pour l’ordinaire les mêmes mou-
vemens que la baffe fondamentale ..., Elle eff ordinairement
différente des autres par un certain goût
de chant qui lui eff particulier, & qui fe fait fentir
de tems en tems ». Malgré la généralité de ces„
expreffions , cette, définition n’eff rien moins
qu’exaéte. La baffe continue affeCt'ô, à la vérité » fou-
vent les mêmes motivemens que la baffe fondamentale
; mais elle n’emploie prefque jamais, les memes
notes. i° . Torique l’une des deux notes qui forme
Une cadence à la baffe continue porte un accord
parfait mineur direél, la note la plus grave
de cet accord n’en eff pas la fondamentale. Le la
n’eff point la fondamentale de 1 accord la et mi ;■
e’eff le, fa ou Y ut, fuivant la différence de fon
expreffion numérique : de même Vus & non le mi,
eff fondamentale de l’accord mi fo l fi. ( Voyez
mineur & baffe fondamentale. ) 2°. La- baffe continue
eff prefque toujours diffame de la baffe fondant en-
taie d’une ou de deux oClaves. Par exemple, lqrfque
l’aecord ut mi fo l eff renfermé dans l’intervalle de
quinte , Y ut eff diiftant de la fondamentale de deux
0Claves ; püifque' la génération harmonique de' ce;t
accord eff ut ut fol ut ^ mi foU
oClave. quinte, quarte, tierce1.
( Voyez fondamental, ) Si l’on prend pour baffe
fondamentale \qs quatre premières notes de# cette
génération harmonique ut ut fol ut ,-8c pour baffe
continue le chant mi mi re ut’, l‘e premier mi fera
difiant de fa fondamentale d’une vingt-quatrième
majeure ; le* fécond d’une' dix-fêptième j le re d’une
douzième .j & Y ut d’une oCIave. Item. Si fur la
même baffe fondamentale en prend : polir baff: cofc
tinue ces quatre notes mi fo l fo l ut » le mi for-
■ mera avec fa baffe fondamentale une dix feptième
majeurele premier fo l une douzième, le fécond
fol 8c Y ut une oCl'ave. (V o y e z à l’article baffe fondamentale
,. la table du genre diatonique. )
La définition dè M. d’Alembert eff encore plus
défefttëeufe.. « La baffe continue n’eff autre chofe ,
B A S i f ?
n äh ce favanf ( Elémens de mufique , pag. 14S ) >
>5 qu'une baffe fondamentale dont les accords font
m renverfés ». O r , un accord n’eff renverfé que
lorfque fa fondamentale n’eff point à la baffe, _ni2iS
dans les parties fupérieures ; 8c dans ce cas il eft
évident qu'e la baffe continue ne peut être , c’eff ce
que }e viens de démontrer , fondamentale. Lorfque
hijondamentale ( ou plutôt l’une de fes oClaves ) ,
eff à la baffe , quelque foit la difpofition des notes
fupérieûres, l’harmonie n’ eff point cenfée renver-
féej & au contraire', lorfque l’harmohie eft ren-
verfée , c’eff parce'que l’a fondamentale n’eff point
. à la baffe : par. confèquent ces deux idées, bafj'e
: fondamentale & harmonie renverfée , impliquent
' contradiction. r
Eil outre ni l’une' ni l’autre prife f-parement »
n’eff applicable à Ta' baffe continue ; ceft'à-diré y
qu’il eft faux i°; que la baffe continue ( excepte
dans certains cas ) foit une baffe fondamentale r
: 20. que l’harmonie, de la baffe continue Loït toujours
renverfée. [.’harmonie n’eff point renverfée'
lorfqu’elle imite le cornet de l’orgue , août tons
les accords font compofés d’o&ave , quinte » quarts
Sc tierce majeure , fuivant l’ordre de là généraiipn
harmonique. ( Voyez Cornet*) Elle ne l’eff point'
lorfque l’harmonie paffam à chaque hôte de bàffé
d’un ton à un autre , la baffe fondamentale ,.8c la-
baffe continue marchent par tiefee ( Voye^ baffe?
fondamentale. ) Elle ne 1 eff pas fur cette baffe
. continue ut ut ut : enfin- à peine lVft-elle fur"
i cette autre ut fi u t ,- puifqu il n y a ce- renverfe
que le fécond acoordv
II. Dans l’origine , la- baffe conïir ue n-ètoit au-*
tre chofe qu’une baffe fondamentale. Cela en exactement
vrai de celle des Egyptiens qui., ein--
ploÿoient les ac-cords fuivant leur forme origin
elle, c’eff-à-dire, compofés d’oCkve, quinte «■
quarte. ( Voyez Quaternaire. ) Les Grecs ne reçurent
pas des Egyptiens un fyffêmc complet de
: mufique, mais feulement un diagramme on, fyf-
■ têm©1 diatonique ; & réduits,à deviner 1 harmonie,»
ils devinèrent mal, ne recevant pour eon-fonnan^
ces que l’oâave , la quinte , la quarte & leurs répliqués
, ils ne connurent d’autre ordre dans la-
funeroofition de ces intervalles , que de ne jamais
placer la quinte ni la quarte au grave de l’oClave
mais- plaçant indifféremment l'une ou l’autre à
Paipir." Us eurem donc deux forn*:s eaccords;»,
l’un eom-pofé'd’oélave, de quinte 8c de quarts,»
en procédant du grave à l’aigu i l’autre » compofé
; d’ofiav,-, de quarte & de quime , en procédant
ïde la- même manière. Ces deux-fortes d accords
répond oient à ceux ci ^ * ■ * *
ut Ut fol ut- & ut m fa ut,
o a . qiûnte'. quarte. oft. quarte, qairae.
Or le premier de des-accords eft foui fondante«.
. tal.'La partie la plus balle de I- harmonie grecque ,
n’ étoit donc pas emièremçns, fomlamefftïle. ■