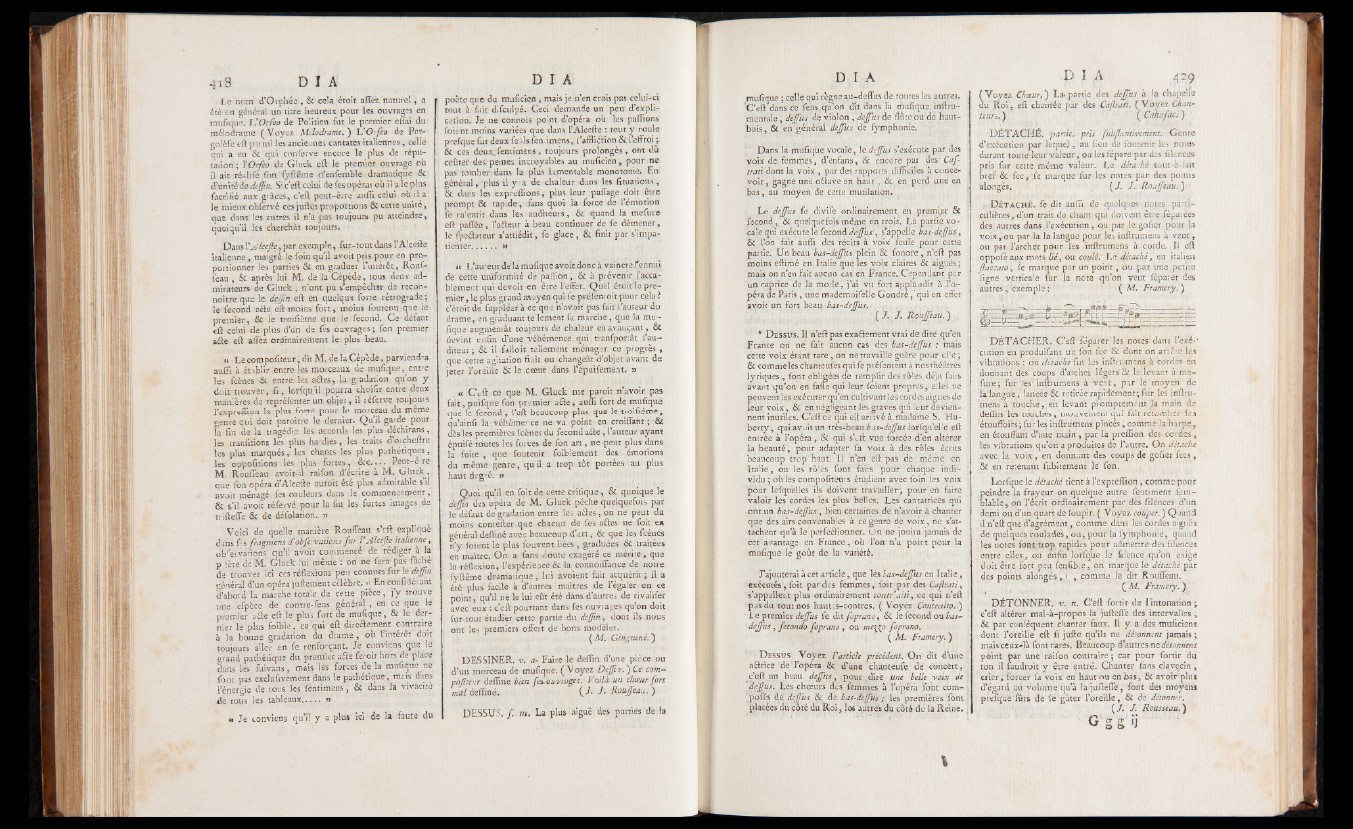
Le nom d’Orphée, & cela étoit allez nature’ , a
été en généra! un titre heureux pour les ouvrages en
mufique. VOrfeo de Politien fut le premier effai du
mélodrame (V o y e z Mélodrame. ) VOrfeo de Per-
aolèfe eft parmi les anciennes cantates italiennes, celle
oui a eu & qui confervé encore le plus de répu-
taûoh; VOrfeo. de Gluck eft le premier, ouvrage où
il ait réalifé fon'fyftême d’enfemble, dramatique. &>
d’unité de dejfn. Si c eft celui de (esopéras où il a le plus
facrifié aux grâces, c’eft peut-être auffi celui où il a
le mieux ohfervé ces juftes proportions & cette unité,
que dans’ les autres il n’a pas toujours pu atteindre,
quoiqu’il les cherchât toujours.
Dans YAlcefle, par exemple, fur-tout dans l’Alcefte
italienne ^ malgré le foin qu’il avoit pris pour, en proportionner
les parties & en graduer l’intérêt, Rouf-
feau, & après lui M. de la Cépède, tous deux admirateurs
de Gluck * n’ont pù s’empêcher de recoh-
noître que le dejfn eft en quelque forte rétrograde ;
le fécond a&e eft moins fort * moins foutenu que le
premier, & le troifième que le fécond. Ce défaut
eft celui de plus d’un de fes ouvrages ; fon premier
aéie eft affez ordinairement le plus beau.
« Le eompoftteur , dit M. de la Cépède, parviend-a
aufii à .établir entre; les morceaux de mufique, entre
les fcènes' & entre, ies aâ es , la gradation qu’on y
doit trouver , f i , lorfqu’il pourra choifir entre deux
manières.de reprefenter un objet, il réferve toujours
Fexpreflion la plus forte pour le morceau du même
genre qui doit paroître le dernier. Qu’il garde pour
la fin de la.tragédie les accords les plus déchirans,
les tranfitions les plus ha/diés, les traits dorcheftre
les plus marqués, les chants les plus pathétiques,
les' oppofitions les plus fortes, & c .. . . Peut-e re
M. Roufleau avôit-ri raifon d’écrire a M. Lrluclc
que fon opéra d’Alcefte auroit été plus admirable s’il
avoit ménagé, fes couleurs dans le commencement,
& s’il avoit réfervé pour la fin les fortes images de
triftefle & de défolation. »
Voici de quelle manière Roufleau s’eft expliqué'
dans fi s fragmens d’obfei varions fur l Alcefle italienne,
observations qu’il avoit commencé de rédiger à la
p -ère de lil. Gluck lui même : on ne fera pas fâché
de trouver ici ces réflexions peu connues fur le dejfn
général d’un opéra juftement célèbre, <■ En confidérant
d’abord la marche totale de cette pièce, j’y trouve
une efpèce de contre-fens général , en ce que le
premier sâe eft le plus fort de mufique, & le dernier
le plus foible, ce qui eft dire&ement contraire
à la bonne gradation du drame , ou 1 interet doit
toujours aller en fe renforçant. Je conviens que le
grand pathétique du premier afte feroir hors de place
dans les fuivans, mais les forces de la mufique ne
font pas exclufivement dans le pathétique, mais dans
l’énergie de tous les fentimens, & dans la vivacité
de tous les tableaux..... »
a Je conviens qu’il y a plus ici de la faute du
poète que du tnuficien , mais je n’en crois pas celui-ci
tout à fait difculpé. Ceci demande un peu d’explication.
Je ne connois point d’opéra où les paflions
foiènt moins variées que dans l’Alcefte : tout y roule
prefque. fur deux fe.fts fen.imens, l’affiiétion & l’effroi ;
& ces deux,fentimens, toujours prolongés, ont du
coûter des peines incroyables au muficien, pour ne
pas tomber dans la plus lamentable monotonie; En
général ÿ plus il y a de chaleur dans les fi tua lions ,
& dans les expreflions, plus leur paffage doit être
prompt & rapide, fans quoi la force de l’émotion
fe ra’entit dans les auditeurs, & quand la mefure
eft paffée, l’a&eur à beau continuer de fe démener,
le fpe&ateur s’attiédit, fe glace, & finit par s’impatienter...........
»
« L ’au'eur de là mufique avoit donc à vaincre l'ennui
de cette uniforrhité de paîiïôn, ÔC à prévenir l’accablement
qui devoit en être l’effet. Quel étoit le premier
, le plus grandmoyen qui fe préfentoit pour cela ?
c’étoit de fuppléer à ce que n’a Voit pas fait l’auteur du
drame, en graduant te lement fa marche, que la mufique
augmentât toujours de chaleur en avançant, &
devint enfin d’une véhémence qui tranfporrât l’auditeur
; & il -falloit tellement ménager ce progrès ,
que cette agitation finît ou changeât d’objet avant de
jeter l’oreille & le coeur dans l’épuifement. »
« C ’eft ce que M. Gluck me paroît n’avoir, pas
fait, puifque fon premier a&e ; aufli fort de mufique
que le fécond, l’eft beaucoup plus que le troifième,
qu’ainfi la véhémence ne va point en croiflaht ; &
dès les premières fcènes du fécond a&e, l’auteur ayant
épuifé toutes les forces de fon art, ne peut plus dans
la fuite , que foutenir foiblement des émotions
du même genre, qu'il a trop tôt portées au plus
haut degré. »
Quoi qu’il en foit de cette critique, & quoique le
dejfn des opéra dé M. Gluck pèche quelquefois par
le défaut de gradation entre les aftes, on ne peut du
moins contefter que chacun de fes a êtes ne foit e»
général deftiné avec beaucoup d’a rt, & que les fcènes
n’y foient le plus fouvent liées , .graduées & traitées
en maître. On a- fans doute exagéré ce mérite, que
, la réflexion, l’expérience & la connoiflance de notre
fyftême dramatique, lui avoient fait acquérir ; il a
été plus facile à d’autres maîtres de l’égaler en ce
point, qu’il ne le lui eût été dans d’autres de rivalifer
' avec eux : c’eft pourtant dans fes ouvrages qu’on doit
; fur-tout étudier cette partie du dejfn, dont ils nous
ont les premiers offert de bons modèles.
( M. Gmguené. )
DESSINER, v. a- Faire le deflin d’une pièce ou
d’un morceau de mufique. (V oy e z Dejfn.') Ce com-»
pofteur defline bien fes*,ouvrages.. Voila un choeur fon
mal defliné. ( 7. 7. Roujfeau.)
D E S S U S , f. m. L a plus aiguë des parties de îa
mufique ; celle qui règne au-deflùs de toutes les autres.
fC ’eft dans ce fens qu’on dit dans la mufique inftru-
mentale, dejfus de violon , dejfus de flûte bu de hautbois
, & en général dejfus de fymphonie.
Dans la mufique vocale, lè dejfus s’exécute par des
voix de femmes, d’enfans, &. encore par des' CaJ-
trati dont la voix , par des rapports difficiles à concevoir,
gagne une oftave en haut, &. en perd une en
bas, au moyen de cette mutilation.
Le dejfus fe di-vife ordinairement en premier &
fécond, & quelquefbis'même en trois. Là partie vocale
qui exécute le fécond dejfus', s’appelle bas-de fu s ,
& l’on fait auffi des récits à voix feule pour cette
partie. Un beau bas-dejfus plein & fonore, n’eft pas
moins eftimé en Italie que les voix claires & aiguës ;
mais on n’en fait aucun cas eh France. Cependant par
un caprice de la mode, j’ai vu fort applaudir à l’opéra
de Paris, une mademoifelle Gondré, qui en effet
ayoit un fort beau bas-dejfus.'
( ƒ.• 7. RouJJeàu. )
* D essus. Il n’eft pas exaélement vrai de dire qu’en
France oh ne fait aucun cas des bas-dejfus : mais
cette voix étant rare, 6n ne travaille guère pour elle ;
& comme les chanteufës qui fè préfentent à nos théâtres
lyriques , font obligées de remplir des rôles déjà faits
avant-qu’on en faflè qui leur foient propres, elles ne
peuvent les exécuter qu’en cultivant les cordes aigues de
leur voix, & en négligeant les graves qui leur deviennent
inutiles. C ’eft ce qui eft arrivé à madame S. Hu-
berty, qui avoit un très-beau bas-dejfus lorfqù’efe eft
entrée à l’opéra, &. qui sVft vue forcée d’en altérer
la beauté, pour adapter fa voix à des rôles écrits
beaucoup trop haut. Il n’en eft pas de même eh
Italie, ou les rôles font faits pour chaque individu
; où les compofiteurs étudient avec foin les voix
pour lefquelles ils doivent travailler, pour eh faire
valoir les cordes les plus belles. Les cantatrices qui
ont un bas-dejfus, bien certaines de n’avoir à chanter
que des airs convenables à ce genre de voix, ne s’attachent
qu’à le perfectionner. On ne jouira jamais de
cet avantage en France, où l’on n’a poir.t pour la
mufique le goût de la-variété.
J’ajouterai à cet article, que les las-dejfus en Italie,
exécutés, foit par des femmes, foit par des Caflrati,
s’appellent plus ordinairement contraiti, ce qui n’eft
pas du tout nos hautes-contres. ( Voyez Contralto. )
Le premier dejfus fe dit foprano, & le fécond ou bas-
dejfus , feçondo foprano ,- ou mer^o foprano.
(M . Frarnery.)
D essus. Voyez l’article précédent. On dit d’une
a&rice derl’opéra & d’une chanteufe dé concert,
c’eft un beau dejfus, pour k dire une belle voïsç de
dejfus. Les choeurs des femmes à Top'érâ font cbm-
[pofés de dejfus & dé bas-dèffùs ; les premières font
placées du côté du R oi, lus aütre's du côté dé la Réine.
\
(V oyez Choeur.) La*partie des dejfus à la chapelle
du Roi, eft chantée par des Caflrati. ( Voyez Chanteurs.
) ( Cahufacj)
DÉTACHÉ, partie, pris fubjfantïvement. Genre
d’exécution par lequel, au lieu de foutenir les notes
durant touteieuf valeur, on les fépare par des fiknees
pris fur cette môme valeur. Le déta:hè tout-à-fait
brgf & fee , fe marque fur les notes par des points
alongés. ( 7. /. Roujfeau. ) ,
, D étaché, fe dit auffi de quelques notes pa-ti-
culières, d’un trait- de chant qui doivent être fépa: ées
des autres dans l’exécution, ou par le gofier pour la
voix, ou par la la langue pour les inftrumens à vent,
ou par l’archet pour les inftrumens à corde. Il eft
oppofé aux mots lié, ou coule,' L e détaché, en italien
flaccato, fe marque par un point, ou par une petite
ligne verticale fur la note qu’on Veut féparer des
autres, exemple : 1 ‘ ( M. Frarnery.)
DÉTACHER. C ’eft féparer les notes dans l’exé--
cution ën produifant un fon fec & dont on arrête les
vibrations.' : on détache fut- lés inftrumens à cordes én
donnant dés coups d’archet légers & le levant à mefure
; fur les' inftrumens à Vent, par le moyen ‘ de
lalangüè j lancée & retirée rapidement ; fur les inftrumens1
à 'touché, eh levant p'romptement là main de
deffiis les touchés, mouvement qui fait retomber les
'étouffoifs; furies inftrumens pincés, comme la harpe,
en étouffant d’une main , par la preffion des cordes,
les vibrations qu’on a produites de l’autre. On détache
avec la v oix , en donnant des coups de gofier fecs,
& en retenant fubitement lé fon.
Lorfque le détaché tient à l’expieffion -, comme pour
peindre la frayeur on quelque autre fentiment -fem-
blable, on l’écrit ordinairement par des filences d’un
demi ou d’un quart de foupir. ( Voyez couper. ) Quand
il n’eft que d’agrément, comme dans les cordes aiguës
de quelques roulades, ou, pour la fymphonie, quand
les notes font trop rapides pour admettre des filences
entre elles , ou enfin lorfque le filence qu’on exige
doit être, fort peu fçniibie, on marque le détaché par
des points alongés , comme le dit Roufleau.
( M. Frarnery. )
DÉTONNER, v. n. C'eft fortir de l’intonation;
c’eft altérer mal-à-propos la juftefle des intervalles ,
& par conféquent chanter faux. Il y a des muficiens
dont l’oreille eft fi jufte qu’ils ne détonnent jamais;
mais ceux-là font rares. Beaucoup d’autres ne détonnent
point par une raifon contraire ; car pour fortir du
tori il faudroit y être entré. Chanter fans clavecin,
crier, forcer fa voix en haut ou en bas, & avoir plus
d’égard au volume qu’à la-juftefle, font des moyens
prefqùê fûrs dê le gâter l’oreille, & de détonner.
( 7. 7. Rousseau, )
G g g i j