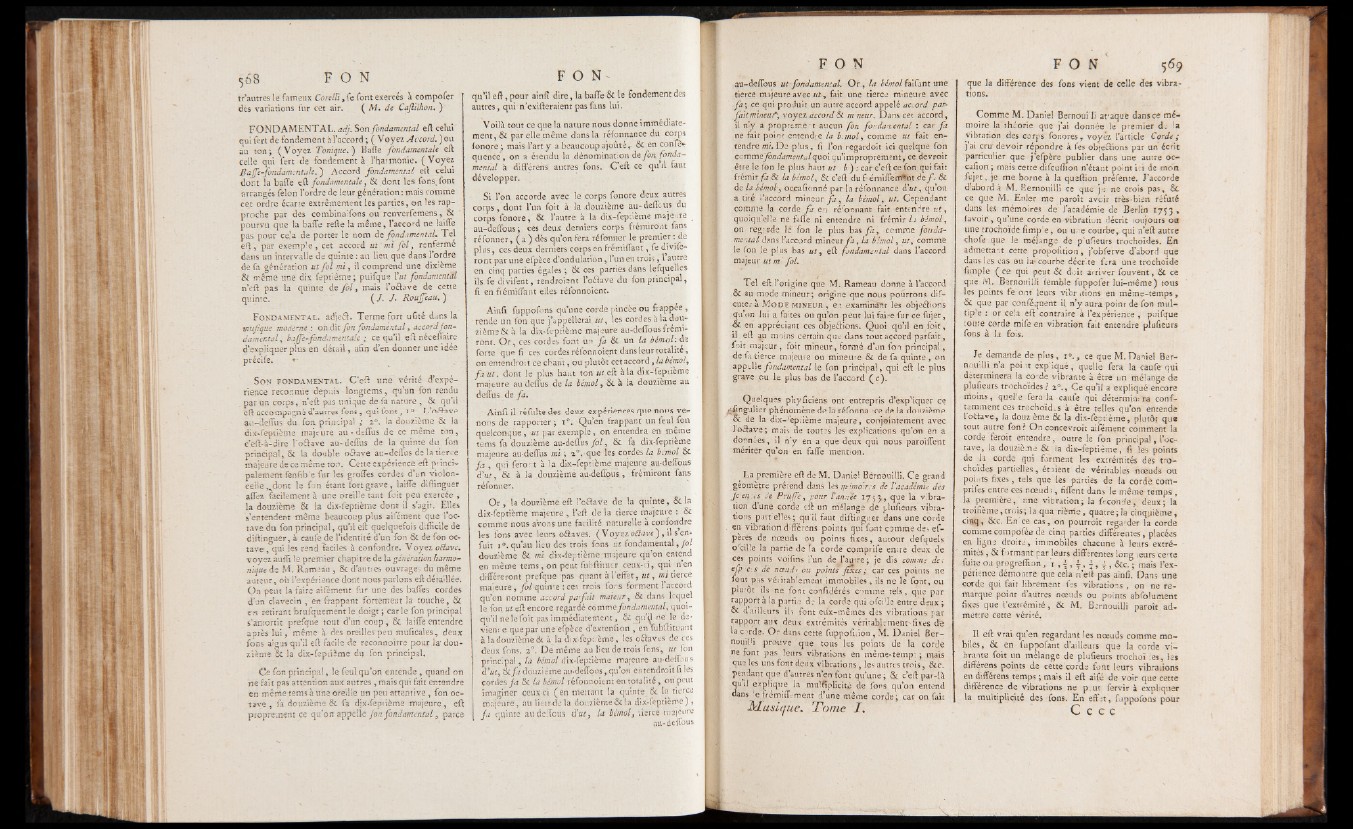
tr autres le fameux Cordli, fe font exercés à compofer
des variations fur cet air. ( M. de Caflilhon. )
FONDAMENTAL, adj. Son fondamental eft celui
qui fert de fondement à l'accord ( Voyez Accord. ) ou
au ton; (V oy e z Tonique.) Baffe fondamentale eft
celle qui fert de fondement à l'harmonie. (V oyez
Baffe-fondamentale.) Accord fondamental eA celui
dont la baffe eft fondamentale, & dont les fons. font
arrangés félon l’ordre de leur génération : mais comme
cet ordre écarte extrêmement les parties, on les rapproche
par des combinalfons oü renverfemens, &
pourvu que la baffe refte la même, l’accord ne laiffe
pas pour ce.'a de porter le nom de fondamental. Tel
eft, par exemple, cet accord ut mi f o l , renferme
dans un intervalle de quinte : au lieu, que dans l’ordre
de fa génération ut fo l mi, il comprend une dixième
& même une dix feptième; puifqus \ut fondamental
n’eft pas la quinte de f o l , mais l’oâave de cette
quinte. ( / . /• Roujfeau.)
Fondamental, adjeéî. Terme fort ufité dans la
mufîque moderne : oh dit fon fondamental, accord fondamental,
baffe-fondamentale ce qu’il eft néceffaire
d’expliquer plus en détail, afin d’en donner une idée
précife.
Son fo n d am en t a l . C ’eft une vérité d’expérience
reconnüe depuis longtems, qu’un fon rendu
par un corps, n’eft pas unique de fa nature , & qu’il ■
eft accompagné d’autres fons, qui font, i °. L’o&ave
au-deflus du fon. principal / 20. la douzième & la
dix'feptième majeure au - deffus de ce même ton,
e’eft-à-dire l'o'ftave au-deffus de la quinte du fon
principal, & la double oéraye au-deffus de la tierce
majeure de ce même ton. Cette expérience eft principalement
feiifîb'e fur les groffes cordés d’un violoncelle
j^dont le fon étant fort grave, laiffe diftinguer
affez facilement à une oreille tant fait peu exercée ,
la douzième & la dix-feptième dont il s’agit. Elles
s’entendent même beaucoup plus aifément que l’octave
du fon principal, qu’il eft quelquefois difficile de
diftinguer, à caufe de l’identité d’un fon & de fon octave,
qui les rend faciles à confondre. Voyez oftave.
voyez autfi le premier chapitre de la génération harmonique
de M. Rameau , & d’aut: es ouvrages du même
auteur, ou l’expérience dont nous parlons eft déraillée.
On peut la faire aifément fur une des baffes cordes
d’un clavecin , en frappant fôrtemeut la touche, &
en retirant brufquementle doigt ; carie fon principal
s’amortit prefque tout d’un coup, & laiffe entendre
après lui, même à des oreilles peu muficales, deux
fons aigus qu’il eft facile de reconnoître pour la- douzième
& la dix-feptième du fon principal.
Ce fon principal, le feulqu’on entende, quand on
ne fait pas attention aux autres , mais qui fait entendre
en même te ms à une oreille un peu attentive , fon octave
, fa douzième & fa dixffeptième majeure, eft
proprement ce qu’on appelle fon fondamental, parce
qu’il eft, pour ainfî dire, la baffe & le fondement des
autres, qui n’exifteraient pas fans lui.
Voilà tout ce que la nature nous donne immédiatement,
& par elle même dans la réfonnance du corps
fonore ; mais l’art y a beaucoup a j o u t é & en confié*
quence, on a étendu la dénomination de fort fondamental
à différent autres fons. C ’eft ce quil faut
développer.
Si l’on accorde avec le corps fonore deux autres
corps, dont l’un foit à' la .douzième au-deffeus du
corps fonore, & l’autre à la dix-feptîeme majeure
au-deffous; ces deux derniers corps frémiront fans
réfonner, ( a ) dès qu’on fera réfonner le premier : de
plus, ces deux derniers corps en frémiffant, fe divife-
ront par une efpèce d’ondulation, l’un en trois, 1 autre
en, cinq parties égales ; & ces parties dans lefquelles
ils fe divifent, rend rois nt l’oélave du fon principal,
fi en frémiffant elles réfonnoient.
Ainfi fuppofons qu’une corde pincée ou frappee ,
rende un fon que j’appellerai, ut, les cordes à la douzième
& à la dix-feptième majeure au-deffous frémiront.
Or, ces cordes font un fa & un la bémol: de
forte que fi ces cordes réfonnoient dans leur totalité,
on entendre; t ce chant, ou plutôt cet accord, la bémol,
fa u t , dont le plus haut ton ut eft à la dix-fepiieme
majeure au deffus de la bémol, 8c à la douzième au
deffus de fa.
Ainfi il réfiilte des deux expériences que nous venons
de rapporter; i° . Qu’en frappant un feul fon
quelconque, ut par exemple, on entendra en même
tems fa douzième au-deffus fo l, & fa dix-feptième
majeure au-deffus mi ; a°, que les cordes la bémol &
fa , qui feront à la dix-feptième majeure au-deffous
d'ut, & à la .douzième gu-deffpus , frémiront fans
réfonner.
O r , la douzième eft l’oélave de la quinte, & la
dix-feptième majeure , l’eft de la tierce majeure : &
comme nous avons une facilité naturelle à confondre
les fons avec leurs oâaves. ( Voyez ofiavef, il s’enfuit
i°. qu’au lieu des trois fons ùt fondamental, fol
douzième & mi d'ix-îeptième-majeurè qu’on entend
en même tems, on peut fubftituer ceux-ci, qui i f en
différeront prefque pas quant à l’effet, ut, mi tierce
majeure, ^0/-quinte : ces trois fors forment 1 accord
qu’on nomme accord parfait meneur, & dans lequel
le fon ut eft encore regardé comme fondamental, quoiqu’il
ne le foit pas immédiatement, & qu’Une le deviens
e quepar une efpèce d’extenfion , en lubftituant
• à la douzième & à la dix-fepcvèmè , lés o Slaves de ces
deux fons. a0. De même au lieu de trois fons, ut fon
principal, la bémol dix-feptième majeure au-deffous
d’ut, du fa douzième au-deffous, qu’on ehtendroit fi les
cordes fa & la bémol réfonnoient en totalité, on peut
imaginer çeux-ci (en mettant la quinte & la tierce
. majeure, au ïieirde la douzième & la dix-feptième) ,
fa quinte au de l i e ns dW, la bémol, tiercé majeure
au-deffous
F O N
au-deffous ut fondamental. Or , la bémol fai Tant une
tierce majeure avec ut-, fait une tierce mineure avec
fa; ce qui produit un autre accord appelé accord parfait.
mineur"; voyez accord & m'neur. Dans cet accord,
il n’y a proprerr.et aucun fon fondamental : car fa
ne fait point entendre la b.mol, comme ut fait entendre
mi.Do plus, fi l’on regardoit ici quelque fon
ccmme^wzdkmf/tta/quoiqu’improprement, ce devroit
être le fon le plus haut ut b): car c’eft ce fon qui fait
frémir/â & la bémol, & c’eft du fi émifferrüfnt à e fj &
de la bémol', occafionné par la réfonnance d'ut, qu’on
a tiré t’accord mineur fa , la bémol, ut. Cependant
comme la corde fa en résonnant fait entendre ut,
quoiqu’elle ne faffe ni entendre ni frémir la bémol,
on regarde lê fon le plus bas fa , comme fondamental
dans l’accord mineur f a , la bémol, ut, comme
le fon Je plus bas ut, eft fondamental dans l’accord
majeur ut ml fol.
Tel eft l’origine que M. Rameau donne à l’accord
& au mode .mineur; origine que nous pourrons dif-
cuter à Mo d e mineur , en examinant les objeélions
qu on lui a faîtes ou qu’on peut lui faire fur ce ftijet,
& en appréciant ces objeélions. Quoi qu’il en foit,
il eft au moins certain que dans tout accord parfait,
foit majeur, foit mineur, formé d’un fon principal,
de fa tierce majeure ou mineure & de fa quinte, on
appelle fondamental le fon principal, qui eft le plus
grave pu le plus bas de l’accord ( c ) .
Quelques phyficiens ont entrepris d’exp’iquer ce
& # gul ier phénomène delà réfonna.;ce de la douzième
oc de la dix-'eprième majeure, conjointement avec
loclave; mais de toutes les explications qu’on en a
données, il n’y en a que deux qui nous paroiffent
mériter qu’on en faffe mention.
La première eft de M. Daniel Bèrnouilli. Ce grand
géomètre prérënd dans les rpimoirts de Vacadémie des
Jcen.es de Pruffe, pour U année 1753., que la vibration
d’une corde eft un mélange de plufieurs vibrations
part elles ; qu’il faut diftinguer dans une corde
en vibration différons points qui font comme de, espèces
de noeuds ou points fixes, autour defquels
orcil!e la partie de la corde comprife encre deux de
ces points vpifins l’un de l’autre; je dis comme de;
efp 'cLS de noeud; ou points fixes; car ces points ne
font pas véritablement immobiles , ils ne le font, ou
plurot ils ne font confidérés comme tels, que par
rapport à la partie dé la corde qui ofci'le entre deux ;
& d ailleurs ils. font eux-mêmes des vibrations par
rapport aux deux extrémités véritablement'-fixes de
la corde. Or dans cette fuppofnion, M. Daniel 8er-
nouilh prouve que tous les points de la corde
ne font pas leurs vibrations en même-temp: ; mais
que les uns font deux vibrations, les autres trois, &c.
pendant que d’autres n’errfont qu’une ; & c’eft par-là
quil explique la multiplicité de fons qu’on entend
dans le frémiffement d'une même corde; car on fait
Musique. Tome I .
F O N 5 6 9
que la différence des fons vient de celle des vibrations.
Comme M. Daniel Bernoulli at'aque dans ce mémoire
la théorie que j’ai donnée le' premier d: la
vibration des corps fonores, voyez l’article Corde ;
j’ai cru' devoir répondre à fes obje&ions par un écrit
particulier que j ’efpère publier dans une autre oc-
cafion; mais cette difcufiïon n’étant point ici de mon
fujet, je me borne à la queftion préfente. J’accorde
d'abord à M. Bèrnouilli ce que je ne crois pas, ôc
ce que M. Euler me paroît avoir très-bien réfuté
dans les mémoires de l’académie de Berlin 1753 ,
lavoir, qu’une corde en vibration décrit toujours ou
une trochoïde fimp’e , ou uce courbe, qui n’eft autre
chofe que le mélange de p’ufieurs trochoïdes. En
admettait cette propofition, j’obferve d’abord que
dans les cas ou la* courbe décrite fera une trochoïde
fimple ( ce qui peut & doit arriver fouvent, & ce
que <v1. Bèrnouilli lémble fuppofer lui-même) tous
les points fe ont leurs vibr irions en même-temps,
& que par conféqüent il n’y aura poinr de fon mui-
tip’e : or cela eft contraire à l’expérience , puifque
toute corde mife en vibration fiait entendre plufieurs
fons à la fois.
Je demande de plus, i 0. , ce que M. Daniel Bernoulli
n’a poi :>t exp’iqué, quelle fera la caufe qui
déterminera la co-de vibrante à-être un mélange de
plufieurs trochoïdes? 20. , Ce qu’il a expliqué encore
moins, quelle fera la caufe qui détermin: ra conf-
tamment ces trochoïd.s à être telles qu’on entende
loétave, la douz ème & la dix-feptième, plutôt qua
tout autre fon ? On concevroit aifément comment la
corde feroit entendre, outre le fon principal, l’octave
, la douzième & la dix-feptième, fi les points
de la corde qui forment les extrémités des trochoïdes
partielles, étaient de véritables noeuds ou
points fixes, tels que les parties de (a corde com-
prifes entre ces noeud ;, fiffent dans le même temps ,
la première, une vibration; la fécondé, deux; la
troifieme, trois; la quatrième, quatre; la cinquième,
cinq, &c. En ce cas, on pourroit regarder la corde
comme compofee de cinq parties différentes, placées
en ligne droite, immobiles chacune à leurs extrémités
, & formant par leurs differentes long leurs cette
•fuite ou progreflion , 1 , | , j-, ±, 1 , &c. ; mais l’expérience
démontre que cela n’eft pas ainfi. Dans une
corde qui fait librement fes vibrations , on ne remarque
point d’autres noeuds ou points abfolument
fixes que l'extrémité, & M. Bèrnouilli paroît ad*
mettre cette vérité.
Il eft vrai qu’en regardant les noeuds comme mobiles,
& en fuppofant d’ailleurs que la corde vibrante
foit un mélange de plufieurs trochoï ;es, les
différens points de cette corde font leurs vibrations
en differens temps ; mais il eft aifé de voir que cette
différence de vibrations ne p.ut fervir à expliquer
la multiplicité des fons. En eff : t, fuppofons pour
C c c c