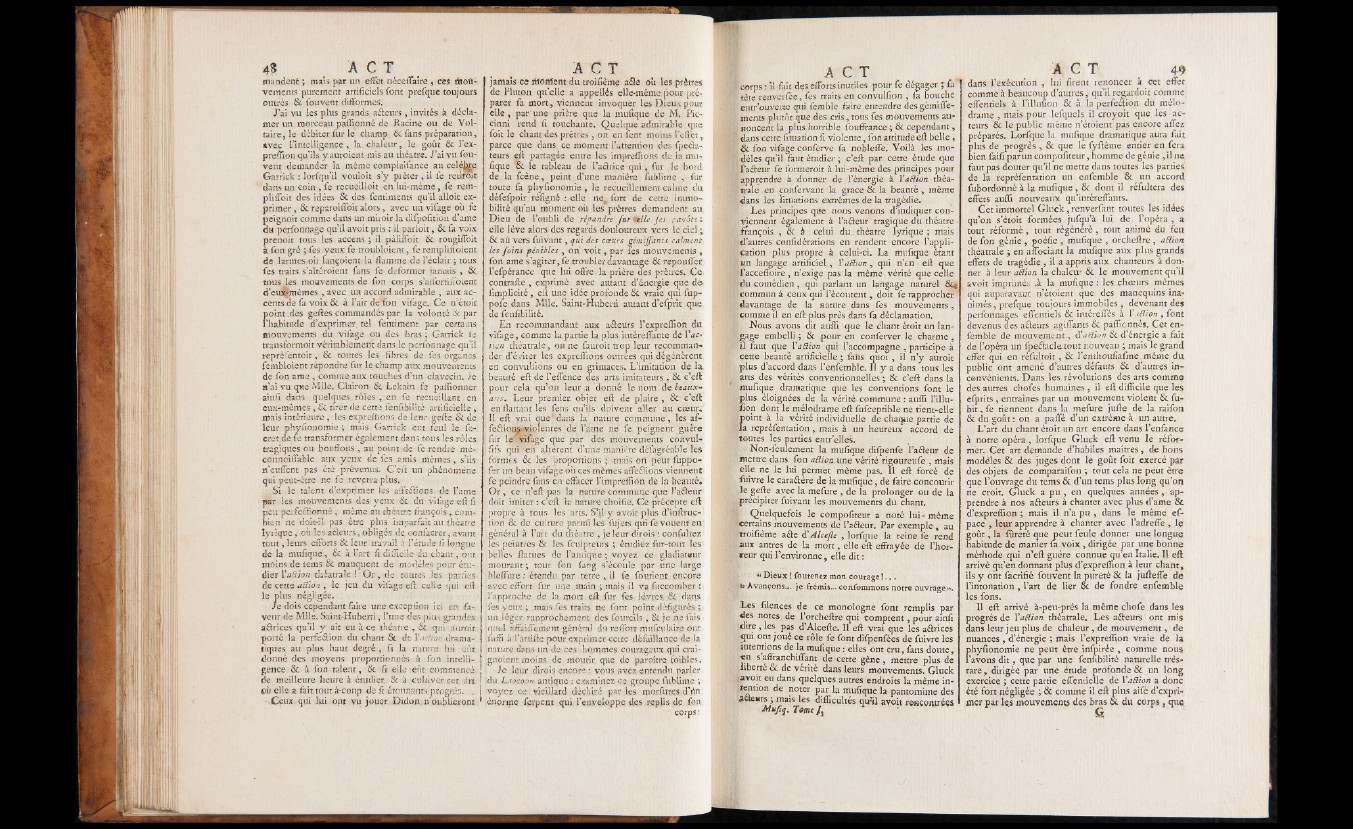
48 A C T
mandent ; mais par un effet nécefTaîré , ces rttoû-
vements purement artificiels font prefque toujours
outrés 8c fouvent difformes.
J’ai vu les plus grands, aâeurs , invités à déclamer
un morceau paffionné de Racine ou de Voltaire
, le débiter fur le champ 8c fans préparation,
avec l'intelligence, la,chaleur, le goût 8c l’ex-
preflion qu’ils y auraient mis au théâtre. J’ai vu fou-
vent demander la môme complaifance au celéh&e
Garrick : lorfqu’il vouloir s’y prêter , il fe retirait
dans un coin , fe recueilloit en lui-même, fe rem-
pliffoit des idées & des fentiments qu’il alloit exprimer
, & reparoiffôit alors, avec un vifage où fe
peignoit comme dans un miroir la difpofition d’ame
du perfonnage qu’il avoit pris : il parloit, & fa voix
prenoit tous les accens ; il pâliffoit 8c rougiffoit
à fon gré ; fes yeux fe troubloient, fe remplifïoient
de larmes où lançoient la flamme de l’éclair ; tous
fes traits s’altéroient fans fe déformer jamais , 8c
tous les mouvements de fon corps s’âüortiiioient
d’eiuÊfmêmes , avec un accord admirable , aux accents
de fa voix 6c à l ’air de "fon vifage. Ce n’étoit
point .dés geftes commandés par la volonté 8c par
l’habitude d’exprimer tel fentiment par certains
mouvements du vifage ou des bras ; Garrick fe
transformoit véritablement dans le perfonnage qu’il
repréfêntoit, 8c toutes les fibres de fes organes
fembloient répondre fur le champ aux mouvements
de fon ame , comme aux touches d’un -clavecin. Je
n’ai vu que Mlle. Clairon 6c Lekain fe paflionner
ainfi dans quelques rôles , en fe recueillant en
eux-mêmes , 8c tirer.de cette fenfibilité artificielle ,
mais intérieure , les expre.ffions de leur gefte & de,
leur phyfionomie •; mais Garrick eut ieul le fe-.
cret.de le transformer également dans tous les.rôles
tragiques ou bouffons , au point.de fe rendis mé-
connoiffable aux yeux de fes amis mêmes, s’ils
n’euffent pas été prévenus. C ’eff un phénomène
qui peut-être ne fe reverra plus.
. Si le talent d’exprimer les affeâions de l ’ame
par les mouvements des;yeux 6c du vifage eft fi
peu perfeélionné , même au théâtre françois, combien
ne doit-il pas être plus imparfait au théâtre
lyrique, où les aéleurs, obligés de, confacrer, avant
tout, leurs efforts 8c leur travail à l’étude fi longue
de la mufique, & à l’ait fi.difficile- du.chant, ont
moins .de tems 6c manquent de modèles pour étudier
Y aflion théâtrale.! O r , de toutes les parties-
de cette aflion , le jeu du vifage eft celle qui eff
le plus négligée.
Je dois cependant faire une exception ici en faveur
de Mlle, Saint-Huberti, l’une des plus grandes
aârices qu’il y ait eu à ce théâtre , 8c- qui aurait
porté la perfeélion du chant 8c de Y action dramatiques
au plus haut degré , fi la nature, lui eût
donné des moyens proportionnés à fon intelligence
6c à fon talent, 6c fi elle eut. commencé?-
de meilleure heure à étudier. & à cultiver cet art
où elle a fait tout à-coup de fi étonnants progrès. .
-.Ceux qui lui opt vu jouer Pidon, n’ônbUerant
A C T
I jamais ce moment du troifièriie a&e où les prêtres
de Pluton qu’elle a appellés elle-même pour préparer
fa mort, viennent invoquer les Dieux pour
e lle , par une prière que la mufique de M. Pic-
cinni rend fi touchante. Quelque admirable que
foit le chant des prêtres -, on en fient moins l’effet,
parce que dans ce moment l’attention des fpeéia-
teurs eu partagée entre les impreffions de la mu-
fique ©c le tableau de l’aétrice q u i, fur le .bord
de la fcène, peint d’une manière fublime , fur
toute fa phyfionomie , le recueillement calme du
défefpoir réfigné r elie ne fort de cette immobilité
qu’au moment où les prêtres demandent au
Dieu de l’oubli de répandre fur toile fes pavots ;
elle lève alors des regards douloureux vers le ciel ;
6c aü vers fuivant, qui des coeurs gémijfants calment
les foins pénibles , on v o it , par les mouvements ,
fon ame s’agiter, fe troubler davantage & repouffer
l’efpérance que lui offre la prière des prêtres. Ce
çontrafle , exprimé avec autant d’énergie que de
fimplicité, eu une idée profonde 8c vraie qui fup-
pofe dans Mlle. Saint-Huberti autant d’efprit que
de fenfibilité.
En recommandant aux a&eurs l’exprelfion du
vifage, comme la partie la plus intéreffante de Vaction
théâtrale, oh ne fauroit trop leur recommander
d’éviter les expreflions outrées qui dégénèrent
en convulfions ou en grimaces. L ’imitation de la
beauté eft de l’effence des arts imitateurs , 6c c’eft
pour cela qu’on leur a donné’ le nom de beaux-
arts. Leur premier, objet eft de plaire , 8c c’eft:
en flattant les fens qu’ils doivent aller au coeur.
U eft vrai que-"dans la nature commune, les af-
; ferions violentes de l’ame ne fe peignent guère
| fur le*? vifage que par des mouvements convul-
[ fi fs qui en altèrent d’une manière défagréabîe les
’ formes 8c les proportions ; -mais on peut fuppo-
fer un beau vifage où ces mêmes affeâions viennent
fe peindre fans en effacer l’imprefiion de la beauté.
O r , ce n’eft pas la nature commune que l’aâeur
doit imiter : c’eft la nature’ ehoifie. Ce précepte eft:
propre à tous les arts. S’il y avoit plus d’inftruç-
tion 8c de culture parmi les fujets qui fe vouent en
général à l’art du théâtre , je leur dirois : confultez
les peintres 8c les fculpteurs ; étudiez fur-tout les
belles ftatues de l’antique ; voyez ce gladiateur
mourant; tout fon fang s’écoule par une large
bleffure : étendu par terre , il fe fondent encore
avec effort fur une main ; mais il va fuccomber :
.rapproche de la mort eft fur les lèvres. 8c dans
fes yeux ; mais fes traits, ne font point défigurés ;
un léger rapprochement des fournils , 8c je ne fais
'quel affaiffement général du reflort miifculaire ont
laffi à l’artifte pour exprimer cette défaillance de la
nature dans un de ces hommes courageux qui crai-
ignoient moins de mourir que. de paraître foibles.
Je leur .dirois encore vous avez entendu parler
du Laoc.oon antique : examinez ce groupe fublime ;
voyez ce vieillard déchiré par les morfurçs d’fift
énorme ferpent qui reoyeloppe des replis de. fon
^ corps:
A C T
i-corps t îl fait des efforts inutiles pour fe dégager ; fa
tête renverfée, fes traits en convulfion , la bouche
entr’ouverte qui femble faire entendre des gémiffe-
ments plutôt que des cris, tous fes mouvements annoncent
la plus horrible fouffrance ; 8c cependant,
( dans cette fituation fi violente, fon attitude eft belle ,
; & fon vifage çonferve la nobleffe.' Voilà les modèles
qu’il faut étudier ; c’eft par cette étude que
(Fadeur fe formerait à lui-même des principes pour
lapprendre à donner de l’énergie à Y aflion théa-
• traie en co.nfervant la grâce 8c la beauté, même
dans les iituations extrêmes de la tragédie.
Les principes que nous venons d’indiquer conviennent
également à Fadeur tragique du théâtre -
françois , 8c à celui du, théâtre lyrique ; mais
d’autres confidérations en rendent encore l’appli-
|cation plus propre à celui-ci. La mufique étant
un langage artificiel, Y aflion, qui n’en eft que
jTacceffoire , n’exige pas’la même vérité que celle
dû comédien, qui parlant un langage naturel 8c$
[commun à ceux qui l’écoutent, doit fe rapprocher *
davantage de la Hature dans fes mouvements,
(comme il en eft plus près dans (a déclamation.
I -Nous avons dit aufli que le chant étoit un langage
embelli ; 8c pour en conferver le charme,
il faut que Y délion qui l’accompagne , participe à
cette beauté artificielle ; fins quoi, il n’y aurait
plus d’accord dans l’enfemble. Il y a dans tous les
grts des vérités conventionnelles ; 8c c’eft dans la
mufique dramatique que les conventions font le
plus éloignées de la vérité- commune : aufli l’illu-
:îion dont le mélodrame eft fufceptible ne tient-elle
'point à la vérité individuelle de chaque partie de
la repréfentation, mais à un heureux accord de
»■toutes les parties entr’elles.
Non-feulement la mufique difpenfe Fadeur de
mettre dans fon a fl ion,une vérité rieoureufe , mais
elle ne le lui permet même pas. Il eft forcé de
fuivre le caradère de la mufique, de faire concourir
le gefte avec la mefure , de la prolonger ou de la
.précipiter fuivant les mouvements du chant.
[ Quelquefois le compofiteur a noté lui - même
■ r.ta\ns mouvements de Fadeur. Par exemple , au
Itroifième ade $ Aieefie , lorfque la reine fe rend
aux antres de la mort, elle eft effrayée de l’hor-
«•eur qui l’environne, elle dit :
«* Dieux ! foutenez mon courage ! . . .
sa Avançons... je frémis... confommons notre ouvrage m
Les filences de ce monologne font remplis par
des notes de l’orcheftre qui comptent, pour ainfi
dire, les pas d’Alcefte. Il eft vrai que les adrices
qui ont joué ce rôle fe font difpenfées de fuivre les
intentions de la mufique : elles ont cru, fans doute,
en s affranchiffant de cette gêne, mettre plus de
^•liberté 8c de vérité dans leurs mouvements. Gluck
avoit eu dans quelques autres endroits la même in-
Jtennon de noter par la mufique la pantomime des
acteurs ; mais les difficultés qufil avoit rencontrées
Mufiq. Tômc /,
 G T 49
dans l’exécution , lui firent renoncer à cet effet
comme à beaucoup d’autres, qu’il regardoit comme
effentiels à Filluüon 8c à la perfection du mélodrame
, mais pour lefquels il croyoit que les acteurs
& le publie même n’étoient pas encore affez
préparés. Lorfque la mufique dramatique aura fait
plus de progrès , 8c que le fyftême entier en fera
bien fiifi par un compofiteur, nomme de génie ,il ne
faut pas douter qu’il ne mette dans toutes les parties
de la repréfentation un enfemble 8c un accord
fubordonné à la mufique, 8c dont il réfultera des
effets aufli nouveaux qu’intèreffants.
Cet immortel Gluck, renverfant toutes les idées
qu’on s’étoit formées jufqu’à lui de l’opéra, a
tout réformé, tout régénéré, tout animé du feu
de fou génie , poéfie , mufique , orcheftre, aétion
théâtrale ; en affociant la mufique aux plus grands
effets de tragédie , il a appris aux chanteurs à donner
à leur aflion la chaleur 8c le mouvement qu’il
avoit imprimés .à la mufique : les choeurs mêmes
qui auparavant n’étoient que des manequins inanimés
, prefque toujours immobiles , devenant des
perfonnages effentiels. 8c intéreffés à Vaflion , font
devenus des aâeiirs .agiffants 8c paflicnnés. Cet enfemble
de mouvement.,, d'aflion 6c d’énergie a fait
de l’opéra un fpeélacle-tout nouveau ; mais le grand
effet qui en réfultoit, 8c l’enthoufiafme même du
public ont amené d’autres défauts 8c d’autres inconvénients.
Dans les révolutions des arts comme
des autres chofes humaines , il eft difficile que les
efprits , entraînés par un mouvement violent 8c fu-
bit, fe tiennent dans la mefure jufte de la raifon
8c du goût : on a paffé d’un extrême à un autre.
L’art du chant étoit un art encore dans l’enfance
à notre opéra, lorfque Gluck eft venu le réformer.
Cet art demande d’habiles maîtres, de bons
modèles 8c des juges dont le goût foit exercé par
des objets de comparaifon ; tout cela ne peut être
que l’ouvrage du tems 8c d’un tems plus long qu’on
ne croit. Gluck a p u , en quelques années, apprendre
à nos aâeurs à chanter avec plus d’ame 6c
d’expreflion ; mais il n’a pu , dans le même espace
, leur apprendre à chanter avec l’adreffe , lç
goût, la fureté que peut feule donner une longue
habitude de manier fa voix, dirigée par une bonne
méthode qui n’eft guère connue qu’en Italie. Il eft:
arrivé qu’en donnant plus d’expreflion à leur chant,
iis y ont facrifié fouvent la pureté 8c la jufteffe de
l’intonation, l’art de fier oc de fondre enfemble
les fons.
11 eft arrivé à-peu-près la même çhofe dans les
progrès de Yaflion théâtrale. Les aâeurs ont mis
dans leur jeu plus de chaleur, de mouvement, de
nuances , d’énergie ; mais l’expreffion vraie de la
phyfionomie ne peut être infpirée, comme nous
l’avons d it, que par une fenfibilité naturelle très-
rare, dirigée par une étude profonde 8c un long
exercice ; cette partie effçntielle de Y aflion a donc
été fort négligée ; 8c comme il eft plus aifé d’expri-
jner par lçs mouvements des bras oc du corps, que.