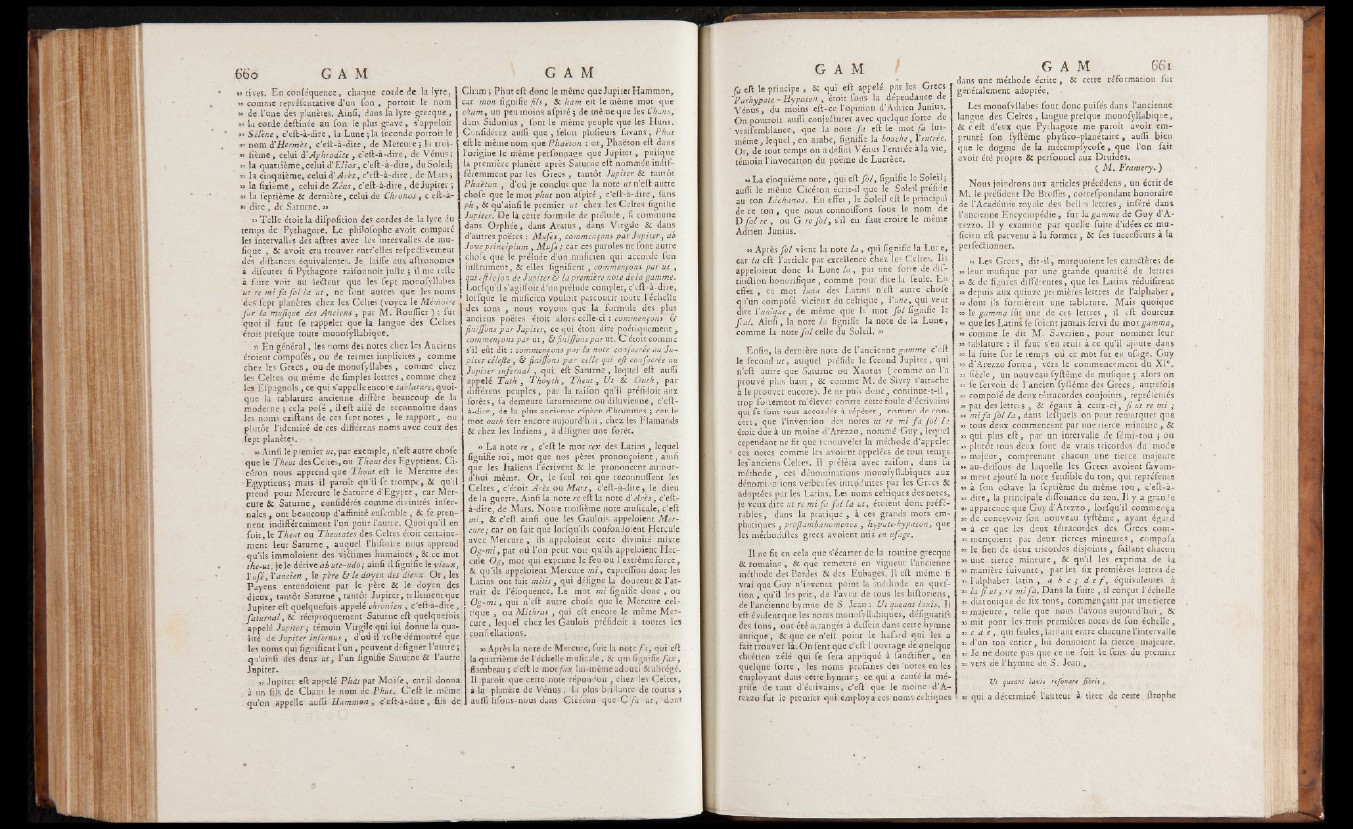
»3 tives. En conléquencc, chaque corde de la lyre,
»> comme représentative d’un Ton , portoit le nom
» de l’une des planètes. Ainfi, dans la lyre grecque ,
» lu corde deftinée au fon le plus grave, s’appeloic
» S i le ne, c’eft-à-dire, la Lune; la fécondé pot toit le
» nom à'Hermèsy c’eft-à-dire, de Mercure; la t-roi-
*» (ième, celui d’Aphrodite , c’eft-à-dire, de Vénus ;
» la quatrième,celui d’Elios t c’eft-à-dire, du Soleil;
m la cinquième, celui d'Arès, c’eft-à-dire, de Murs;
»» la fixième, celui de Zéus, c’eft-à-dire , de Jupirer ;
n la feptième & dernière, celui de Chionos, c'eft-à-
*> dire, de Saturne.»
» Telle étoitla difpofition des cordes de la lyre du
temps de Pythagore. Le philofophe avoir comparé
les intervalles des aftres avec les intervalles de mufique
, & avoit cru trouver entr’clles refpeftivement
des diftances équivalentes. Je laiffe aux aftronomes
à difeuter fi Pythagore raifonnoit jufte ; il me refte
à faire voir au lefteur que les fept monofyllabes
ut re mi fa fo lia ut, ne font autres que les noms
des fept planètes chez les Celtes (voyez le Mémoire
fur la mufique des Anciens , par M. Rouflier ) ; fur
quoi il faut fe rappeler que la langue des Celtes
étoit prefque toute monofyllabique.
» En général, les noms des notes chez les Anciens
étoient compofés, ou de termes implicites , comme
chez les Grecs, ou de monofyllabes , comme chez'
les Celtes ou même de fimples lettres , comme chez
les Efpagnols, ce qui s’appelle encore tablature, quoique
la tablature ancienne diffère beaucoup de la
moderne ; cela pofé , il eft aifé de reconnoître dans
les noms exiftans de ces fept notes , le rapport, ou
plutôt l’identité de ces différens noms avec ceux des
fept planètes.
» Ainfi le premier ut,par exemple, n’eft autre chofe
que le Theut desCeites,ou Thout&es Egyptiens. C icéron
nous apprend que Thout ell le Mercure des
Egyptiens; mais il paroît qu’il fe trompe, & qu’il
prend pour Mercure le Saturne d’Egypte, car Mercure
& Saturne , confidérés comme divinités infernales
, ont beaucoup d’affinité enfcmble , & fe prennent
indifféremment l’un pour l’autre. Quoiqu’il en
foit,lc Theut ou Theutates des Celtes étoit certainement
leur Saturne , auquel l’hiftoire nous apprend
qu’ils immoloient des viâiimes humaines-, & ce mot
the-ut, je Je dérive ab ute-udo; ainfi il fignifie le vieux,
ïuféy l’ancien , le père & le doyen des dieux. O r , les
Payens entendoient par le père & le doyen des
dieux, tantôt Saturne , tantôt Jupiter, tellement que
Jupiter eft quelquefois appelé chronien , c’cft-à-dire,
faturnal, & réciproquement Saturne eft quelquefois
appelé Jupiter i témoin Virgile qui lui donne la qualité
de Jupiter infernus , d’où il 'refte démontré que
Cham ; Phut eft donc le même que Jupiter Hammon,
car mon fignifie fils , & ham eit le même mot que
cham, un peu moins afpiré; de même que les Ckunsy
dans Sidonius , font le même peuple que les Huns.
Confidérez aufli que , félon plufieurs favans, Phut
eft le même nom que Phaëton : or, Phaëton eft dans
l’origine le même perfônnage que Jupiter, puifquc
la première planète après Saturne clt nommée indifféremment
les noms qui lignifient l’un, peuvent défigner l ’autre ;
qu’ainfi des deux ut3 l’un fignifie Saturne & l’autre
Jupiter.
» Jupiter eft appelé Phdt par Moïfe, car il donna
à un fils de Cham le nom de Pkut. C ’eft le même
qu’on appelle auffi Hammen, c’eft-à-diic, fils de
par les Grecs , tantôt Jupiter & tantôt
Phaëton , d’où je conclus que la note ut n’eft autre
chofe que le mot phut non afpiré , c’eft-à-dire, fans
pk, & qu’ainfi le premier ut chez les Celtes fignifie
Jupiter. De là cette formule de prélude, fi commune
dans Orphée, dans Aratus, d’an.s Virgile & dans
d’autres paëtes : Mufes, commençons par Jupiter, ab
Jove principium y.Mufij car ces paroles ne font autre
chofe que le prélude d’un muliciën qui accorde fon
inftrumént, & elles lignifient , commençons par ut ,
qui t fie fon de Jupiter & la première note de la gamme.
Lorfqu’il s’agilFoicd’un prélude complet, c’cft-à-dire,
Vlorfque le muficien vouloir parcourir toute l’échelle
des tons , nous voyons que la formule des plus
anciens poëtes étoit alors celle-ci : commençons &
finijfons par Jupiter, ce qui étoit dire poétiquement ,
commençons par u t, & finirons par ut. C ’étoit comme
s’il eût dit : commençons par la note confacrée au Jupiter
cèle f é , & finijfons par celle qui efi confacrée au
Jupiter infernal , qui eft Saturne , lequel eft aufli
appelé Tutk , Thoyth, Theut, Ut & Outh, par
différens peuples, par la raifon qu’il préfidoit aux
forêts, fa demeure faturnienne ou diluvienne, c’eft-
à-dire, de la plus ancienne cfpèce d’hommes ; car le
mot outh fert encore aujourd’hui, chez les Flamands
& chez les Indiens, à défigner une forêt.
» La note re, , c’eft le mot'rc» des Latins , lequel
fignifie roi, mot que nos pères prononçoient, ainfi
que les Italiens l’écrivent & le prononcent aujourd’hui
même. O r , le feul roi que reconnuffent les
Celtes , c’étoit Arès ou Mars, c’cft-à-dire, le dieu
de la guerre. Ainfi la note re eft la note d'Arès, c’eft-
, à-dire, de Mars. Notre troifième note muficale, c’eft
mi, & c’eft ainfi que les Gaulois appeloient Mer-
1 cupe; car on fait que lorfqu’ils confondoient Hercule
avec Mercure , ils appeloient cette divinité mixte
Og-mi, par où l’on peut voir qu’ils appeloient Hercule
Ogy mot qui exprime le feu ou l’extrême force,
& qu’ils appeloient Mercure mi, expreflïon doiit les
Latins ont fait mitis, qui défigne la douceur & l’attrait
de l’éloquence. Le mot mi fignifie donc , ou
Og-mi, qui n’eft autre chofe que Te Mercure celtique
, ou Mitkras , qui eft encore le même Mercure
, lequel chez les Gaulois préfidoit à toutes les
! confiellations.
» Après la note de Mercure, fuit la note f i , qui eft
la.quatrième de l’échelle muficale , & qui fignifie fa x ,
flambeau ; c’eft le mot fax lui-même adouci & abrégé.
II .paroît que cette note répondoit, chez les Celtes,
à la planète de Vénus , la plus brillante de toutes ;
aufli. lifons-nous dans Cicéron que-C fa ut, dont
fa eft le principe , Sc qui eft appelé par les Grecs
Parhypate - Hypaton 3 étoit fous la dépendance de
Vénus, du moins eft-ce l’opinion d’Adrien Junius.
On pourroit aufli conje&urer avec quelque force de
' vraifemblance, que la noce fa eft le mot fa lui-
même, lequel, en arabe, fignifie la bouche, l’entrée.
Or, de tout temps on adéfini Vénus l’entréeàla vie,
témoin l’invocation du poëine de Lucrèce.
m La cinquième note, qui eft fo l, fignifie le Soleil;
aufli le même Cicéron écrit-il que le Soleil préfide
au ton Lichanos. En effet, le Soleil eft le principal
de ce ton, que nous connoiffons fous le nom de
D foire , ou G re fo l 9 s’il en faut croire le même
Adrien Junius.
» Après fo l vient la note la , qui fignifie la Lure,
car la eft l’article par excellence chez les Celtes. Ils
appeloient donc la Lune la , par une force de dif-
tinélion honorifique, comme pour dire la feule. Eu
effet, cè mot luna des Latins n’eft autre chofe
q i’un co.mpofé vicieux du celtique , Yune, qui veut
dire Y unique, de même que le mot fo l fignifie le
f u i . Ainfi, la note la fignifie la note de la Lune,
comme la note fo l celle du Soleil. »
Enfin, la dernière note de l’ancienne gamme c’eft
le fécond ut, auquel préfide le fécond Jupiter, qui
n’eft autre que Saturne ou Xantus ( comme on l’a
prouvé plus haut, & comme M. de Sivry s’attache
a le prouver encore). Je ne puis donc, continue-t-il,
trop fortement m’élever contre cette foule d’écrivains
qui fe font tous accordés à répéter , comme de concert,
que l’invention des notes ut re mi fa fo l la
étoit due à un moine d’Arezzo, nommé G uy, lequel
cependant ne fit que renouveler la méthode d’appeler
ces notes comme les avoient appelées de tout temps
les"anciens Celtes. Il préféra avec raifon, dans fa
méthode , ces dénominations monofyllabiqùes aux
dénominations verbeufes introduites par les Grecs &
adoptées par les Latins. Les noms celtiques des notes,
je veux dire ut re mi fa fo l la ut, étoient donc préférables
, dans la pratique , à ces grands mots emphatiques
, proflambanomenos , hyp a te- hyp aton, que
les methodiftes grecs avoient mis en ufage.
Il ne fit en cela que s’écarter de la routine grecque
& romaine , & que remettre en vigueur l’ancienne
méthode des Bardes & des Eubages. Il eft même fi
vrai que Guy n’ inventa point la méthode en quef-
tion, qu’il les prit, de l’aveu de tous les hiftoriens,
de l’ancienne hymne de S. Jean : Ut queant Iaxis. Il
eft évidentque les noms monofyllabiqùes, défignatifs
des tons, ont été arrangés à deflèin dans cette hymne
antique, & que ce n’eft point le hafard qui les a
fait trouver là. On fent que c’eft l'ouvrage de quelque
chrétien zélé qui fe fera appliqué à fan édifier, en
quelque force , les noms profanes des 'notes en les
employant dans cetrc hymne; ce.qui a caulé la mé-
prife de tant d’éciivains, c’eft que le moine d’A-
rezzo fut le premier qui employa ces noms-celtiques
dans une méthode écrite, & cette réformacion fut
généralement adoptée.
Les monofyllabes font donc puifés dans l’ancienne
langue des Celtes, langue prelque monofyllabique,
& c’eft d’eux que Pythagore me paroît avoir emprunté
fon. fyftêmc phyfico-planétaire, aufli bien
que le dogme de la métempfycofe, que l’on fait
avoir été propre & perfonnel aux Druides.
( M. Framery• )
Nous joindrons aux articles précédens, un écrit de
M. le préfîdent De Broffes, correfpondant honoraire
de l’Académie royale des belle s- lettres, inféré dans
l’ancienne Encyclopédie, fur la gamme de Guy d’A-
rezzo. Il y examine par quelle fuite d’idées ce muficien
eft parvenu à la former, & fes fucceffeurs à la
perfectionner.
« Les Grecs, dit-il, marquoient les caractères de
» leur mufique par une grande quantité de lettres
sa & de figures différentes, que les Latins réduifirent
» depuis aux quinze premières lettres de l’alphabet,
» dont iis formèrent une tablature. Mais quoique
» le gamma fût une de ces lettres , il eft douteux
» que les Latins fe fôknt jamais fervi du mot
» comme le dit M. Saverien , pour nommer leur
.» tablature : il faut s’en tenir à ce qu’il ajoute dans
» la fuite fur le temps où ce mot fut en ufage. Guy
» d’Arezzo forma, vers le commencement du XIe.
; 93 fiècie, un nouveau fyftême de mufique; alors on
39 fe fervoit de 1 ancien fyftême des Grecs, autrefois
»3 compofé de deux tétracordes conjoints, repréfentés
9# par des lettres , & égaux à ceux-ci, f i ut re mi ,*
93 mi fa fo l la , dans lefquels on peut remarquer que
33 tous deux commencent par une tierce mineure , &
a? qui plus e ft, par un intervalle de fémi-ton ; ou
33 plutôt tous deux font de vrais tricordes du mode
33 majeur, comprenant chacun une tierce majeure
3* au-deffous'de laquelle les Grecs avoient favam-
33 ment ajouté la note fenfible du ton, qui repréfente
33 à fon odave la feptième du même ton , c’eft-à-
33 dire, la principale diflbnance du ton. Il y.a granJe
33 apparence que Guy d’Arezzo, lorfqu’il commença
33 de concevoir fon nouveau fyftême, ayant égard
» à ce que les deux tétracordes des Grecs com-
33 mençoienc par deux tierces mineures, ccmpofa
33 le fien de deux tricordes disjoints , faifant chacun
33 une tierce mineure, & qu’il les exprima de la
33 manière fuivante, parles fix premières lettres de
33 l’alphabet latin , a b c y d e ƒ , équivalentes à
33 la fit.uty re mi fa. Dans la fuite , il conçut l’échelle
33 diatonique de fix tons, commençant par une tierce
33 majeure , telle que nous l’avons aujourd’hui, &
>3 mit pour les trois premières notes de fon échelle ,
33 c d e y qui feules, laidant entre chacune l’intervalle
33 d’un ton entier, lui donnoient la tierce majeure.
33 Je ne doute pas que ce ne foit le Cens du premier
33 vers de l’hymne de S. Jean ,
Ut queant Iaxis refonare fibris,
>» qui a déterminé l’auteur à tirer de cette. ftrophe