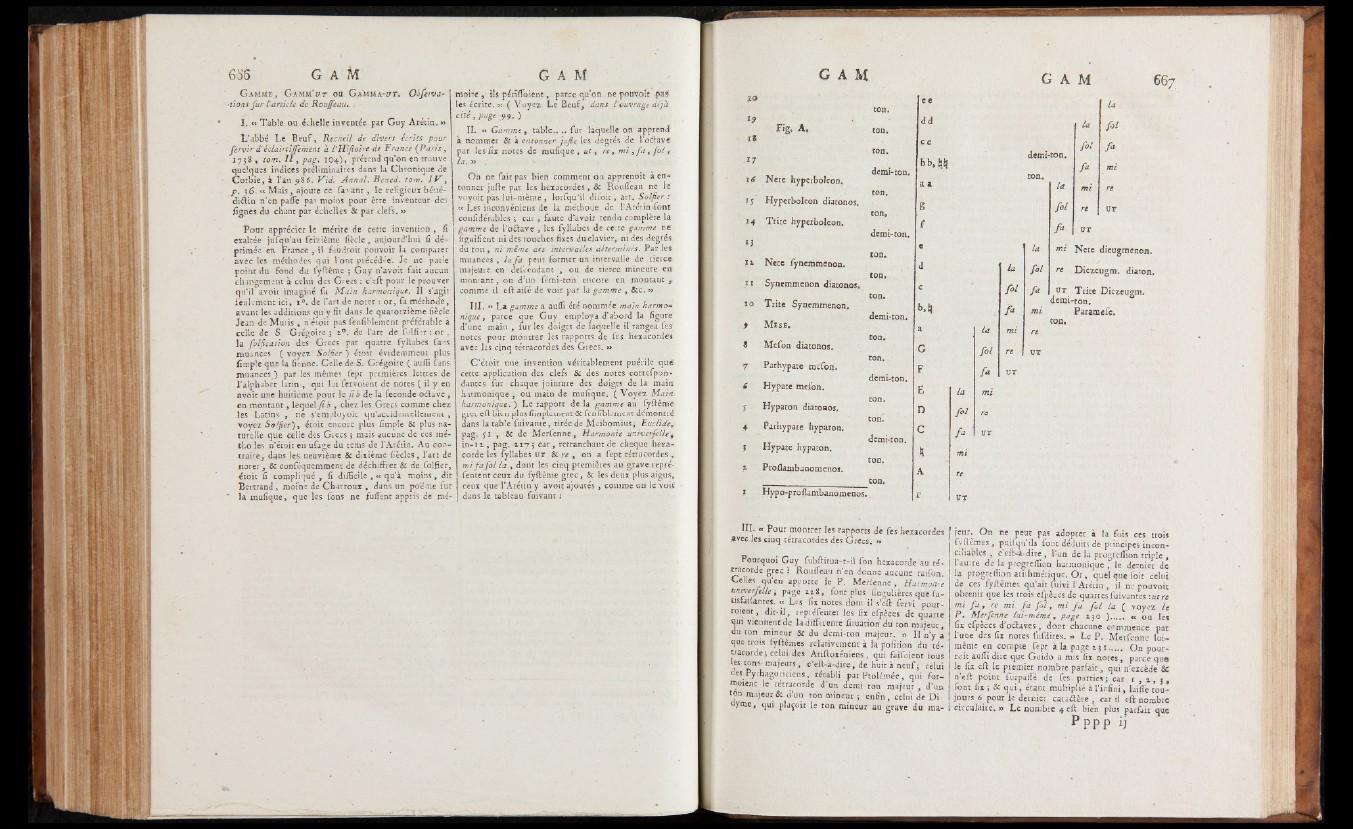
G amme, G amm’ ut ou G amma-itt. Obfeiva-
»lions fur l'article de R o u f eau. .
I . « T a b le ou é ch elle in v en té e par G u y A ré c in . ™
L ’abbé L e B e u f , Recueil de divers écrits pour
fervir d‘ éclaireijfemeUt a l ’Hiftoire de France ( Paris ,
1 7 3 8 , tom. I l 3 pqg. 1 0 4 ) , prétend qu ’on en trou v e
q ue lqu es ind ices préliminaires dans la C h ro n iq u e de
C o r b ie , à l’an 58 6. Vid. Annal. Bcned. tom. I V ^, p. 3 6 , « M a i s, a jou te ce fa v a u t, le r e lig ieu x b én é d
ic tin n’ en pafle pas moins pour être in v eu teur des
lign e s du chant par é ch e lle s & par c le fs . »
P o u r apprécier le mérite de cette in v en tion , fi
ex alté e ju fq u ’ au fe iz ièm e f iè c le , au jou rd ’hui fi d é primée
en France , il fau d ra it pou voir la comparer
a v e c les méthodes q u i l’ont précédée. Je ne parle
p o in t du fon d d,u fy ftêm e ; G u y n’ a v o it fa it aucun
ch angement à ce lu i des G re c s : c’ cft: pour le prouver
q u ’ il a v o ir im a g in é fa Main harmonique. I l s’agit
feu lem en t i c i , i ° , de l’art de n o ter : o r , fa m é th o d e ,
a v a n t les additions q u 'y fit dans le q u a to r z ièm e fiècle
jean de M û r is , n’éto it pas fenfiblement préférab le à
c e lle d e S. G ré g o ir e 5 i ° . de l’àrt de fo lfir r : o r ,
la folfication des G re c s par qua tre fy llab e s fans
muances ( v o y e z " Solfier ) éto it év id emment plus
fimple q ue la fienne. C e lle de S . G ré g o ir e ( auffi fans
mu ance s ) par les mêmes fept premières lettres de
l ’ alphabet latin , qui lui fervo ien t de notes ( i l y en
a v o ir une huitième pour le j îb de la fécond é o& a v e *
e n m o n ta n t , leque l f i b , ch e z les G r e c s comme ch e z
le s La tin s , ne s’em p lo y o it q u ’accidcntellement ,
v o y e z Solfier) , é to it .e n c o r e plus fimple & plus naturelle
q ue c e lle des G re c s ; mais aucune de ces méthodes
n’éto it en u fa g e du tems de l’Àré tin . A u cont
ra ir e , dans les neuvième & dixième f iè c le s , l’art de
n o te r , & conféquemment de dé chiffrer & de fo lfie r ,
é to it fi comp liqu é 3 fi difficile , « qu ’à m o in s , dit
B e r tra n d , moine de C h a r ro u x , dans un po èm e fur
0 la m u fiq u e , q ue les fon s ne fuffent appris de mémoire
, ils p é r i fto ie n t , parce qp’on ne pou voir pà$
les écrire. m. ( V o y e z L e B e u f , dans Vouvrage déjà
cite , page 99. )
II. « Gamme , ta b le .. .. fur laque lle ori apprend
à nommer & à entonner jufie les degrés de l’octàyéf
par les fix notes de m u fiq u e , u t , re, mi f a f o l t
la.™ .
O h ne fa it pas b ien comment o n apprenoit à entonner
ju fte pat les h e x a c o rd e s , & R ou ffe au ne le'
v o y o it pas lu i-m êm e , lo r fq u ’il d i fo i t , art. Solfier S
cc L e s inconvéniens de la méthode de l’Arérindorit
confidérables j car > faute d’a v o ir rendu complète la
gamme de l’o f t a v e , les fy llab e s d e ce;ce gamme ne"
lignifient ni des touches fixes du clav ie r* ni des degrés
du t o n , ni même des intervalles déterminés. P a r les
muances , la fa peut former un intervalle de tiercé
majeure en defcendanc , ou de tierce mineure en
m o n ta n t , ou d’ un fémi-ton encore en montant ^
comme i l eft aifé de v o ir par la gamme , & c . ™
I I I . » L a gamme a auffi été nommée main harmo*
nique y parce q ue G u y emp lo ya d’ab ord la figure
d’une main , fur les do ig ts de laq u e lle il rangea les
notes p ou r m on trer les rapports a ç fes hexacordes
a v e c les cin q térracordes des G re c s . »»
C ’ éto it une in v en tion v éritab lement puérile q ue
cette ap plication des clefs & des notes co r re fp on -
dantes fur chaque jo in tu re des doigts de la main
ha rmonique , o u main de mu fiqu e. ( V o y e z Main
harmonique. ) L e rapport de la gamme au fy ftêm e
grec eft b ien plus fim p lem en t& fenfiblement d émontré
dans la table fui v an te , tirée de M e ib om iu s j Eüclide,
p a g. f i , & d e M e r fe n n e , Harmonie univerfellet
i n - i x , p a g. 1 1 7 ; c a r , retranchant de chaque hexa-*
corde les fyllab e s u t & re , on a fept rétracordes ,•
mi fa fo l la , d on t les cinq premières au g ra v e repré
fentenr ceux du fy ftêm e g r e c , & les deux plus aigus,
ceux que l’A rétin y a v o ir ajoutés , comme on le vo it
dans le tab leau fuivant i
10
p
.17
1 6
*S
14
13
ix
} 1
10
9
8
7
6
S
1
3
Fig, A ,
N e t c h yp erb o leon ,
H yp e rb o leo n diatonos.
T r it e h yp erb o leon .
N e t e fynemmenon.
S ynemmcnon diatonos*
T r i t e Synemmenon.
Mise .
M e fo n d iatonos.
Parh ypate m e fon .
H yp a te m e fon .
H yp a to n diatonos.
Parh ypate hyp aton.
H y p a te hypaton.
P ro fiamb anomeno s.
ton.
ton .
ton .
demi-ton,
ton .
ton ,
demi-ton.
to n .
ton .
ton .
demi-ton.
ton»
ton .
demi-ton.
to n .
ton.
demi-ton.
ton .
ton.
Hypo -pro flambanomeno s.
e e
dd
c e
b b . t f
a a
g
£
e
d
c
b, u
a
G
F
E
D
C
k
A
p
la
fo l
fa
mi
re
UT
la
f o l
f t
mi
re
U?
demi-ton.
ton.
la
f o l
f a
la mi
la f o l re
f o l f “ UT
demif
a mi
ton.
mi re
re - UT
ut
la
la f o l
f o l fafi
mi
mi re
re u r
ÜT
N e t c dieu gmenon.
D ic z c u gm . d ia to n .
T r i t e D ie z eu gm .
to n .
P a ram e fc .
I I I . « P o u r montrer les rapports de fes hexacordes
#vcc les cinq térracordes des G r e c s . »»
Pourqu o i G u y fu b ftitu a -t-il fon hcxacorde au té-
stracorde g r e c ? Rou ffeau n en donne aucune raifon.
C e lle s q u ’en apporte le P . M e r fe n n e , Harmonie
umv,erf i lle ) pa ge 1 1 8 , fo n t plus finguiières que fa -
tisfaifantes. «« L e s fix notes dont il s eft fe rv i p ou rr
a ie n t , d i t - i l , repréfentet les fix efpèces de qua r te
qui viennent de la différente fituation du ton m a jeu r ,
du ton mineur & du d emi-ton majeur. » I l n’y a
que trois fy ftêm e s relativ ement à la pofition du té-
tracorde 5 ce lu i des Arifto x éniens , qui fa ifo ien t tous
les ton s -m a jeu r s , c ’e ft-à -d ire , de huit à n e u f 3 celui
des P y th a g o r ic ien s , rétab li p a rP c o lém é e , qu i fo r -
moienc le técracorde d ’un demi ton m a je u r , d 'un
ton majeur & d’un ton mineur j e n f in , ce lu i de D i -
d ym e , qui plaçoic le tôn m ineur au g ra v e d u majeu
r . O n ne peut pas ad opte r à la fo is ces trois
fy f t êm e s , p u ifq u ’ ils fo n t déduits de principes in c o n ciliables
, c ’e f t- à -d ir e , l ’un de la progreffion trip le ,
l ’autre d e la progreffion harmonique , le dernier de
la progreffion arithmé tique. O r , quel que fo it ce lu i
de ces fy ftêm e s q u ’ait fu iv i l ’A r é t in , i l ne pou vo ir
o b ten ir q ue les trois efpèces de quartes fuivantes :ut re
mi fa.y re mi fa f o l, mi fa f o l la ( v o y e z le
P . Merfenne lui-même t page *30 ) ....... « o u les
fix cfpeccs d o f t a v e s , d o n t chacune commence pat
l’une des fix notes fu fd ites . »• L e P . M e r fen n e lu i -
même en comp te fept à la pa ge 1 3 1 ....... O n pour»
roit auffi d ire q ue G u id o a mis fix n o t e s , parce q u e
le fix eft le premier n om b re p a r fa i t , qu i n ’ex cèdé 8c
n’e f t p oint furpa flè de fes p a rt ie s5 ca r 1 3 x , 3 ,
fon t fix j & q u i , étant multiplié à l’in f in i, lai fie toujou
rs 6 pour le dernier c a ra d è r e ^ car il eft nombre
c ir cu la ir e , » L e n om b re 4 eft: bien plus parfait q ue
P p p p i j