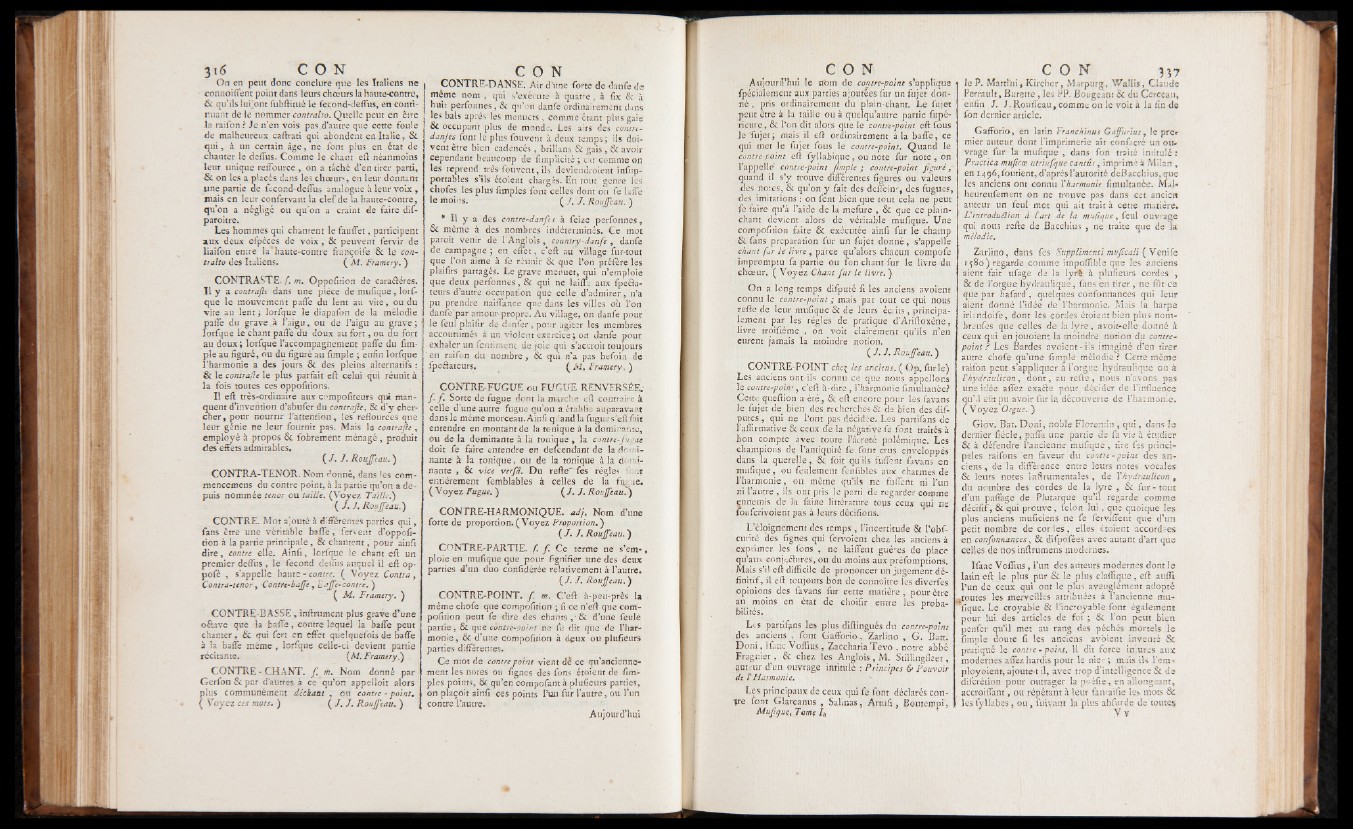
3 i 6 C O N
On en peut donc conclure que les Italiens ne
connoiflent point dans leurs choeurs la haute-contre,
& qu’ils luiront fubftitué le fecond-tleffus, en continuant
de le nommer contralto. Quelle peut en être
la ration ? Je n’en vois pas d’autre que cette foule
de malheureux caftrati qui abondent en Italie » &
q u i, à un certain âge, ne font plus en état de
chanter le deffus. Comme le chant eft néanmoins
leur unique reiTource , on a tâché d’en tirer parti,
& on les a placés dans les choeurs, en leur donnant
une partie de fecond-deiTus analogue à leur voix ,
mais en leur confervant la cle f de la haute-contre,
qu’on a négligé ou qu’on a craint de faire dif-
paroître.
Les hommes qui chantent le fauffet, participent
aux deux efpèces de v o ix , & peuvent fervir de
liaifon entre la haute-contre françoife & le contralto
des Italiens. ( M. Framery. )
CONTRASTE, f. m. Oppofirion de cara&ères.
I l y a contrajh: dans une pièce de mufique, lorf-
que le mouvement pafle du lent au vite, ou du
vite au lent ; lorfque le diapafon de la mélodie
pafle du grave à l ’aigu, ou de l’aigu au grave;
lorfque le chant pafle du doux au fo r t, ou du fort
au doux ; lorfque l’accompagnement pafle du Ample
au figuré, ou du figuré au fimple ; enfin lorfque
l ’harmonie a des jours & des pleins alternatifs :
& le contrafle le plus parfait efl celui qui réunit à
la fois toutes ces oppofitions.
Il eft très-ordinaire aux compofiteurs qui manquent
d’invention d’abufer du contrafle, & d’y chercher
, pour nourrir l’attention, les reflources que
leur génie ne leur fournit pas. Mais le contrafle,
employé à propos & fobrement ménagé, produit
des effets admirables,
( J. J. Roujfeau. )
CONTRA-TENOR. Nom donné, dans les com-
mencemens du contre point, à la partie qu’on a depuis
nommée ténor ou taille. (Voyez Taille.)
( /. J. Roujfeau.)
CONTRE. Mot ajouté à différentes parties qui,
fans être une véritable baffe, fervent d’oppofi-
tion à la partie principale , & chantent, pour ainfi
dire, contre elle. Ainfi, lorfque le chant eft un
premier deflus , le fécond deffus auquel il eft op-
pofé , s’appelle haute - contre. ( Voyez Contra,
Contra-tenor, Contre-baffe , Eajfe-contre. )
( M. Framery. )
CONTRE-BASSE, infiniment plus grave d’ une
oéfove que la baffe, contre lequel la baffe peut
chanter, & qui fert en effet quelquefois de baffe
à la baffe même , lorfque celle-ci devient partie
récitante. (AL Framery.)
CON TRE - CHANT, f . m. Nom donné par
Gerfon & par d’autres à ce qu’on appelloit alors
plus communément déckaat , ou contre - point.
( Voyez ces mots. ) ( J . J. Roujfeau. )
C O N
CONTRE-DANSE. Air d’une forte de danfe de
même nom , qui s’exécute à quatre, à fix & à
huit perfonlies, & qu’on danfe ordinairement dans
les bals après les menuets , comme étant plus gaie
6l occupant plus de monde. Les airs des contre-
danjes font le plus fouvent à deux temps; ils doivent
être bien cadencés, brillans & gais , & avoir
cependant beaucoup de {implicite ; car comme on
les reprend très-fouvent, ils deviendroient infup-
portables s’ils étoient chargés. En tout genre les
chofes les plus Amples font celles dont on fe laffe
le moins. ( ƒ. J. Roujfeau. )
* Il y a des contre-danfes à feize perfonnes,
& même à des nombres indéterminés. Ce mot
paroît venir de 1 Anglois , country-danfe , danfe
l de campagne ; en eftet, c’eft au village fur-tout
que l ’on aime à fe réunir & que l’on préfère les
plaifirs partagés. Le grave menuet, qui n’emploie
que deux perfonnes, & qui ne laiffe aux fpeéla-
teurs d’autre occupation que celle d’admirer, n’a
pu prendre naiffance que dans les villes où l’on
danfe par amour-propre. Au village, on danfe pour
le feul plaifir de danfer, pour agiter les membres
accoutumés à un violent exercice; on danfe pour
exhaler un fentiment de joie qui s’accroît toujours
' en raifon du nombre, & qui n’a pas befoin de
fpectateurs. (A i, Framery, )
CONTRE-FUGUE ou FUGUE RENVERSÉE.
ƒ. ƒ. Sorte de fugue dont la marche eft contraire à
celle d une autre fugue qu’on a établie auparavant
dans le même morceau. Ainfi qi'and la fugue s’eft fait
entendre en montant de la tonique à la dominante,
ou de la dominante à la tonique, la contre-fugue
doit fe faire entendre en defeendant de la dominante
à la tonique, ou de la tonique à la dominante
, & vice verfâ. Du refte~ fes règles font
entièrement femblables à celles de la fugue.
( Voyez Fugue. ) ( J. J. Roujfeau. )
CONTRE-HARMONIQUE, adj. Nom d’une
forte de proportion.(Voyez Proportion.)
( J. J. Roujfeau. )
CONTRE-PARTIE, f. f . Ce terme ne s’em-,
ploie en mufique que pour fignifier une des deux
parties d’un duo confidérée relativement à l’autre.
( J. J. RouJJeau. )
CONTRE-POINT, f . m. C ’eft à-peu-près la
même chofe que compofition ; fi ce n’eft que com-
pofition peut fe dire des chants ,* & d’une feule
partie , & que c'ontre-ooint ne fe dit qiie de l’harmonie,
& d’une compofition à deux ou plufieurs
parties différentes.
Ce mot de contre point vient dé ce qu’ancienne-
ment les nores ou lignes des fons étoient de Amples
points, & qu’en compofantà plufieurs parties,
on plaçoit ainfi ces points l’un fur l’autre, ou l’un
contre l’autre.
Aujourd’hui
C O N
Aujourd’hui le nom de contre-point s’applique
fpécialement aux parties ajoutées fur un fujet donné
, pris ordinairement du plain-chant. Le fujet
peut être à la taille ou à quelqu’aurre partie fupé-
rieure, & l’on dit alors que le contre-point eft fous
le “fujet; mais il eft ordinairement à la baffe, ce
qui met le fujet fous le contre-point. Quand le
contre point eft fyllabique, ou note fur note , on
l’appelle* contre-point fimple; contre-point figuré,
quand il s’y trouve différentes figures ou valeurs
des notes, & qu’on y fait des defi'einr, des fugues,
des imitations : on fent bien que tout cela ne peut
fe faire qu’à l’aide de la mefure , & que ce plain-
chant devient alors de véritable mufique. Une
compofition faite & exécutée ainfi fur le champ
& fans préparation fur un fujet donné, s’appelle
chant fur le livre , parce qu’alors chacun compofe
impromptu fa partie ou ion chant fur le livre du
choeur. ( Voyez Chant fur le livre. )
On a long temps difputé fi les anciens avoient
connu le contre-point ; mais par tout ce qui nous
refte de leur mufique & de leurs écrits , principalement
par les règles de pratique d’Ariftoxène,
livre troisième , on voit clairement qu’ils n’en
curent jamais la moindre notion.
( A J . Roujfeau.)
CONTRE-POINT chc{ les anciens. ( Op. furie) j
Les anciens ont-ils connu ce que nous appelions !
le contre-point, c’eft à-dire, l’harmonie fimultanée?
Cette queftion a été, & eft encore pour les favans
le fujet de bien des recherches & de bien des disputes
, qui ne l ’ont pas décidée. Les partifans de
l ’affirmative & ceux de la négative fe font traités à
bon compte avec toute l’âcreté p'olémique. Les
champions de l’antiquité fe font crus enveloppés
dans la querelle, & foit quïls fuflent favans en
mufique, ou feulement fenfibles aux charmes de
l ’harmonie, ou même qu’ils ne fuffeht ni l’un
ni l’autre , ils ont pris le parti de regarder comme
ennemis de la faine littérature tous ceux qyi ne
fouferiyoient pas à leurs décifions.
L’éloignement des temps , l’incertitude & l’obf-
curité des Agnes qui fervoient çhez les anciens à
. exprimer les fons , ne laiffent guêpes de place
qu’aux conjtéhires, ou du moins aux préemptions.
Mais s’il eft difficile de prononcer un jugement définitif,
il eft toujours bon de connoître les diverfes
opinions des favans fur cette matière , pour être
au moins en état de choifir entre les probabilités.
’
Les partifjins les plus diftingués du contre-point
des anciens font Gafforio-, Zarlino , G. Batt.
D o n i, Ifaac Voftius , Zaccharia T evo , notre abbé
Fraguier , & chez les Anglois, M. Stillingfleet,
£Ut-.ur d’un ouvrage intitulé : Principes & Pouvoir
de P Harmonie.
Les principaux de ceux qui fe font déclarés contre
font Glareanus , Sahnas, 4 »“tufi, Bonteippi,
Mufique, Tomç I»
C O N 337
le P. Martini, Kircher, Marpurg, Wallis, Claude
Perrault, Burette, les PP. Bougeant & du Cerceau,
enfin J. J. Rouflèau, comme on le voit à la fin de
fonde rnier article.
Gafforio, en latin Franchinus Gaffurius, le pre<-
mier auteur dont l'imprimerie ait confacré un on*
vrage fur la mufique , dans fon traité intitulé :
Practica muficot utriufque cantûi, imprimé à Milan ,
en 1496, foutient, d’après l’autorité deBacchius, que
les anciens ont connu l’harmonie fimultanée. Mal-
heureufement on ne trouve pas dans cet ancien
auteur un feul mot qui ait trait à cette matière-,
L'introduction à l'art de la mufique, feul ouvrage
qui nous refte de Bacchius , ne traite que de la
mélodie.
Zarlino, dans fes Suppriment! mvficali ( Venife
1580) regarde comme impoflible que les anciens
aient fait ufage de la lyrê à plufieurs cordes ,
& de l’orgue hydraulique, fans en tirer , ne fût-ce
que par hafard , quelques conformances qui leur
aient donné l ’idée de l’harmonie. Mais la harpe
irl.mdoife, dont les cordes étoient bien plus nom-
breufes que celles de la ly r e , avoit-elle donné à
ceux qui en jouoient la moindre notion du contrepoint?
Les Bardes avoient-ils imaginé d’en tirer
autre chofe qu’une fimple mélodie ? Cette même
raifon peut s’appliquer à l’orgue hydraulique ou à
Vhydraulicon , dont, au refte , nous n’avons pas
une idée affez exafte pour décider de l’influence
qu’ .l eût pu avoir fur la découverte de l’harmonie.
( V oyez Orgue. )
Giov. Bat. Doni, noble Florentin , q u i, dans le
dernier fiècle, paffa une partie de fa vie à étudier
& à défendre l ’ancienne nuifiqué , tire fes principales
raifons *en faveur du contre - point des anciens
, de la différence entre leurs notes vocales
& leurs notes inftrumentales , de Y hydraulicon 9
du nombre des cordes de là lyre , & fur-tout
d’un paffage de Plutarque qu’il regarde comme
décifif, & qui prouve, lelon lu i , que quoique les
plus anciens muficiens ne fe ferviffent que d’un
petit nombre de cordes, elles étoient accordées
ep confonnances, & difpofées avec autant d’art que
celles de nos inftrumens modernes.
Ifaac Voftius, l’un des auteurs modernes dont le
latin eft le plus pur & le plus claflique, eft aufli
l’un de ceux qui ont le plus aveuglément adopté
•toutes les merveilles attribuées à l’ancienne mufique.
Le croyable & l ’incroyable font également
pour lui des articles de foi ; & l’on peut bien
penfer qu’il met au rang des péchés mortels le
fimple doute fi les anciens avoient inventé &
pratiqué le contre - point. 11 dit force injures aux
modernes affez hardis pour le nier ; mais ils l’em-
ployoient, ajoute-t il, avec trop d'intelligence & de
difetétion pour outrager la p'eêfie, en allongeant,
accroiffant, ou répétant à leur faïuaifie les mots &
les fyllabes, o u , Rayant la plus abfurde de toutes