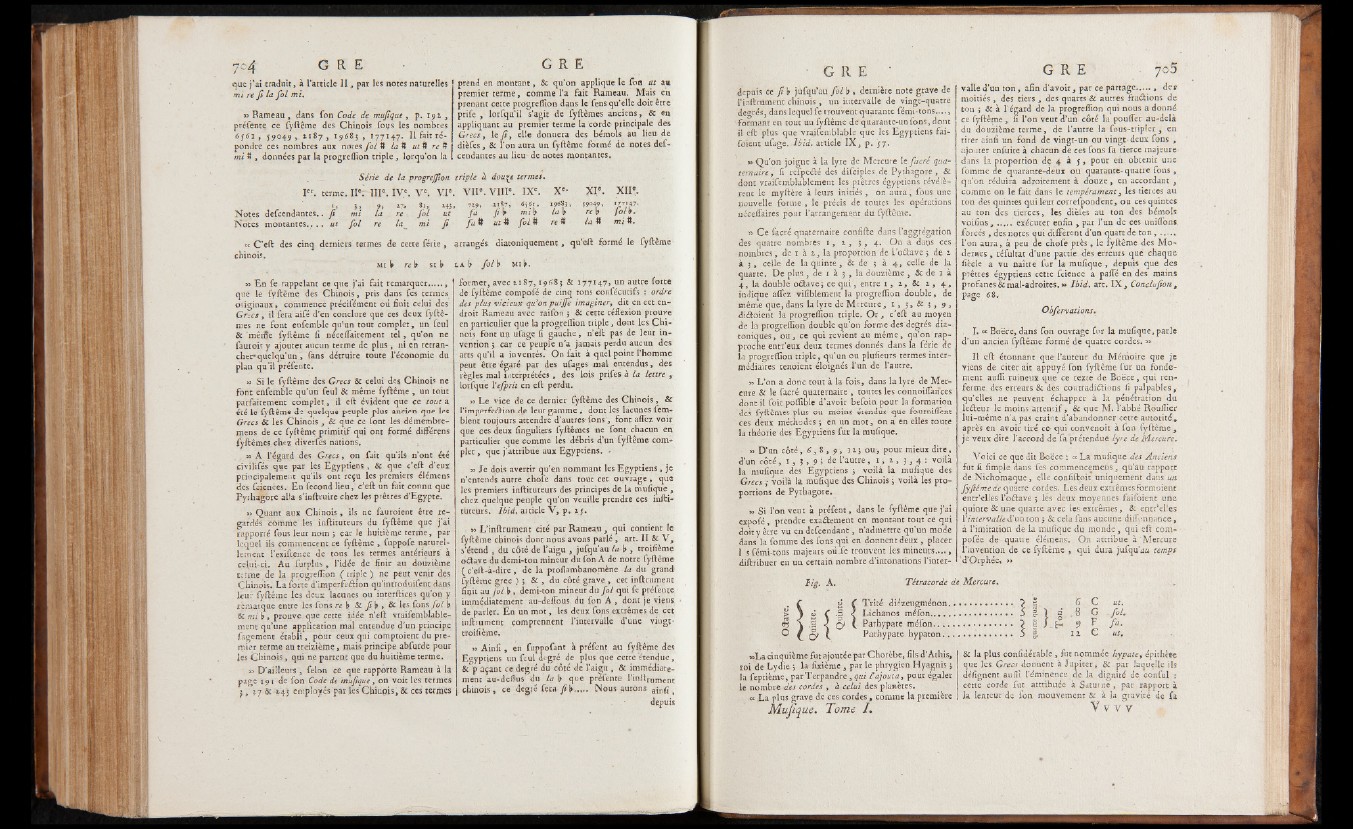
que j*ai traduit, à l'article I I , par les notes naturelles
mi re f i la fo l mi.
» Bameau , dans fon Code de mufique , p. 191 ,
préfente ce fyftême des Chinois fous les nombres
6561 , 59049 , 1 1 8 7 , 19683, 177147. Il fait répondre
ces nombres aux notes fo l # la # ut # re #
mi # , données par la progreflion triple, lorqu’on la
prend en montant, & qu'on applique le fon ut au
premier terme, comme Ht fait Rameau. Mais en
prenant cette progreflion dans le fens qu’elle doit être
prife , lorfqu'il s’agit de fyftêmes anciens, & en
appliquant au premier terme la corde principale des
Grecs, lé elle donnera des bémols au lieu de
dièfes , & l’on aura un fyftême formé de notes descendantes
au lieu de notes montantes.
Série de la progrejjion triple à dou^e termes.
Notes defcendantes.. fi
Notes m o n tan te s .... iit fo l
I IIe. I V e,, V e, V I e. V I I e. V I I I e. IX e. X e- X I e. X I I e.
0 ZJt Si. X43, 7X9 » ■Z 187 > 6561, I96S3, J9°4 9» B a fcS
la re . fo l ut f a fik mi b la |> re)> folb.
re la^ mi f i f a * ut f o l * re # la * mi tt.
ec C ’eft des cinq derniers termes de cette férié ,
chinois.
mi If re I* si !>
arrangés diatoniquement, qu’eft formé le fyftême
la fo l 1» Mik
m En fe rappelant ce que j’ai fait remarquer.....,
que le fyftême des Chinois, pris dans fes termes
originaux, commence précifément où finit celui des
Grtcs , il fera aifé d’en conclure que ces deux fyftêmes
ne font enfemble qu’un tout complet, un feul
& 'mêifle fyftême fi néceflairement te l, qu’on ne
fauroit y ajouter aucun terme de plus , ni en retrancher
quelqu’un, fans détruire toute l’économie du
plan qu’il préfente.
>3 Si le fyftême des Grecs & celui des Chinois ne
font enfemble qu’un feul & même fyftême , un tout
parfaitement complet,, il eft évident que ce tout a
été le fyftême de quelque peuple plus ancien que les
Grecs & les C h in o i s & que ce (ont les démembre^-
mens de ce fyftême primitif qui ont formé différçns
fyftêmes chez diyerfes nations.
» A l’égard des Grecs, on fait qu’ils n’ont été
civilifés que par jes Egyptiens , & que c’eft d'eux1
principalement qu’ils ont reçu les premiers élémens
des fcicnces. En fécond lieu, c’ eft un fait connu que
Pythagore alla s’iuftruire chez les prêtres d’Egypte.
»3 Quant aux Chinois, ils ne fauroient être regardés
comme les inftituteurs du fyftême que j’ai
rapporté fous leur nom ; car le huitième terme, par
lequel ils commencent ce fyftême , fuppofe naturellement
l’exiftence de tous les termes antérieurs à
celui-ci. Au furplus , l’idée de finir au douzième
tcrme.de la progreflion (triple) ne peut venir des
Chinois. La forte dimperfection qu’introduifent dans
leur fyftême les deux lacunes ou interfticçs qu’on y
remarque entre les fons re 1? & f i l>, & les fons fo l b
& mi b, prouve que cette idée n’eft vraisemblablement
qu’une application mal entendue d’un principe
fagement établi, pour ceux qui comptoient du premier
terme au treizième, mais principe abfurde pour
les Chinois, qui ne partent que du huitième terme.
33 D’ailleurs j félon ce que rapporte Rameau à la
page 191 de fon Code de mufique, on voit les termes
2, 3.7 & ^43 employés par lés Chinois, & ces termes
former, avec 1187,19683 & 177147, un autre forte
de fyftême compofé de cinq tons confécutifs : ordre
des plus vicieux quonpuijfe imaginer, dit en cet .endroit
Rameau avec raifort ; & cette réflexion prouve
en particulier que la progreflion triple, dont les Chinois
font un ufage fi gauche, n’eft pas de leur invention
y car ce peuple n’a jamais perdu aucun des
arcs qu’il a inventés. On fait à quel point l’homme
peut être égaré par des ufages mal entendus, des
règles mal interprétées , des lois prifes a la lettre ,
lorfque Yefprit en eft perdu.
33 Le vice de ce dernier fyftême des Chinois, &
l’imperfeéHon de leur gamme j dont les lacunes fem-
blent toujours attendre d’autres-fons', font allez voir
que ces deux finguliers fyftêmes ne font chacun en
particulier que comme les débris d’un fyftême complet
, que j’attribue aux Egyptiens. -
»3 Je dois avertir qu’en nommant les Egyptiens, je
n’entends autre chofe dans tout cet ouvrage , que
les premiers inftituteurs des principes de la mufique ,
chez quelque peuple qu’on veuille prendre ces infti-
tüteùrs, Ibid, article V , p, i j .
» L’inftrument cité par Rameau , qui contient le
fyftême chinois dont npus avons parlé, art. II & V ,
s’étend , du côté de l’aigu , jufqu’au la l>, troifièmç
o&avç du demi-ton mineur du fon A de notre fyftême
( c’eft-à-dire, de la proflambano.mène la du grand
fyftême grec ) j & , du côté grave , cet inftrument
figit ay foi b, demi-ton mineur du fo l qui fe préfençc
immédiatement au-deflous, du fon A , dont je viens
de parler. En un mot, les deux fons extrêmes de cet
inftrument comprennent l’intervalle d’une vingç-
troifième.
33 Ainfi , en fuppofant à préfent au fyftême des
Egyptiens un feul degré de plus que cette étendue,
& p açant ce degré du côté de l’a ig ii, & immédiatement
au-deftus du la b que prefente rinftrumene
| chinois, ce degré fêta f i \ ..... Nous aurons ainfi ,
depuis
depuis ce f i b jüfqu*au fo l )> , dernière note grave de
i’ inftrument chinois , un intervalle de vingt-quatre
degrés, dans lequel fe trouvent quarante fémi-tons....,
formant en tout un fyftême de quarante-unfons, dont
il eft plus que vraifemblable que les Egyptiens fai-
foient ufage. -Ibid, article IX , p. 57.
>3 Qu’on joigne à la lyre de Mercure 1t facré quaternaire
, fi refpfccté des difciples de Pythagore , &
dont vraifemblabiement les prêtres égyptiens révélèrent
le myftère à leurs initiés , on aura, fous une
nouvelle forme, le précis de toutes les opérations
uéceflairès pour l'arrangement du fyftême.
» Ce facré quaternaire confifte dans l’aggrégation
des quatre nombres 1 , 1 , 3, 4. On a dans ces
nombres, de 1 à z , la proportion de l’o&ave $ de 1
à 3, celle de la quinte , & de 3 à 4 , celle de la
quarte. De plus, de 1 à 3 , la douzième , & de 1 à
4 , la double oâavej ce qui, entre 1 , z , & z , 4 ,
indique allez vifiblement la progreflion double, de
même que, dans la lyre de Mercure, 1 , 3, & 3 , 9 ,
didoient la progreflion triple. Or , c’eft au moyen
de la progreflion double qu’on forme dès degrés dia-.
toniques, ou, ce qui revient au même, qu’on rapproche
entr’eux deux termes donnés dans la férié de
la progreflion triple, qu’un ou plufieurs termes intermédiaires
tenoient éloignés l ’un de l’autre.
s» L’on a dotic tout à la fois, dans la lyre de Mercure
& le facré quaternaire , toutes les connoiflances
dont il foie poflîble d’avoir befoin pour la formation
des fyftêmes plus ou moins étendus que fourniflènt
ces deux méthodes j en un mot, on a en elles toute
la théorie des Egyptiens fur la mufique.
33 D’un côté, 6 y 8 ,9 , i z ; ou, pour mieux dire,
d’un côté, 1 , 3 , 9 > àe l’autre, 1 , z , 3 , 4 : voilà
la mufique des Egyptiens ; voilà la mufique des
Grecs ; voilà la mufique des Chinois ; voilà les proportions
de Pythagore.
»3 Si l’on veut à préfent, dans le fyftême que j’ai
expofé, prendre exactement en montant tout ce qui
doit y être vu en defeendant, n’admettre qu’un mode
dans la Comme des fons qui en donnent deux , placer
1 s fémi-tons majeurs où Je trouvent les mineurs....,
diftribuer en un certain nombre d’intonations l'intérim
A .
valle d’un ton, afin d’avoir , par ce partage........ dex
moitiés , des tiers , des quarts & autres fractions de
ton j & à l'égard de la progreflion qui nous a donné
ce fyftême, u l’on veut d’un côté la pouffer au-delà
du douzième terme, de l’autre la fous-tripier , en
tirer ainfi un fond de vingt-un ou vingt-deux fons ,
ajouter enfuite à chacun de ces fons fa tierce majeure-
dans la proportion de 4 à y , pour en obtenir une
Comme de quarante-deux ou quarante-quatre fons,
qu’on réduira adroitement à douze, en accordant ,
comme on le fait dans le tempérament, les tierces au
ton des quintes qui leur correfpondent, ou ces quintes
au ton des tierces, les dièLes au ton des bémols
voifîns......... exécuter enfin , par l’un de ces unifions.
forcés , des notes qui diffèrent d’un quart de ton, ......
l’on aura, à peu de chofe près, le fyftême des Modernes
, réfultat d’une partie des erreurs que chaque
fiècle a vu naître fur la mufique, depuis que des
prêtres égyptiens cette fcience a paffé en des mains
profanes & mal-adroites.» Ibid. art. IX , Conclufion t
page 68.
Obfervations.
I. « Boëce, dans fon ouvrage fur la mufique, parle
d’un ancien fyftême formé de quatre cordes. »
Il eft étonnant que l’auteur du Mémoire que je
viens de citer ait appuyé fon fyftême lur un fondement
auflï ruineux que ce texte de Boëce, qui renferme.
des erreurs & des contradictions fi palpables,
qu’elles ne peuvent échapper à la pénétration du
leéteur le moins attentif, & que M . l’abbé Rouiller
lui-même n’a pas craint d’abandonner cetre autorité,,
après en avoir tiré ce- qui convenoit a fon fyftême ,
je veux dire l ’accord de fa prétendue lyre de Mercure.
Voici ce que dit Boëce : « La mufique des Anciens
fut fi fimple dans fes cômmencemcns, qu’au rapport
de Nichomaque, elle confiftoit uniquement dans un
fyfiêmede quatre cordes, Les deux extrêmes formoient
entr’-elles l’oCtave 5 les deux moyennes faifoient une
quinte & une quarte avec les extrêmes, & entr’elîes
l’intervalle d’un ton ; & cela fans aucune diif.mnance ,
à l’imitation de la mufique du monde , qui eft com-
pofée de-quatre élémens. On attribue à Mercure
l ’invention de ce fyftême , qui dura j ufqu au temps
'd’Orphée, >3
Tétracorde de Mercure.
si 1f Trité diczeugménon................ ......... l . l s c ut.
>■ 1 -1 < ! 'eü| .M G -fol.
- 1 a 1( Parhypâte méfon..................... i l ? F fa .
G (l o> 1[ Parhypate hypaton.................. IL C u t .
»La cinquième fur ajoutée par Chorèbe, fils d’AthiSj,
roi de Lydie 3 la fixième, par le phrygien Hyagnis j
la feptième, parTerpandre, qui l'ajouta, pour égaler
le nombre des cordes , à celui des planètes.
« L a plus grave de ces cordes, comme la première
Mufique. Tome J.
& la plus confidérable, fut nommée hypatey épithète
que les Grecs donnent à Jupiter, de par laquelle ils
défignent auflï l’éminence de la dignité de. conful :
cette corde fut attribuée à Saturne , par rapport à
la lenteur de fon mouvement & à la gravité de fa
V v v v