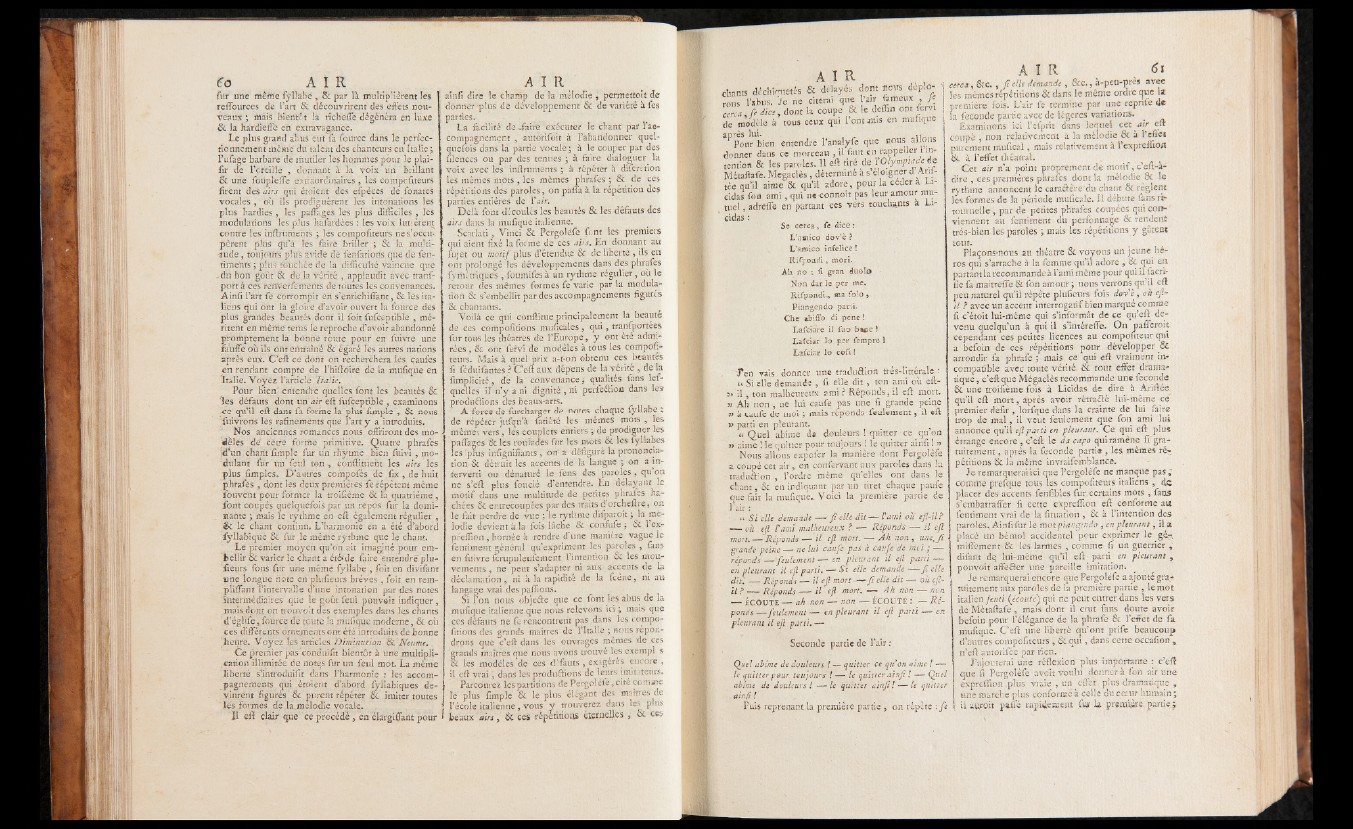
<fo AIR
fur une même fyllàbè , & par là multiplièrent les
refïbürces de l’art & découvrirent des effets nouveaux
; mais Bientôt là richeffe dégénéra en luxe
& la hàrdieffé en extravagance.
Le plus grand abus eut fà fource dans le perfec-
donnemenf même dti talent des chanteurs en Italiej
Pufagë barbare de mutiler les hommes pour le plai-
fir de l’creille , donnant à la voix un brillant
& une fotipleffe extraordinaires , les cômpcfiteurs
firent des airs qui étoient des efpèces de fonates
vocales ., ' où ils prodiguèrent les intonations les
plus hardies, les pafiages les pîqs difficiles , les
modulations les plus hafardées : les voix limèrent
contre les inftrüments ; lés compofiteurs ne s’occupèrent
plus qu’à les faire briller ; & la multitude
, toujours plus avide de fenfariorîs que de fen-
timents ; plus touchée de la difficulté vaincue que
-du bon go'ùt & de la vérité , applaudit avec tranf-
port à ces renverfémerits de toutes les convenances.
Ainfi l’art fe corrompit en s’enrichiffanr, & les italiens
qui ont la gloire d’avoir ouvert la fource des
plus grandes beautés dont i f foit fufceptible , méritent
en même tems le reproche d’avoir abandonné
promptement la bonne route pouf en fuivre une
rauffe où ils ont entraîné 8c égaré Tes autres nations
après eux. C ’eft ce dont on rechërèhera les. çaufes
en rendant compte de l ’hiftoire de la mufique en
Italie. Voyëz l’article Italie.
Pour bien'entendre quelles font les beautés &
le s defauts dont un air eft fufceptible , examinons
-ce qu’il eft dans fa forme la plus fimple & nous
Cuivrons les rafinements que l’art y a introduits.
Nos anciennes romances nous offriront des modèles
dé cétfe forme primitive. Quatre phrafes
id’un ; chàrit fimple fur un rhÿtme , bien fuivi , modulant
fu r un feul ton , conftitueht les airs les
plus fimples. D ’aatres compofés de fix , de huit
phrafès , dont les deux premières -fe répètent même
fbuvënt pour former la troifième & là quatrième ,
font coupés quelquefois par un repos fur la domi-
. liante ; mais le rythme en eft également régulier ,
êc le chant continu. L’harmonie en a été d’âbord
iyllabiquè &- fur le même rythme que le chant.
Le premier moyen qu’on ait imaginé pour embellir
oc varier le chant a été*de faire entendre plusieurs
fons fur une même fyllabe , foit en divifant
une longue note en plufieurs brèves , foit en rem-
pliffant l’intervalle d’une intonation par des notes
intermédiaires que le goût feul pouvait indiquer,
mais.dont on trouvoit des exemples dans les chants
d’églife, fource de toute la .mufique moderne, & où
ces differents ornements ont été introduits de bonne
heure. Vo yez les articles Diminution '8c.'Neume. .
Cè premier pas eonduifit bientôt à une multipli-
, cation illimitée denotqs fur un feul mot. La même
liberté s’introduifit dans l ’harmonie : les accompagnements
qui étoient d’abord fyllabiques devinrent
figurés & purent répéter & imiter toutes
les formes de .la ,mélodie vocale.
I l eft clair que ce procédé, en élargiftant pour
A I R
ainfi dire le champ de la mélodie , permettoit de
donner-'plus de développement & de variété à fes
parties.
La facilité de-faire exécuter le chant' par l’ae-
compagnement , autorifoit à l’abandonner quelquefois
dans là partie vocale ; à le couper par des
filences ou par des tenues ; à faire dialoguer la
voix avec les inftrurnents ; à répéter à' difcrëtion
les mêmes mots, les mêmes phrafes ; & de ces
répétitions des paroles, on pàfîa à la répétition des
parties" entières de Y air.
Delà font découlés les beautés & les défauts des
airs dans la mufique italienne.
Scarlati, Vinci & Pergolèfë font les premiers
qui aient fixé la forme de ces ait s. En donnant au
fujet ou motif plus d’étendue & de liberté , ils en
ont prolongé les développements dans des phrafes
fymétriques , foumifesà un rythme régulier, où le
retour des mêmes formes fe varie par la modulation
& s’embellit par des accompagnements figuré s
& chantants. . ~
Voilà ce qui conftitue principalement la beauté
de ces compofitions nuificàles , q u i, transportées
fur tous les théâtres de l’Europe, y ont été admirées
, & ont fervi de modèles à tous les compofiteurs.
Mais à quel prix a-t-on obtenu ces beautés
fi féduifantes ? C ’eft aux dépens de la vérité , de la
fimplicite, de l'a convenance j qualités fans lef-
quelles i l n’y a ni dignité , ni perfection dans les
productions des beaux-arts.
A force de fiircharger de notes chaque fyllabe ;
de répéter jnfqu’à fiitiété les mêmes mots , les
mêmes vers , les couplets entiers j de prodiguer les
paffages & les roulades fur les mots &. lés lyilabes
les plus infignifiànts , on a défiguré la prononciation,/
& détruit les accents de la langue ; on a interverti
ou dénaturé le fens des paroles , qu on
ne s’eft plus foucié d’entendre. En délayant le
motif dans une multitude de petites phrafes hachées
& entrecoupées par des traits d’orcheftre, on
le fait perdre de vue ; le rythme dtiparoît ; la mélodie
devient à la fois lâche & confufe ; & l’ex-
pfeflion, bornée à rendre d’une manière vague le
fentiment général qu’expriment les paroles , fans
en fuivre forupuleufement l’intention 8c les mouvements
, ne peut s’adapter ni aux accents de la
déclamation, ni à la rapidité de la fcène, ni au-
langage vrai des paffions.
Si l ’on nous cbje&e que ce font les abus de la
mufique italienne que nous relevons ici ; mais que
. ces défauts ne fe rencontrent pas dans les compofitions
des grands maîtres de l’Italie ; hous répondrons
que c’eft dans les ouvrages mêmes de ces
grands maîtres que nous avons trouvé les exempl s
& les modèles de ces défauts , exagérés encore ,
il eft v ra i, dans les productions de leurs imitateurs.
Parcourez les partitions de Pergolefe, cité comme
le plus fimple & lé plus élégant des martres de
l’école italienne, vous y trouverez dans les plus
beaux airs, & ces répétitions çtçrnelles } & ces
A I R
chaiiB dichimietés & -délayés dont nous déplo-
rons l’xbus. Ve ne citerai que ’air fameux , f i
cerca f i d ia , dont la coupe & le deffin ont fervi
de modèle à tous ceux qui l’ont auis en mufique
après lui. <<
Pour bien entendre l’analyfe que bous allons
donner dans ce morceau , il faut èn rappeîler I intention
& les paroles. Il eft tiré de YOlympiaae de
Métaftafe. Mcgaclès , déterminé a s’éloigner d Anl-
tée qu’il aime & qu’il adore, pour la céder a Li-
cidas fon ami, qui ne connoît pas leur amour mutu
e l, adreffe en partant ccs vers touchants a Li-
cidas :
Se cetca , fe dice :
L ’amico dov’è ?
L ’amico infelice I
Rifpoadi, morL
Ah no : fi grau duolô •
N o n dar le per me.
R i f p o n d k , ma foîo >
Piangendo parii.
Che abiffo di pene !
Lafciâre il fùo b%pe ?
Lafciar lu per fempre.î
Lafciar lo cofi !
J’en vais donner une traduôion ti'ès-littérale :
cc Si elle demande , fi elle d i t , ton ami où eft-
59 i l , ton malheureux ami ? Réponds, il eft mort.
» Ah non , ne lui caufe pas une fi grande peine
à caufe de moi ; mais réponds feulement, il eft
3> parti en pleurant.
« Q u e l abîme d i douleurs ! quitter ce qu’on
j> aime ! le cuitter pour toujours ! le quitter ainfi ! »
Nous allons expofer la manière dont Pergolèfe
a coupé cet air , en confervant aux paroles dans la
- traduâion , l’ordre même qu’elles ont dans le
chant, & en indiquant par un tiret chaque paufe
que fait la mufique.. Voici la première partie de
l’air :
• ■ Si elle demande — f i elle dit— Vami'oit efi-il?
•— ou efi Vami malheureux ? -— Rép o n d s — i l efl
mort. — Réponds — il efi mort. — A h 'n o n , u n e ,J i ■
grande p ein e — ne lu i caufe p a s à ca u fe de moi ; —
rép o n d s— fe u lem e n t— en p leu ra n t il efl p a r ti —
en pleurant il efl p a r ti. — S i elle demande — y? elle •
d it. — Réponds — il efl mort —* f i elle d it — ou efi-
i l ? ■— Réponds — i l efl mort. — d h non — non
— ÉCOUTE — ah non —' non — ÉCOUTE : — R é ponds
— feu lem en t — en p leu ra n t i l efl p a r ti ■— en
pleurant il efl p a rti. —
Seconde partie de l’air :
Quel abîme de douleurs ! — quitter ce quon aime ! —
le quitter pour, toujours ! — le quitter ainfi ! — Quel
abîme de douleurs l — le quitter ainfi ! — le quitter
a in f i! ‘
Puis reprenant la première partie , on répète : fe
A I R
etrea, 8cc. , fi elle demande , & c . , à -p e u -p r e s avee
le s m êm e s rép é titio n s & d a n s l e m êm e o rd r e q u e la
p r em iè r e fo is . L ’air fe te rm in e p a r u n e r ep r ife d e
la fé c o n d é pa rtie a v e c d e lé g è r e s v a r ia tion s .
E x am in o n s ic i l ’e fp r it dans le q u e l cet air ea
c o u p é , n o n re la t iv em e n t à la m é lo d ie & à l ’ e fte s
p u rem en t m u f i c a l , mais r e la t iv em e n t à l ’ e x p r e f fio fl
& à l ’e f fe t th éâtral.
Cet air n’a point proprement de motif, c’eft-à-
dire , ces premières phrafes dont la mélodie & l e
rythme annoncent le caraCtère'du chant & règlent
les formes de la période muficale. Il débute fans ritournelle
, par de petites phrafes coupées qui conviennent
au fentiment du perfonnage & rendent
très-bien les paroles ; mais les répétitions y gâtent
tout.
; P la ço n s -n o u s a u th é â tre & v o y o n s u n je u n e h é ro
s q u i s’a r ra ch e à la fem m e q u ’i l ad o r e , & q u i e n
p a rtant la r e c om m an d e à l ’am i m êm e p o u r q u i i l facri-
f ie fa m a itre ffe & fo n am o u r ; n o u s v e r ro n s q u ’ i l e ft
p e u na tu re l q u ’ i l rép è te p lu fieu r s fo is dov è, ou efi-
il ? a v e c u n a c c e n t in t e r ro g a t if b ien m a rq u é com m e
fi c ’é to it lu i-m êm e qu i s’ in fo rm â t d e c e q ii’e f t d e v
e n u q u e lq u ’u n à q u i i l s’in té r e ffe . O n p a ffe ro it
c e p en d an t c e s p e tite s lic e n c e s a u c om p o f it e u r qu i
a b e fo in d e c e s r ép é titio n s p o u r d é v e lo p p e r &
ar ron d ir f a p h ra fe ; mais c e q u i e f t v r a im e n t in c
om p a tib le a v e c tou te v é r ité . & to u t e f fe t dramatique,
c ’e f t q u e M é g a c lè s re c om m an d e u n e fé c o n d é
& u n e t ro ifièm e fo is à L ic id a s d e d ire à Ariftéé^
q u ’il e f t m o r t , ap rè s a v o ir rétrq é ié lu i-m êm e c e
p r em ie r d e fir , lo r fq u e dans la c ra in te d e lu i fa ire
tro p d e m a l , i l v e u t fe u lem e n t q u e fo n am i lu i
1 a n n o n c e q u ’i l efl parti en pleurant. C e q u i e f t p lu s
é tran g e e n c o r e , c ’e f t le da capo q u i ram èn e fi g ra tu
item en t , ap rè s la fé c o n d é p a rtie , les, m êm e s rép
é titio n s & la m êm e in v ra ifem b la n c e .
J e r em a rq u e ra i ic i q u e P e r g o lè fe n e m an q u e pa s J
com m e p r e fq u e to u s le s com p o fiteu r s ita lien s , d e
p la c e r de s a c c e n ts fe n fib le s fur. ce rta ins m o ts , fan s
s ’em b a r ra ffe r f i c e tte e x p r e f fio n e f t c o n fo rm e a u
fen tim en t v r a i d e4 a fitu a tion , & à l ’ in ten tio n d e s
pa roles .. A i nfi fu r le m o t piangendo , en pleurant, i l a
p la c é un b ém o l a c c id e n te l p o u r e x p r im e r l e g %
m if fem e n t & le s la rm e s , c om m e fi u n g u e r r ie r ,
d ifan t de. lu i-m êm e q u ’i l e f t parti en pleurant ,
p o u v o i f a f fe d e r u n e p a r e ille imita tion .
Je r em a rq u e ra i e n c o r e q u e P e r g o lè fe a a jo u té g ra tu
item en t a u x p a ro le s d e la p rem iè re p a rt ie , le m o t
ita lien fend ( écoute) qu i n e p eu t en tre r dan s le s v e r s
d e M é ta fta fe , mais d o n t i l c ru t fan s d o u te a v o i r
b e fo in p o u r i’é lé g a n c e d e la p h ra fe 8c l ’ e ffe t d e fa
m u fia u e . C ’eft u n e lib e r té q u ’ o n t p r ife b e a u c o u p
d’au tre s com p o fiteu r s , & q u i , dans c e tte o c c a f io n ,
n ’e ft au to r ifé e p a r rien .
J’a jou te ra i u n e r é f le x io n ' p lu s im p o r tan te : c ’e f t
q u e fi P e r g o lè fe a v o i t v o u lu d o n n e r à fo n air u n e
e x p r e f fio n .p lu s v r a ie , un effet, p lu s d ram a tiq u e ,
u n e m a rch e p lu s c o n fo rm é à c e lle d u cc cu r h um a in ;
i l au ro it p a fié rap id em en t fu r la prem iè re pa rtie j