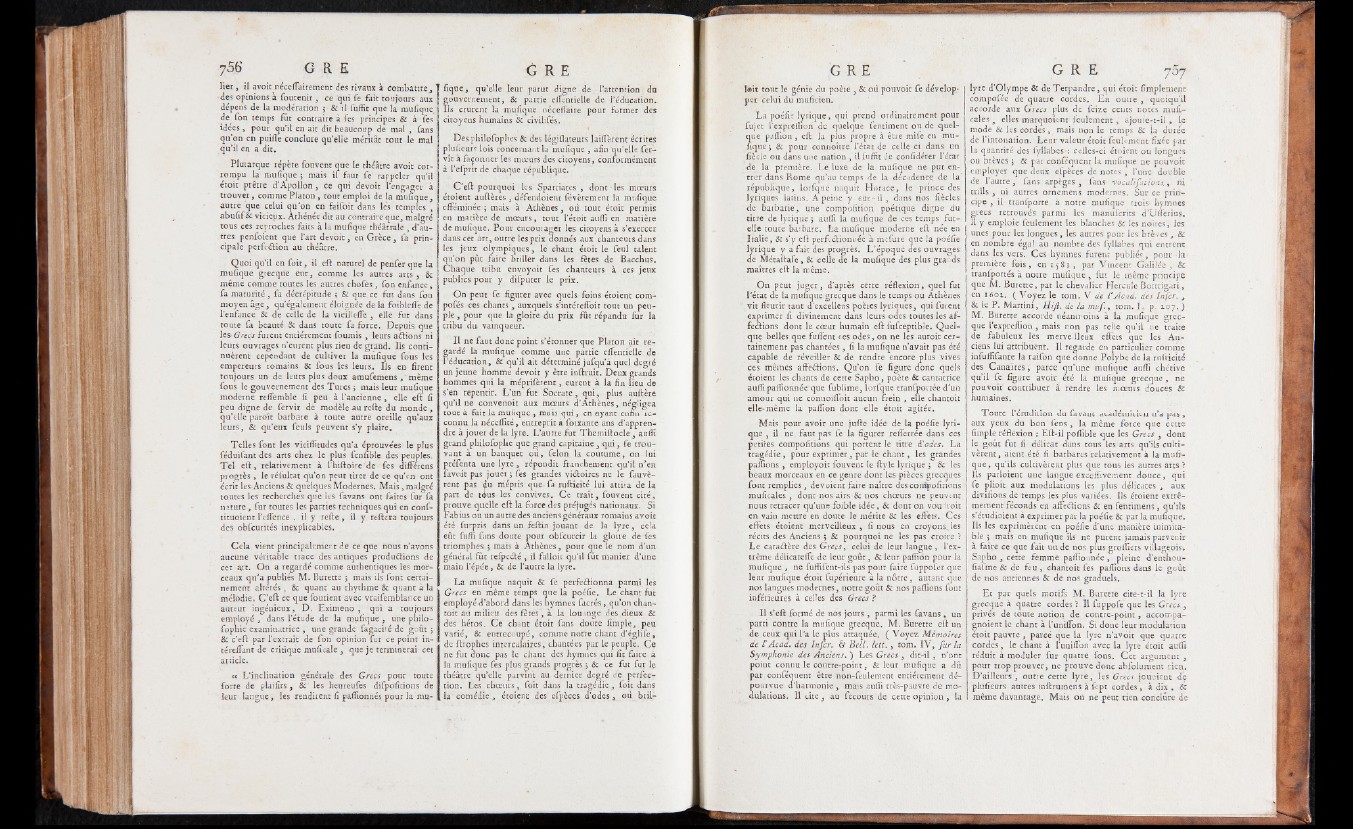
lier, il avoit néceffairement des rivaux à combattre.,
des opinions à foutenir , ce qui fe fait toujours aux
dépens de la modération ; & il fuffit que la mufique/
de fon temps fût contraire à fes principes & à fes
idées, pour qu’il en ait dit beaucoup de mal , fans
qu’on en puifle conclure qu’elle méritât tout le mal
qu’il en a dit.
Plutarque répète fouvent que le théâtre avoit corrompu
la mufique ; mais il faut fe rappeler qu’il
étoit prêtre d’Apollon, ce qui devoit l’engager à
trouver, comme Platon, tout emploi de la mufique,
autre que celui qu’on en faifoit dans lès temples ,
abufif & vicieux. Athénée dit au contraire que* malgré
tous ces reproches faits à la mufique théâtrale , d’autres
penfoient que l’art devoit, en Grèce, la principale
perfection au théâtre.
Quoi qu’il en foit, il eft naturel de penfer que la
mufique grecque eut, comme les autres arts , &
même comme toutes les autres chofes, fon enfance,
fa maturité, fa décrépitude ; & que.ce fut dans fon
moyen âge , qu’également éloignée de la foiblefl'e de
l'enfance & de celle de la vieilleffe , elle fut dans
toute fa beauté & dans toute fa force. Depuis que
les- Grecs furent entièrement fournis , leurs aétions ni
leurs ouvrages n’eurent plus rien de grand. Ils continuèrent
cependant de cultiver la mufique fous les
empereurs romains & fous les leuts. Iis en firent
toujours un de leurs plus doux amufemens ,^même
fous le gouvernement des Turcs ; mais leur mufique
moderne reffemble fi peu à l’ancienne, elle eft fi
peu digne de fervir de modèle au refte du monde,
qu’elle paroît barbare à toute autre oreille qu’aux
leurs, & qu’eux feuls peuvent s’y plaire.
Telles font les viciffitudes qu’a éprouvées le plus
féduifant des arts chez le plus fenfible des peuples.
Tel eft, relativement à l’hiftoire de fes différens
progrès , le réfultat qu’on peut tirer de ce qu’en ont
écrit les Anciens & quelques Modernes. Mais, malgré
toutes les recherches que ies favans ont faites fur fa
nature , fur toutes les parties techniques qui en conf-
tituoient l’cffence , il y refte, il y reliera toujours
des obfcurités inexplicables.
Cela vient principalement de ce que nous n’avons
aucune véritable trace des antiques produétions de
cet art. On a regardé comme authentiques les morceaux
qu’ a publiés M. Burette ; mais ils font certainement
altérés , & quant au rhythme & quant à la
mélodie. C ’eft ce que foutient avec vraifemblance un
auteur ingénieux, D. Eximeno , qui a toujours
employé , dans l’étude de la mufique , une philo—
fopnie examinatrice , une grande fagacité de goût ;
& c’eft par l’extrait de fon opinion fur ce point in-;
téreffant de critique muficale 3 que je terminerai cet
article.
« L’inclination générale des Grecs pour toute
forte de plaifirs, & les heureùfes difpofitions de
leur langue, les rendirent fi paffionoés pour la mufique,
qu’elle leur parut digne de l'attention du
gouvernement, & partie elfcntielle de l’éducation.
Us crurent la mufique néceflaire pour former des
citoyens humains & civilifés.
Des philofophes & des légiflateurs laiflèrent écrites
pluficurs lois concernant la mufique , afin qu’elle fer-
vît à façonner les moeurs des citoyens, conformément
à l’efprit de chaque république.
C ’eft pourquoi les Spartiates , dont les moeurs
étoient auftères , défendoient févèrement la mufique
efféminée ; mais à Athènes , où tout étoit permis
en matière de moeurs, tout l’étoit auffi en matière
de mufique. Pour encourager les citoyens à s’exercer
dans cet art, outre les prix donnés aux chanteurs dans
les jeux olympiques, lé chant étoit le feul talent
qu’on pût faire briller dans les fêtes de Bacchus.
| Chaque tribu envoyoit fes chanteurs à ces jeux
publics pour y difputer le prix.
On peut fe figurer avec quels foins étoient com-
pofés ces chants , auxquels s’intéreffoit tout un peuple
, pour que la gloire du prix fût répandu fur 1a
tribu du vainqueur.
Il ne faut donc point s’étonner que Platon ait regardé
la mufique comme une partie eflentielle.de
l ’éducation, 8c qu’il ait déterminé jufqu’à quel degré
un jeune homme devoit y être inftruit. Deux grands
hommes qui la méprifèrent, eurent à la fin lieu de
s’en repentir. L’un fut Socrate, qui, plus auftère
qu’il ne convenoit aux moeurs d’Athènes, négligea
tout-à-fait la mufique, mais qui, en ayant enfin reconnu
la néccflité, entreprit à foixante ans d’apprendre
à jouer de la lyre. L’autre fut Themiftocle, auffi
grand phiiofophe que grand capitaine , qui, fe trouva
nt à un banquet où, félon la coutume, on lui
préfenta une lyre, répondit franchement qu’il n’en
favoit pas jouer ; fes grandes yiétoires ne le fauvè-
rent pas Ndu mépris que- fa ruftieité lui attira de la
part de tous les convives. Ce trait, fouvent cité,
prouve quelle eft la force des préjugés nationaux. Si
Fabius ou un autre des anciens généraux romains avoit
été furpris dans un feftin jouant de la lyre, cela
eût fuffi fans doute, pour obfcurcir la gloire de fes
triomphes ; mais à Athènes, pour que le nom d’un
général fût refpeété , il falloit qu’il lût manier d’une
main l’épée, & de l’autre la lyre.
La mufique naquit & fe perfeftionna parmi les
Grecs en même temps que la poéfie. Le chant fut
employé d’abord dans les hymnes facrés, qu’on chan-
toit au milieu des fêtes, à la louange des.dieux 8c
des héros. Ce chant étoit fans doute fimple, peu
varié, & entrecoupé, comme notre chant d’églife,
de ftrophes intercalaires, chantées par le peuple. Ce
ne fut donc pas le chant des hymnes qui fit faire à
la mufique fes plus grands progrès ; & ce fut fur lç
théâtre qu’elle parvint au dernier degré de perfection.
Les choeurs, foit dans la tragédie, foit dans
la comédie, étoient des efpèces d’odes, où brilloit
tout le génie du poète , & où pouvoit fe développer
celui du muficien.
La poéfie lyrique, qui prend ordinairement pour
fujet l’exprelhon de quelque fentiment ou de quelque
pafiion , eft la plus propre à être mife en mufique;
& pour connoître l’état de celle ci dans un
fiècie ou dans une nation , il fuffit de confidérer l’état
. de la première. Le luxe de la mufique ne put entrer
dans Rome qu’au temps de la décadence de la
république, lorfque naquit Horace, le prince des
lyriques latins. A peine y eue -il, dans nos fiècles
de barbarie', une compofition poétique digne du
titre de lyrique ; auffi la mufique de ces temps fut-
elle toute barbare. La mufique moderne eft née en
Italie, & s’y eft perfectionnée à mefure que la poéfie
lyrique y a fait des progrès. L’époqué des ouvrages
de Métaftafe, & celle de la mufique des plus grands
maîtres eft la même.
On peut juger, d’après cette réflexion, quel fut
l ’état de la mufique grecque dans le temps ou Athènes
vit fleurir tant d'excelléns poètes lyriques, qui furent
exprimer fi divinement dans leurs odes toutes les affections
dont le coeur humain eft fufeeptibie. Quelque
belles que fuflent ces odes, on ne les auroit certainement
pas chantées , fi la mufique n’avait pas été
capable de réveiller & de rendre encore plus vives
ces mêmes affèétions. Qu’on fe figure donc quels
étoient les chants de cette Sapho, poète & cantatrice
auffi paffionnée'que fublime, lorfque tranfportée d’un
amour qui ne connoifToit aucun frein , elle chantoit
elle-même la paffion dont elle étoit agitée.
Mais pour avoir une jufte idée de la poéfie lyrique
, il ne faut pas fe la figurer refferrée dans ces
petices compofîtions. qui portent le titre d’odes. La
tragédie, pour exprimer, par le chant, les grandes
pâmons , employoit fouvent le ftyle lyrique ; 8c les
beaux morceaux en ce genre dont les pièces grecques
font remplies, dévoient faire naître descon^ofitions
mufîcales , dont nos airs 8c nos choeurs ne peuvent
nous retracer qu’une foible idée, & dont on vouïroit
en vain mettre en doute le mérite & les effets. Ces
effets étoient merveilleux , fi nous en croyons..les
récits des Anciens ; & pourquoi ne les pas croire ?
Le caractère des Grecs, celui de leur langue, l’extrême
déiicateffe de leur goût, & leur paffion pour la
mufique , ne fuffifent-ils pas pour faire fuppofer que
leur mufique étoit fupérieure à la nôtre, autant que
nos langues modernes, notre goût 8c nos pallions font
inférieures à celles des Grecs ?
Il s’eft formé de nos jours , parmi les favans , un
parti contre la mufique grecque. Mi Burette eft un
de ceux qui l'a le plus attaquée. ( Voyez Mémoires
de £Acad, des Infer. & Bell. lett. , tom. IV , fu.r la
Symphonie des Anciens. ) Les Grecs , dit-il, n’ont
point connu le contre-point, & leur mufique a dû
par conféquent être non-feulement entièrement dépourvue
d’harmonie , mais auffi très-pauvre de modulations.
Il cite , au fecours de cette opinion, la
lyre d’Olympe & deTerpandre, qui étoit Amplement
compoféc de quatre cordes. En outre , quoiqu’il
accorde aux Grecs plus de feize cents notes mufi-
cales a elles marquoient feulement, ajoute-t-il , le
mode & les cordes, mais non le temps & la duree
de l’intonation. Leur valeur étoit feulement fixée par
la quantité des fyliabes-: celles-ci étoient ou longues
ou bièves ; & par conféquent la mufique ne pouvoit
employer que deux efpèces de notes , Tune double
de l’autre, fans arpèges, fans •vocalifations., ni ’
tri Ils, ni autres ornemens modernes. Sur ce principe
, il tranfporte à notre mufique trois hymnes
grecs retrouvés parmi les manuferits d’Uflerius.
11 y emploie feulement les blanches & les noires, les
unes pour les longues, les autres pour les brè ve s8 c
en nombre égal au nombre des fyliabes qui entrent
dans les vers. Ces hymnes furent publiés, pour • la •
première fois, en 1 y81 , par Vincent Galilée , &
tranfportés à notre mufique, fur le même principe
que M. Burette, par le chevalier Hercule Bottrigari,
en 16oz. ( Voyez le tom. V de £ Acad, des Infer.
& le P. Martini, Hifi. de la muf, tom. I , p. Z 0 7 . )
M. Burette accorde néanmoins à la mufique grecque
l’expreffion, mais non pas telle qu’il ne traite
de fabuleux les merve.lieux effets que les Anciens
lui attribuent. Il regarde en particulier comme
infuffifante la raifon que donne Polybe de la-ruftieité
des Canaïres ; parce qu’une mufique auffi chétive
qu’il fe figure avoir été la mufique grecque, ne
pouvoit contribuer à rendre les moeurs douces 8c
humaines.
Toute l’érudition du favant académicien n’a pas,
aux yeux du bon fens, la même force que cette
fimple réflexion : Efl-il poffible que les Grecs 3 dont
le goût fut fi délicat dans tous les arts qu’ils cultivèrent,
aient été fi barbares relativement à la mufique,
qu’ils cultivèrent plus que tous les autres arts ?
Ils parloient une langue exceffivement douce, qui
fe plioit aux modulations les plus délicates , aux
divifions de temps les plus variées. Us étoient extrêmement
féconds en affeétions 8c en fentimens , qu’ils
s’étudioientà exprimer par la poéfie 8c parla mufique.
Us les exprimèrent en poéfie d’une manière inimitable
; mais en mufique ils ne purent jamais parvenir
à faire ce que fait un de nos plus groffiers villageois.
Sapho , cette femme paffionnée , pleine d’enthou-
fiafme & de feu, chantoit fes pallions dans le goût
de nos antiennes & de nos graduels.
Et par quels motifs M. Burette cite-t-il la lyre
grecque à quatte cordes ? Il fuppofe que les Grecs
privés de coûte notion de contre-point, accompa-
gnoient le chant à l’uniffon. Si donc leur modulation
étoit pauvre , parcë que la lyre n’avoit que quatre
cordes, le chant à l’uniffon avec la lyre étoit auffi
réduit à moduler fur quatre fons. Cet argument ,
pour trop prouver, ne prouve donc abfolument rien.
D’ailleurs, outre cette lyre, les Grecs jouoient de
plufieurs autres inftmmens à fept cordes, à dix , 6c
même davantage. Mais on ne peut rien conclure de
ÏÏ mi