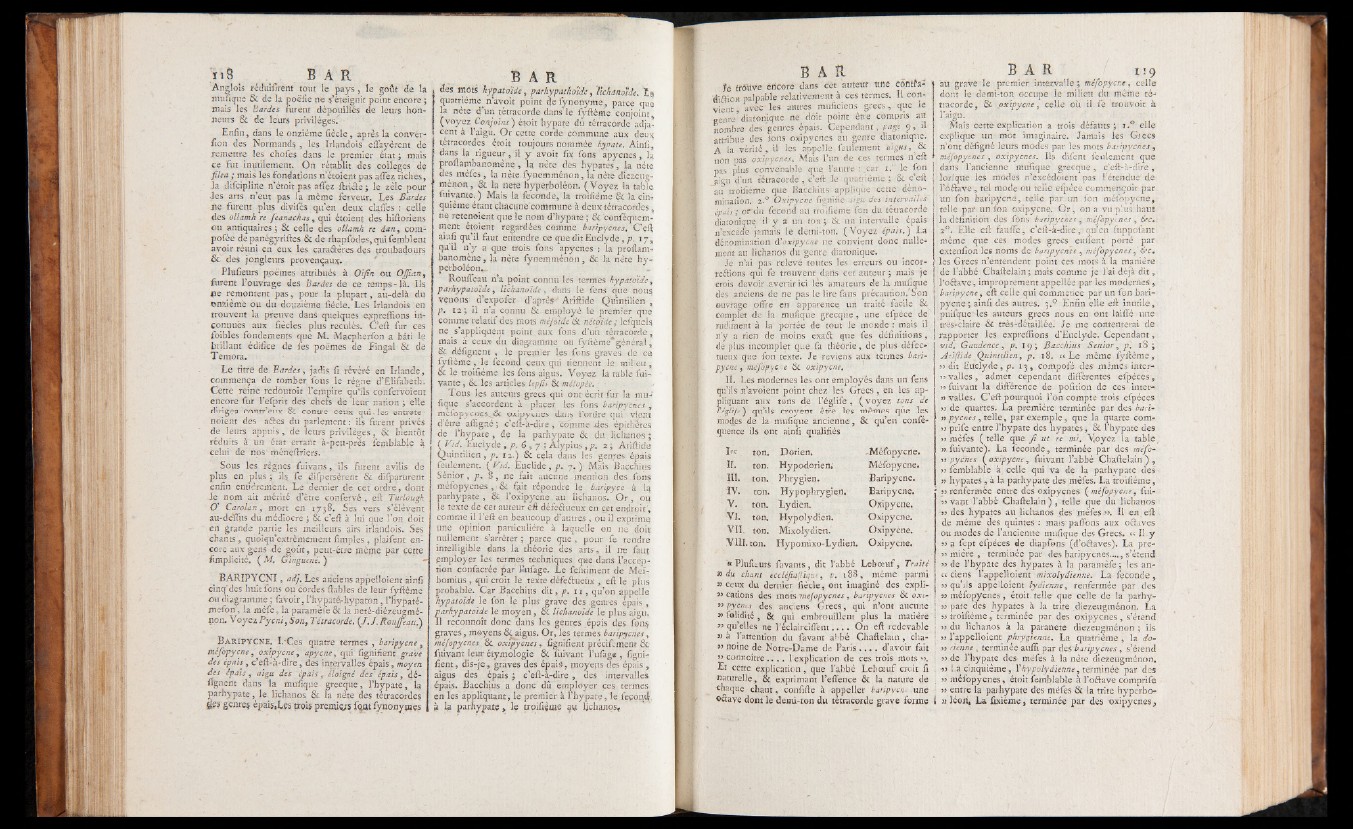
1 1 S B A R
Anglois rédurfirent tout le p a y s , le goût de la
mufique & de la poëfie ne s’éteignit point encore ;
mais les Bardes furent dépouillés de leurs honneurs
& de leurs privilèges^
Enfin, dans le onzième fiècle, après la conversion
des Normands , les Trlandois eftayèrent de
remettre les chofes dans le premier état ; mais
ce fut inutilement. On rétablit des colleges dç
filea; mais les fondations n’étoient pas allez riches,
la difçipline n’étoit pas a.fiez ftri&e ; le zèle pour
•les arts n’eut pas la même ferveur. Les Bardes
jne furent plus divifés qu’en deux clafies : celle
des ollamh re feanachas, qui étoient des hifioriens
ou antiquaires * & celle des ollamh re dan, çom-
pofée de panégyriftes & de rhapfocles, qui femblent
avoir réuni en eux les caractères des troubadours
.& des jongleurs provençaux.
Plufieurs poèmes attribués à Oïfin ou Offian,
furent l ’ouvrage des Bardes de çe temps-là. Ils
n e remontent pas, pour la plupart, au-delà du
onzième ou du douzième fiècle. Les Irlandois en
trouvent la preuve dans quelques e^prefïions inconnues
aux fiècles plus reculés. C ’eft fur ces
foibles fondements que M. Macpherfon a bâti le
brillant édifice de les poèmes de Fingal & de
Temora.
Le titré de Bardes, jadis, fi. révéré en Irlande,
commença de tomber fous le règne d’Elifabeth.
Cette reine redoutoit l’empire qu’ils confervoient
encore fur l’efprit des chefs de leur nation; elle
dirigea contr’eux & contre ceux qui.les entrete-
noient des aftes du parlement : ils furent privés
de leurs appuis , de leurs privilèges, & bientôt
réduits à un état errant à-peu-pres femblable à
celui de nos' méneftriers.
Sous les règnes fuivans, ils furent avilis de
plus en plus ; ils fe difpersèrent & difparurent
enfin entièrement. Le dernier de cet ordre, dont
le nom ait mérité d’être confervé, eft Turlough
O’ Carolan, mort en 1738. Ses vers s’élèvent
au-defiiis du médiocre ; & c’eft à lui que l’on doit
en grande partie les meilleurs airs irlandois. Ses
chants, quoiqu’extrêmement fimples , plaifent encore
aux gens de goût, peut-être même par cette ;
Simplicité. ( M, Ginguené. ) -
_ B A R IP Y CN I , ad}. Les anciens appelloient ainfi
cinq'des huit fons ou cordes fiables de leur fyftême
ou diagramme ; faVoir, l’hypatérhypaton, l’hypaté-
mefon, la mèfe, la paramèle & la neté-diézeugmé-
npn. Voyez Pycni, Son, Tétracorde. (/. J. Roujjeau,)
B arïpycne. I.’Ces quatre termes , baripycne ,
méfopycne, oxîpycne, apycne, qui lignifient grave
des épais, c’eft-à-dire, des intervalles épais, moyen
des épais, aigu des épais, éloigné des épais, désignent
dans la mufique grecque, l’hypate, la
parhypate, le. lichanos & la nète des tétracordes
ges genre§ épais,Les trois premiers fqat fynonyjaes
fies mots hypaioi.de, parhypathoïde, lichanoïde. 'ï>@
quatrième n’avoit point de fynonyme, parce que
la nète fi’un tétracorde dans le fyftême conjoint
(voyez Conjoint) étoit hypate du tétracorde adjacent
a l’aigu. Or cette corde commune aux deux
t,éfracordes étoit toujours nommée hypate. Ainfi,
dans la rigueur, il y avoit fix fons apycnes, la
proflambanomène, la nète des hypates, la nète
des mèfes, la nète fynemménon, la nètë diezeug-
ménon, & la nete hyperboléon. ( Voyez la table
fuivante. ) Mais la fécondé, la troifième & la cin?
quième étant chacune'commune à deux tétracordes,
ne retenaient que le nom d’hypate ; & çonféquem-
ment étoient regardées comme baripy cries. C’eft
ainfi qu’il faut entendre ce que dit Euclyde, p. 17 ,
qu’il n’y a que trois fons apycnes s la proflam-?
banomènç, la nçte fynemménon, & la. nète hy-r
perboléon._
Rouffeau n’a point connu les termes hypatoïde,
parhypatoïde, lichanoïde , dans le fens que nou$
venons- d’expofer d’après 4 Ariftide Quintilien ,
p. 12', il n’a connu & employé le premier que
comme relatif des mots mé/èïde & nétoide ; lefquels
ne s’appliquent point. aux fons d’un tétracorde,
mais à ceux du diagramme ou fyftêmé*général,
& défignent , le premier les fons graves, de çe
fyfiême, le fécond Ceux qui tiennent le milieu,
& le troifième les fons aigus. Voyez la table fui-?
Vante , &ilçs articles lep/ïs 6c mélopée.
Tous les auteurs grecs, qui ont écrit fur la mufique
s’accordent à placer les fons barlpfcn.es ,
méfopycnes^& oxipyenes dans l’ordre qui vient
d’être afligné ; c’eft-à-dire, comme 4es épithètes
de Fhypate , de la parhypate & du lichanos ;
( Vid. Euclyde , p. 6 , 7 : Aiypius , p. 2 ; Arifiide
Quintilien, p. 12.) & cela dans les genres épais
feulement. (Vid. Euclide , p. 7. ) Mais Bacchius
Sénior, p. 8 , ne fait aucune mention des fons
méfopyenes , > & fait répondre le baripy ce à la
parhypate, & l’oxipycne au lichanos. O r , ou
le texte de cet auteur éfi défeétueux en cet endroit,
comme il l ’efi en beaucoup d’autres , ou il exprime
une opinion particulière à laquelle on ne doit
nullement s’arrêter ; parce que, pour fe rendre
intelligible dans la théorie des arts, il ne faut
employer les termes techniques que dans l’acception
confacrée par Uufage, Le fefitiment de Meï-
bomius , qui croit le texte défeftueûx, eft le plust
probable. Car Bacchius d it, p. 1 1 , qu’on appelle
hypato'ide le fon le plus grave des .genres épais ,
parhypatoïde le moyen, pc lichanoïde le plus aigu.
Il reçonnoît donc dans les genres épais des fons
graves , moyens & aigus. Or, les termes baripycnes ,
méfopyenes & oxipyenes, fignifient précifiment &
fuivant leur étymologie 6c fuivant l’ufage , fignifient
, dis-je, graves des épais, moyeps des épais ,
aigus des épais ; c’eft-à-dire , des intervalles
épais. Bacchius a donc dû employer ces termes
en les appliquant, le premier à Fhypate, le feçonfi;.
à 1^ parhypate » le troifième au lichanos«
Jé fM'iive encore dans cet auteur une CÔfttfa-
fiiaion palpable relativement à ces termes. I l co n v
ien t , avècr les autres muficiens grecs , que le
genre diatonique ne doit point être compris au
nombre des genres épais. C ep en d an t, page 9 , il
attribue des Ions oxipyenes au genre diatonique.
A la vérité , il les appelle feulement aigus, 6>C
non pas oxipyenes. Mais l’un de ces termes il efi
pas plus convenable que l’autre : .car 1 .“ le fon
_aigu d’un tétracorde, c’eft le quatrième ; & c efi
au troifième que Bacchius applique cette dénomination.
2.° Oxîpycne fignifié aigu des intervalles
épais ; o r du fécond ait troifième fon du tétracorde
diatonique il y 2 un ton ; & un intervalle épais
11’excèdè jamais le demi-ton. (V o y e z épais.') La
dénomination à'oxipyene ne convient donc nulle*
ment au lichanos du 'genre diatonique.
Je n’ai pas relevé toutes les erreurs ou iïlcôr-
fe r io n s qui fe trouvent dans cet auteur ; mais je
crois devoir\avertir ici les amateurs de la mufique
des anciens de ne pas le lire fans précaution. Son
ouvrage offre en apparence un traité facile &
complet de la mufique g re cq u e , une efpèce de
rudiment à la portée de tout le monde : mais il
n’y a rien de moins exa& que fes définitions ,
de plus incomplet que fa th éô rie, de plus défec*
tueux que fon texte. Je reviens aux termes bari-
pyene, méfàpyc '-e & oxipyene. ■
II. Les modernes les ont employés dans un fens
qu’ils n’avoient point chez les G r e c s , en les appliquant
aux tons de l’é g l i f e , ( v o y e z tons de
mm ) qu’ils croyent être les mêfnes que les
mod^es de la mufique ancienne,
qtience ils ont ainfi qualifiés
& qu’en confé-
1er ton. Doriert. -Méfopycne*
II. ton. Hypodorien.' Méfopycne.
III. ton. Phrygien. Baripycne.
IV. ton. H ypophryg ien . Baripycne.
V . ton. Lydien. Oxipy ene.
V I. ton. Hypolydien . Oxipy ene.
VII. ton. Mixolyd icn. Oxipy ene.
V III. ton. Hypomixo-Lydien. Oxipy ene.
«< PlufLufS faVants, dit l’abbé L e boe u f , Traité
to du chant eccléfiaflique, p. 18 8 , même parmi
ceux du dernier fiè c le , ont imaginé des expli*
55 cations des mots 7nejopycnes . baripy c nés & oxi-
»3 pyems des anciens G r e c s q u i n’ont aucune
» folidité, & qui embrouillent plus la matière
« qu’elles ne lec la irc iffen t. . . . O n eft redevable
» à Fattention du favant abbé Ch a fte la in , cha-
*3 noine de Notre-Dame de P ar is. . . . d’avoir fait
” connoître . . . . 1 explication de ces trois mots »3.
Et cette explica tion, que l’abbé L e boe u f croit fi
naturelle, & exprimant l’effence & la nature de
chaque ch an t, confifte à appeller baripy en* une
©ftaye dont le demi-ton du tétracorde grave forme
ail grave le premier in te rv a lle ; méfopycne, ce lle
dont le demi-ton. occupe le milieu du. même té-
tracorde, & oxipyene, ce lle où il fe trouvoit à
l ’aigu. - 1 '
Mais cette explication a trois défauts $ i . ° elle
explique un mot imaginaire. Jamais les G ie c s
n’ont défigné leurs modes par les mots baripycries ,
méfopyenes , oxipyenes. Ils difent feulement que
dans l’ancienne mufique g re cq u e , c 'eft-à-dire,
! lor'que les modes n’excédoient pas l’étendue de
{ l’é é ra v e , tel mode ou telle efpèce commençoit par
un fon baripycn e, telle par un fon méfopycn e,
telle par un fon oxipyene. O r , on a vu plus, haut
la définition dès fon s baripycne s , méfopy' nés >, &c»:
20.. Elle efi fa.uffe, c’êft-à-dire, qu’en fuppofant
même que ces modes grecs eüfient porté par
extenfion les noms de baripycne s , méfopyenes, &c*
les Grées n’entendent point ces mots à la manière
de l ’abbé Chaftelain ; mais comme je l ’ai déjà d i t ,
l’o fta v e , improprement appellée par les modernes ,
baripycne, eft celle qui commence par un fon barip
y c n e ; ainfi des autres. 3.0 Enfin elle eft inu tile ,
puifqueTes auteurs grecs nous en ont làiffé une
tres-claire & très-détaillée. Je me contenterai de
rapporter les expreflions d’Eu clyd e. Cep en d an t,
vid. Gaudence, p. 1 9 ; Bacchius Senior, p. 18 ;
Arïflide Quintilien, p. 18. « L e même fy fiêm e ,
j5 dit E u c lyd e , p. 13 , corîipofé dés mime s inter-
33 v a l le s , admet cependant différentes e fp è c e s ,
3-3 fuivant la différence de pofitioil de ces inter-
» valles. C ’eft pourquoi l’on compte trois efpèces
33 de quartes. L a première terminée par des bari-
jt pyenes, t e lle , par e x em p le , que la quarte coiru-
33 prife entre l ’hypate des h yp a té s, & Fhypate des
33 mèfes ( telle que f i ut re mi. V o y e z la tab le ,
».fuivante). L a fé co n d é , terminée par des rnèfo~
33 pyehes ( oxipyene, fuivant l’abbé Chaftelain ) ,
33 femblable à celle qui va de la parhypate des
33 hypates , à la parhypate des mèfes. La troifième,
33 renfermée entre des oxipyçnes ( méfopycne, fui-
33 v a ç t Fabbé Chaftelain ) , telle que du lichanos
33 des hypates au lichanos des mèfes 33. Il en eft
de même des quintes : mais paflons aux otftaves
Ou modes de l’ancienne mufique des Grecs, ce I L y
33 a fept efpèces de diapfens (d’oélaves). La pre-
33 mière terminée par des bari pyenes...., s’étend
33 de l’bypate des hypates à la paramèfe ; les an-
et ciens l’appelloient mixolydienne. La fé c o n d é ,
33 qu’ils appelloient lydienne, renfermée par des
« méfopyenes, étoit. telle que celle de la parhy-
| 33 pâte des hypates à la trite diezeugménon. L a
| >3 troifième, terminée par des oxipyenes , s’étend
j si du lichanos à la paranete diezeugménon ; ils
; 33 Fappelloient phrygienne. L a quatrième , la do-
33 rienne , terminée auffi par des baripy eues, s’étend
j de Fhypate des mèfes à la nète diezeugménon.
; -33 l a cinquième, Yhypolydienne, terminée par des
33 méfopyenes, étoit femblable à Foélave comprife
i >J entre la parhypate des mèfes & la trite hyperbo-
i » léon, L a fixiém e , terminée par des o x ip y en e s ,