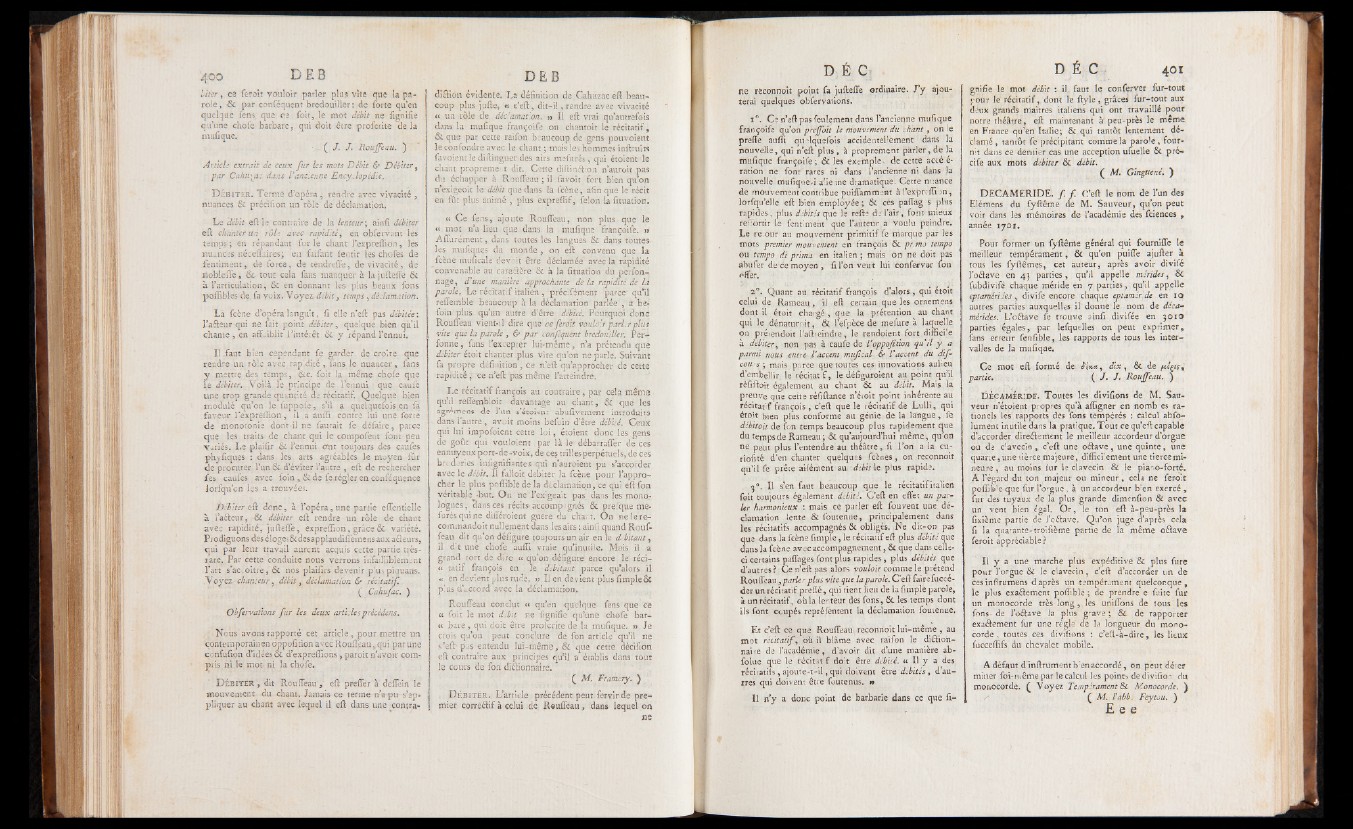
Inter, ce feroit vouloir parler plus vîte que la parole,
& par conféquent bredouiller: de forte qu’en
quelque fens que c.a foit, le mot débit ne fignifie
qu’une chofe barbare, qui doit être profente de la
mufique.
■ ( J. J. Rouffeau. )
Articli extrait de ceux fur les mots Débit & Débiter,
; par Cùku]a: dans l'ancienne Encyclopédie.
D ébiter. Terme dopera, rendrè avec vivacité,
nuances & précifion un rôle de déclamation.
Le débit eft le contraire de la lenteur ; ainfi débiter
eft chanter un rôle avec rapidité, en obfervant les
temps; en répandant furie chant l’expreflion, les
nuances néceffaires; en fai fan t lentir les chofes de
fentiment, de force, de tendreffe, de vivacité, de
nobleiffe, &- tout cela fans manquer à la jufteffe &
à l’articulation, & en donnant les plus beaux fons
poffibles de. fa voix. Voyez débit , temps, déclamation.
La fcène d’opéra languit, fi elle n’eff pas débitée'.
l’aCteur qui ne fait point débiter, quelque bien qu’il
chante, en affaiblit l ’intérêt & y répand l’ennui.
Il .faut bien cependant fe garder de croire, que
rendre un rôle avec rapidité , fans le nuancer , fans
y mettre des temps, &c. foit la même chofe que
le débiter. Vpilà le principe de l’ennui que caufe
une trop grande quantité de récitatif. Quelque bien
modulé qu’on le iuppofe, s’il a quelquefois en fa
faveur Texprèffion, il a au fil contre lui une forte
de monotonie dont-il ne faurait fe défaire, parce
que les traits de chant qui le compofent font peu
variés. Le plaiûr & l’ennui otit toujours des caufes
phyfiques : dans les arts agréables le moyen fûr
de procurer l’un & d’éviter l’autre , eft de rechercher
fes caufes avec foin , & de fe.régler en conféquence
lorfqu’on les a trouvées.
Débiter eft donc, à l’opéra, une partie effenrielle
à I’aCteur, & débiter eft rendre un rôle de chant
avec rapidité, jufteffe, expreflion, grâce & variété.
Prodiguons des éloges&desapplaudiftemens aux aCteurs,
qui par leur travail auront acquis cette partie très-
rare. Par cette conduite nous verrons infailliblement
l’art s’ac.oitre, & nos plaifirs devenir p’us piguans.
V oyez chanteur, débit, déclamation & récitatif.
( Çahujac. )
Obfervations fur les deux articles précèdens.
Nous avons rapporté cet article , pour mettre un
contemporain en oppofition avec Rouffeau, qui par une
confufion d’idées & d’expreffioris, paroit n’avoir compris
ni le mot ni la chofe.
D ébiter , dit Rouffeau , eft preffer à deffein le
mouvement du chant. Jamais ce terme n’a pu s’appliquer
au chant ayec lequel il eft dans une contradiCtiôn
évidente. La définition de Cahüzac éft beaucoup
plus jufte, « e’eft, dit-il, rendre avec vivacité
« un rôle de déclamation. » Il eft vrai qu’autrefois
dans la mufique françoife on, chantoit le récitatif,
& que par cette raifon beaucoup de gens pouvoient
le confondre avec le chant ; mais les hommes inftruits
fa voient le diftinguerdes airs mefurés, qui étoierit le
chant proprement dit.. Cette diftinCtlon n’auroit pas
du échapper à Rouffeau; il fa voit fort bien qu’on
n’éxigéoit le débit que dans la fcène, afin que le récit
en fut plus animé , plus expreffif, félon la fituation.
« Ce fens, ajoute Rouffeau, non plus que le
« mot n’a lieu que dans la mufique françoifè. »
Affurément, dans toutes les langues & dans toutes
les mufiques du monde , on eft convenu que la
fcène muucale devoit être déclamée avec la rapidité
convenable au caractère & à la fituation du per fon-,
nage, d'une manière approchante de la rapidité de là
parole. Le récitatif italien , préclfément parce' qu’il
reffemble beaucoup à la déclamation parlée , a be-
foin plus qu’un autre d’être débité. Pourquoi donc
Rouffeau vient-il dire que ce feroit vouloir parler plus
vîte que la parole , & par conféquent bredouiller, Per-
fonne, fans l’excepter lui-même, n’a prétendu que
débiter étoit chanter plus vîte qu'on ne parle. Suivant
fa propre définition, ce n’eft qu’approcher de cette
rapiditéf ce n’eft pas même l’atteindre.
Le récitatif françois au contraire , par cela même
qu’il reffembloit davantage au chant, & que les
agrémens dè l’un s’étoient abufivèment introduits
dans l'autre , avoit moins befoin d’être débité. Ceux
qui lui impofoient cette lo i, étoient donc les gens
de goût qui vouloient . par là le débarraffer de ces
ennuyeux port-de-voix, de ces trilles perpétuels, de ces
broderies infignifiantes qui n’auroient pu s’accorder
avec le débit. 11 falloit débiter la fcène pour l’approcher
le plus poflïbîe de la déclamation, ce qui. eft fon
véritable^but. On ne l’exigeait pas dans les monologues,
dans ces récits-accomp agnés & prefque mefurés
qui ne différoient guere du char.t. On nelere-
commandoit nullement dans les airs : ainfi quand Rouf-
feau dit qu’on défigure toujours un air en le débitant,
il dit une chofe aufli vraie. qu’inutile. Mais il a
grand tort de dire .« qu’on défigure encore le réci-
« tarif françois en le débitant, parce qu’alors il
« en devient; plus rude. » Il en devient plus fimple ÔC
plus d’accord avec la déclamation.,
Rouffeau conclut « qu’en quelque fens que ce
« foit le mot débit ne fignifie qu’une chofe bar-
« bare, qui doit être proferite de la mufique. » Je
crois qu’on peut conclure de fon article qu’il ne
s’ efb pas entendu lui-même, & que cette décifion
eft contraire aux principes qu’il a établis dans tout
le cours de fon dictionnaire.
( M. Framcry. )
D ébiter. L’article précédent peut fervir de premier
correCtif à celui de Rouffeau, dans lequel on
ne
ne reconnoit point fa jufteffe ordinaire. J’y ajou-
tèrai quelques obfervatioris.
i° . Ce n’eft pas feulement dans l’ancierjne mufique
françoife qu’on preffoit le mouvement du chant, on le
preffe aufli quelquefois accidentellement dans la
nouvelle, qui n’eft plus , à proprement pàrler, de la
müfique françoife; & les exemple, de cette accélération
ne font rares ni dans l’ancienne ni dans la
nouvelle mufiqneri:a'ieme dramatique. Cette nuance
de mouvementcontribue puiffamment à l’exprçffim,
lorfqu’elle eft bien émployée ; & cés paffag s plus
rapides, plus débités que le refte de l’air, fon* mieux
reffortir le fentiment que l’auteur , a voulu peindre.
Le re.our au mouvement primitif fe marque par les
mots premier mouvement en françois & primo tempo
ou tempo di prima en italien ; mais on ne doit pas
dbufer de ce moyen, fi l’on veut lui conferver fon
êffer.
2°. Quant au récitatif françois d’alors , qui étoit
celui de Rameau, il eft certain que les ornemens
dont il étoit chargé, que la prétention au chant
qui le dénaturoit, & l’efoèce de mefure à laquelle
on prétendoit raftreindre, le rendoient fort difficile
à débiter, non pas à caufe de l'oppofition qu'il y a
parmi nous entre l'accent mufical èr l ’accent du dif-
cours ; mais parce que toutes ces innovations aulieu
d’embeilir le récitatif, le défiguroient au point qu’il
rèfiftoit également au chant & au débit. Mais la
preuve que cette réfiftance n’étoit point inhérente au
récitatif françois , c’eft que le récitatif de Lulli, qui
étoit bien plus conforme au génie de la langue, fe
débitoit de fon temps beaucoup plus rapidement que
du temps de Rameau; & qu’aujourd’hui même, qu’on
ne peut plus l’entendre au théâtre, fi l’on a la cu-
riofité d’en chanter quelques fcènès, on reconnoit
qu’il fe prête aifément au. t/.^ir le plus rapide*
ÿ . Il s’en faut beaucoup que le récitatif italien
foit toujours également débité. C ’eft en effet un parler
harmonieux : mais ce parler eft fou vent une déclamation
lente & foutenue, principalement dans
les récitatifs accompagnés & obligés. Ne dit-on pas
que dans la fcène fimple, le récitatif eft plus débité que
dans la fcène avec accompagnement, & que dans celle-
ci certains paffages font plus rapides, plus débités que
d’autres ? Çe n’eft pas alors vouloir comme le prétend
Rouffeau , parler plus vîte que la parole. Ceft faire fuccé-
der un récitatif preflé, qui tient lieu de la fimple parole,
à un récitatif, oiila lenteur des fons, & les temps dont
ils font coupés repxéfentent la déclamation foutenue.
Et c’eft ce que Rouffeau^ reconnoit lui-même , au
mot récitatif iy oh il blâme avec raifon le dictionnaire
de l’académie, d’avoir dit d’une manière ab-
folue que le récitât f doit être débité. « 11 y a des
récitatifs, ajoute-t-il, qui doivent être débités, d’au-
rres qui doivent être foutenus. »
Il n’y a donc point de barbarie dans ce que fignifie
le mot débit : il, faut le conferver fur-tout
pour le récitatif, dont le ftyle, grâces fur-tout aux
déux grands maîtres italiens qui ont travaillé pour
notre théâtre, eft maintenant à' peu-près le même
en France qu’en Italie; & qui tantôt lentement déclamé
, tantôt fe précipitant comme la parole, fournit
dans ce dernier cas une acception ufuelle & pré-»
cife aux mots débiter & débit.
( M. Ginguené. )
DECAMERIDE. f f. C’eft le nom de l’un des
Elémens du fyftême de M. Sauveur, qu’on peut
voir dans les mémoires de l’académie des fciences ,
année 170s.
Pour former un fyftêtrte général qui fourniffe le
meilleur tempérament, & qu’on puiffe ajufter à
tous les fyftêmes, cet auteur, après avoir divifé
I l’o&ave en 43 parties, qu’il appelle mérides, &
fubdivifé chaque méride en 7 parties, qu’il appelle
eptamérides, divife encore chaque eptamér de en 19
autres parties auxquelles il donne'le nom de dèca-
mérides. L’odave fe trouve rrinfi divifée en 3010
parties égales, par lefquelles on peut exprimer,
fans erreur fenfible, les rapports de tous les inter-
1 valles de la mufique.
Ce mot eft.formé de «J?*«, dix, & de plgisi
partie................ , f J. J* Rouffeau. )
DécÀméride. Toutes les divifions de M. Sauveur
n’étoient propres qu’à aflïgner en nomb es ra-
tionels les rapports des fons tempérés : calcul abfo-
lument inutile dans la pratique. Tout ce qu’eft capable
d’accorder direélement le meilleur accordeur d’orgue
ou de c'avecin, c’eft une oélave, une quinte, une
quarte, une tièree majeure , difficilement une tierce mineure
, au moins fur le clavecin & le piano-forté.
A l’égard du ton majeur ou mineur, cela ne feroit
poffib'e que fur l’orgue, à un accordeur b:en exercé,
fur des tuyaux de la plus grande dimenfion & avec
un vent bien égal. O r , le ton eft à-peu-près la
fixième partie de l’eftave. Qu’on juge d’après cela
fi la quarante-troifième partie de la même ofiave
feroit appréciable ?
Il y a une marche plus expéditive & plus fure
pour l’orgue & le clavecin, c’eft d’accorder un de
cesinftrumens daprès un tempérament quelconque,
le plus exactement poffible ; de prendre e fuite fur
un monocorde très-long, les unifions de tous les
fons- de l’oétave la plus grave ; & de rapporter
exaétement fur une règle de la longueur du mono-
; corde , toutes ces divifions : c’e(t-à-dire, les lieux
fucceffifs du chevalet mobile.
Adéfaut d’inftrumerit ben accordé, on peut détev
miner foi-même par le calcul les points de divifio* du
monocorde. ( V oyez Tempérament & Monocorde. )
| ( M. Pabbc Feytôu. )
E e e