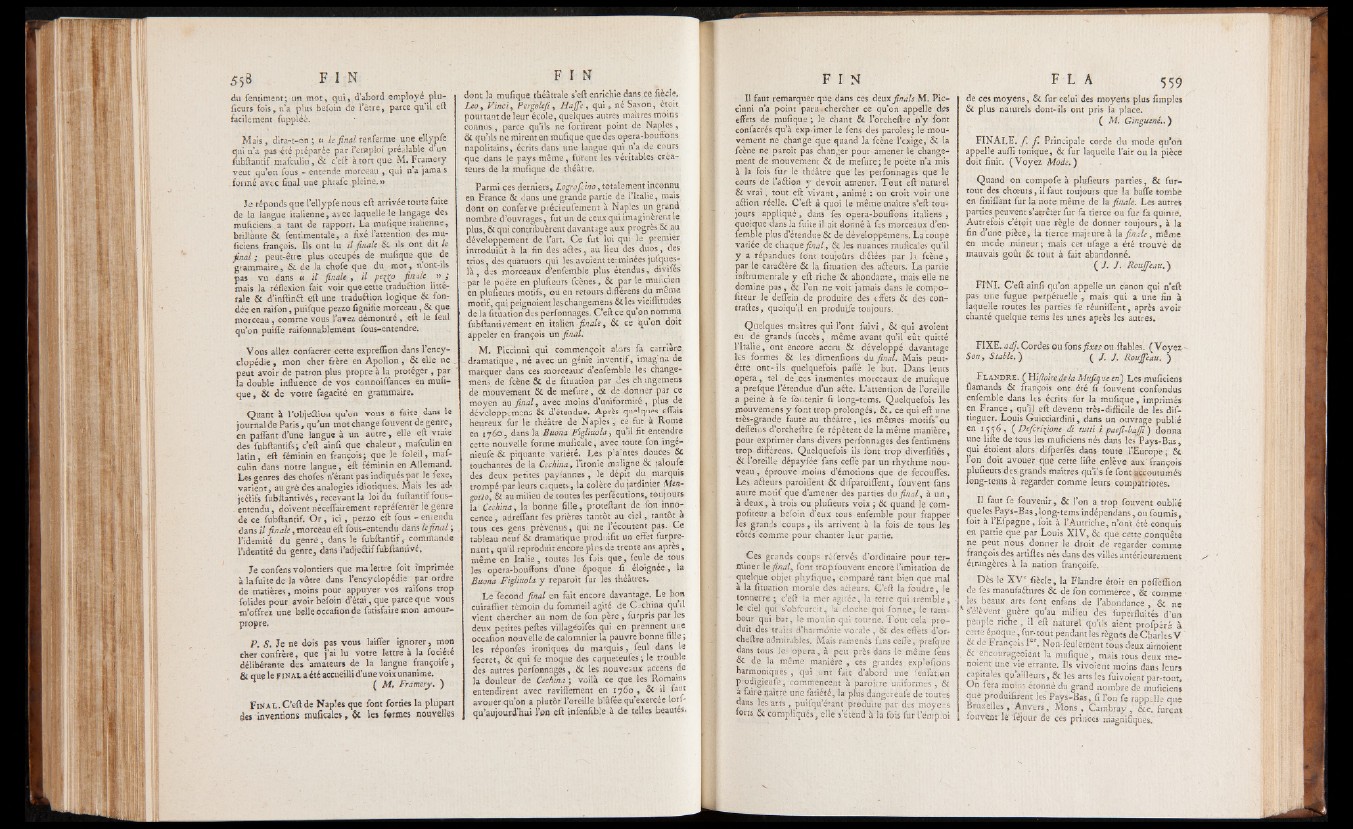
558 F IN
du fent-iment ; • un mot, qui, d’abord employé plufieurs
fois, n’a plus befoin de l’être, parce qu il eft
facilement fuppléé.
Mais , dira-t-on ; « le final renferme une ellypfe
qui n’a pas été préparée par l’emploi préalable d un
fubftantif mafculin,& c’eft à tort que M. Framery
veut qu’on fous - entende morceau , qui na jama s
formé avec final une phrafe pleine.»
Je réponds que l’ellypfe nous eft arrivée toute faite
de la langue italienne, avec laquelle le langage des
muficiens a tant de rapport. La mufique italienne,
brillante & fentimentale, a fixé l’attention des musiciens
François. Ils ont lu il finale &■ ils ont dit le
final ; peut-être plus occupés de mufique que de j
grammaire, & de la chofe que du mot, n ont-ils
pas vu dans « it finale , il peitfp finale » i
mais la réflexion fait voir que cette traduction littérale
& d’inftinét eft une tradu&ion logique & fondée
en raifon, puifque pezzo Signifie morceau, & que
morceau , comme vous l’avez démontré , eft le Seul
qu’on puiffe raisonnablement fous-entendre.
Vous allez confacrer cette expreffion dans l’encyclopédie
, mon cher frère en Apollon , & elle ne _
peut avoir de patron plus propre à la protéger , par
la double influence de vos connoiffances en mufique,
& de votre Sagacité en grammaire.
Quant à l*obje£tion qu’on vous a faite dans lè
journal de Paris , qu’un mot change Souvent de genre,
en paffant d’une langue à un autre, elle eft vraie
des fubftantifs; c’eft ainfi que chaleur, mafeulin en
latin, eft féminin en françois; que le foleil, mafeulin
dans notre langue, eft féminin en Allemand.
Les genres des chofes n’étant pas indiqués par le fexe,
varient, au gré des analogies idiotiques. Mais les ad-
jeétifs fubfiantivés, recevant la loi du^ fuftantif fous-
. entendu, doivent néceffairement représenter le.genre
de ce fubftantif. O r , ic i, pezzo eft fous - entendu
dans il finale, morceau eft fous-entendu dans le final ;
l’identité du genre, dans le fubftantif,-commande
l’identité du genre? dans l’adjeftif fubftantive.
Je confens volontiers que ma lettre foit imprimée
à la fuite de la vôtre dans l’encyclopédie par ordre
de matières, moins pour appuyer vos raifons trop
folides pour avoir befoin d’étai, que parce que vous
m’offrez une belle occafion de Satisfaire mon amour-
propre.
P. S. Je ne dois pas vous laiffer ignorer, mon
cher confrère, que j’ai lu votre lettre à la Société
délibérante des amateurs de la langue françoife,
& que le final a été accueilli d’une voix unanime.
( M. Framery. )
Fin a l . C ’eft de Naples que font forties la plupart
4es inventions muficales » & les formes nouvelles
F I N
dont la mufique théâtrale s’eft enrichie dans ce Siècle.-
Léot Vinci, Pergolefi, Hafifie , qui , né Saxon, étoit
pourtant de leur école, quelques autres maîtres moins
connus , parce qu’ils ne Sortirent point de Naples,
& qu’ils ne mirent en mufique que des opéra-bouffons
napolitains, écrits dans une langue qui n’a de cours
que dans le pays même, furent les véritables créateurs
de la mufique de théâtre.
Parmi ces derniers, Logroficino, totalement inconnu
en France & clans une grande partie de l’Italie9 mais
dont on conierve précieulement à Naples un grand
nombre d’ouvrages, fut un de ceux qui imaginèrent le
plus, & qui contribuèrent davantage aux progrès & .au
développement de l’art. Ce fut lui qui le premier
introduisit à la fin des aéles, au lieu des duos, des
trios, des quatuors qui les.avoient terminées jufques-
l à , des morceaux d’enfemble plus étendus, divifés
- par le poëte en plufieurs fcènes, & par le muhcien.
en plufieurs motifs, ou en retours différens du meme
motif, qui peignoientleschangemens ôtles viciflitudes
de la fituation des perfonnages. C’eft ce qu’on nomma
fubftanti veinent en italien finale, & ce qu’on dpit
appeler en françois un final.
M. Piccinni qui commençoit alors fa carrière
dramatique, né avec un génie inventif, imagna de
marquer dans ces morceaux d’enfemble les change-
mens, de fcène & de fituation par des changemens
de mouvement & de mefure, &. de donner par ce
moyen au final, avec moins d’uniformité, plus de
développemens & d’étendue. Après quelques effais
heureux fur le théâtre de Naples, ce fut a Rome
en 1760, dans la Buona Figliuola, qu’il fit entendre
cette nouvelle forme muficale, avec toute fon inge-
nieufe & piquante variété. Les p'a ntes douces &
touchantes de la Cechina, l’ironie maligne & jaloufe
des deux petites payfannes , le dépit du marquis
trompé par leurs caquets, la colère du jardinier Men-
gotïo, & au milieu de toutes les perfécutions, toujours
j la Cechina, la bonne fille, proteftant de Ton innocence,
adreffant fes prières tantôt au ciel, tantôt a
tous ces gens prévenus, qui ne l’écoutent pas. Ce
tableau neuf & dramatique produifït un effet furpre-
nant, qu’il reproduit encore plus de trente ans après,
même en Italie, toutes lés fois que, feule de tous
les opera-bouffons d’une époque fi éloignée, la
Buona Figliuola y reparoît fur les théâtres.
Le Tecond final en fait encore davantage. Le bon
cuiraffier témoin du fommeil agité de C;china qu’il
vient chercher au nom de fon père, furpris par les
deux petites peftes villagéoifes qui en prennent une
occafion nouvelle de calomnier la pauvre bonne fille ;
les réponfes ironiques du marquis, feul dans le
fecret, & qui fe moque des caquetëufes; le trouble
des autres perfonnages, & les nouveaux accens de
la douleur de Cechina ; voilà ce que les Romains
entendirent avec raviffement en 1760^, & il faut
avouer qu’on a plutôt l’oreille blâfée qu’exercée lorf-
qu’aiijourd’hui l’on eft infenfibie à de telles beauté*«
F I N
Il faut remarquer que dans ces deuxfinals M. Piccinni
n’a point paru.chercher ce qu’on appelle des
effets de mufique ; le chant & l’orcheftre n’y font
confacrés qu’à exprimer le fens des paroles; le mouvement
ne change que quand la fcène l’exige, & la
fcène ne paroît pas changer pour amener le changement
de mouvement & de mefure; le poëte n’a mis
à la fois fur le théâtre que les peifonnagts que le
cours de l’àâion y devoir amener. Tout eft naturel
& vrai tout eft vivant, animé : on croit voir unè
aélion réelle. C ’eft à quoi le même maître s’eft toujours
appliqué, dans fes opera-bouffons italiens ,
quoique dans la fuite il ait donné à fes morceaux d’enfemble
plus d’étendue & de développemens. La coupe
variée de chaque finale & les nuances mufîeales qu’il
y a répandues font toujours diéfées par la fcène,
par le caraélère & la fituation des aéleurs. La partie
inftrumenrale y eft riche & abondante, mais elle ne
domine pas, & l’on ne voit jamais dans le compo-
fiteur Je deffein de produire des effets & des contraires
, quoiqu’il en produire toujours.
Quelques maîtres qui l’ont fuivi, & qui avoient
eu de grands fuccès, même avant qu’il eût quitté
Tltalie, ont encore accru & développé davantage
les formes & les dimenfions du final. Mais peut-
être ont- ils quelquefois paffé le but. Dans leurs
opéra, tel dettes inimenfes morceaux de mufique
a prefque l’étendue d’un aéte. L’attention de l’oreille
a peine à fe foutenir fi long-tems. Quelquefois les
mouvemens y font trop prolongés , & , ce qui eft une
très-grande faute au théâtre, les mêmes motifs'ou
deffeins d’orcheftre fe répètent de la même manière,
pour exprimer dans divers perfonnages des fentimens
trop différens. Quelquefois ils font trop diverfifiés,
& l’oreille dépayfée fans ceffe par un rhythme nouveau,
éprouve moins d’émotions que de fecouffes.
Les aéleurs paroiffent & difparoiffent, fouvent fans
autre motif que d’amener des parties du final, à un,
à deux, à trois ou plufieurs voix ; & quand le com-
pofiteur a befoin d’eux tous enfemble pour frapper
les grands coups, ils arrivent à la fois de tous les
côtés comme pour chanter leur partie.
Ces grands coups réfervés d’ordinaire pour terminer
le final, font tropfouvent encore l’imitation de
quelque objet phyfique, comparé tant bien que mal
à là fituation morale des aâeurs. C ’eft la foudre, le
tonnerre ; c’eft la mer agitée, la terre qui tremble,
le ciel qui s’obfcurcit, la cloche qui forme, le tambour
qui bat, le moulin qui tourne. Tout cela produit
des traits d’harmonie vocale, & des effets d’orcheftre
admirables. Mais ramenés fens celle, prefque
dans tous le.* opéra, à peu près dans le même fens
& de la même manière , ces grandes exploitons
harmoniques , qui ont fait d’abord une fenfatien
prodigieufe, commencent à paroître uniformes , &
à faire paître une fatiété, la plus dangereufe de toutes
dans les arts, puifqu’étant produite par des moyens
forts & compliqués, elle s’étend à la fois fur i emploi
F L A 559
de ces moyens, & fur celui des moyens plus fimples
& plus naturels dont-ils ont pris la place.
( M. Ginguené..)
FINALE, fi. fi. Principale corde du mode qu’on
appelle aufli tonique, & fur laquelle l’air ou la pièce
doit finir. (V oyez Mode.}
Quand on compofe à plufieurs parties, & fur-
tout des choeuis, il faut toujours que la baffe tombe
en finiffant fur la note même de la finale. Les autres
parties peuvent s’arrêter fur fa tierce ou fur fa quinte.
Autrefois c’étqit une règle de donner toujours, à la
fin d’une pièce, la tierce majeure à la finale, même
en mode mineur ; mais cet ufage a été trouvé de
mauvais goût & tout à fait abandonné.
( J. J. Roufifieau. )
FINI. C ’eft ainfi qu’on appelle un canon qui n’eft
pas une fugue perpétuelle , mais qui a une fin à
laquelle toutes les parties fe réunifient, après avoir
chanté quelque tems les unes après les autres.
FIXE. adj. Cordes ou fons fixes ou fiables. (V oyez -
Son, Stable. } ( J. J. Roufifieau. }
Flandre. .( Hifioirede la Mufique en) Les muficiens
1 flamands & françois ont été fi fouvent confondus
enfemble dans les écrits fur la mufique, imprimés
en France, qu’il eft devenu très-difficile de les dif-
tinguer. Louis Guicciardini, dans un ouvrage publié
en 1556, ( Deficrifiwne di tutti i paefi-bajfi) donna
une lifte de tous les muficiens nés dans les Pays-Bas,
qui étoient alors difperfés dans toute d’Europe ; &
l’on doit avouer que cette lifte enlève aux françois
plufieurs des grands maîtres qu’ils fe font accoutumés
long-tems à regarder comme leurs compatriotes.
Il faut fe fouvenir, & l’on a trop fouvent oublié
quelesPays-Bas,long-temsindépendans,ou fournis,
foit à 1 Efpagne, foit à l’Autriche, n’ont été conquis
en partie que par Louis XIV, & que cette .conquête
ne peut nous donner le droit de regarder comme
françois des artifles nés dans des villes antérieurement ^
étrangères à la nation françoife.
Dès le X V e fiècle, la Flandre étoit en poffeffion
de fes manufa&ures & de fon commerce, & comme
les beaux arts font enfans .de l’abondance, & ne
s élevent guère qu au milieu des fuperfluités d’un
peuple riche, il eft naturel qu’ils aient profpéré à
cette époque, fur- tout pendant les règnes de Charles V
& de François Ier. Non-feulement tous deux aimoient
v & encourageoient la mufique , mais tous deux me-
noient une vie errante. Ils vivoient moins dans leurs
capitales qu’aille,urs, & les arts les fuivoient par-tout.
- ^era m0!?s étonné du grand nombre de muficiens
que produifirent les Pays-Bas> fi l’on fe rappelle que
Bruxelles , Anvers , Mons , Cambray , &c. furent
fouvent lè féjour de ces princes magnifiques.