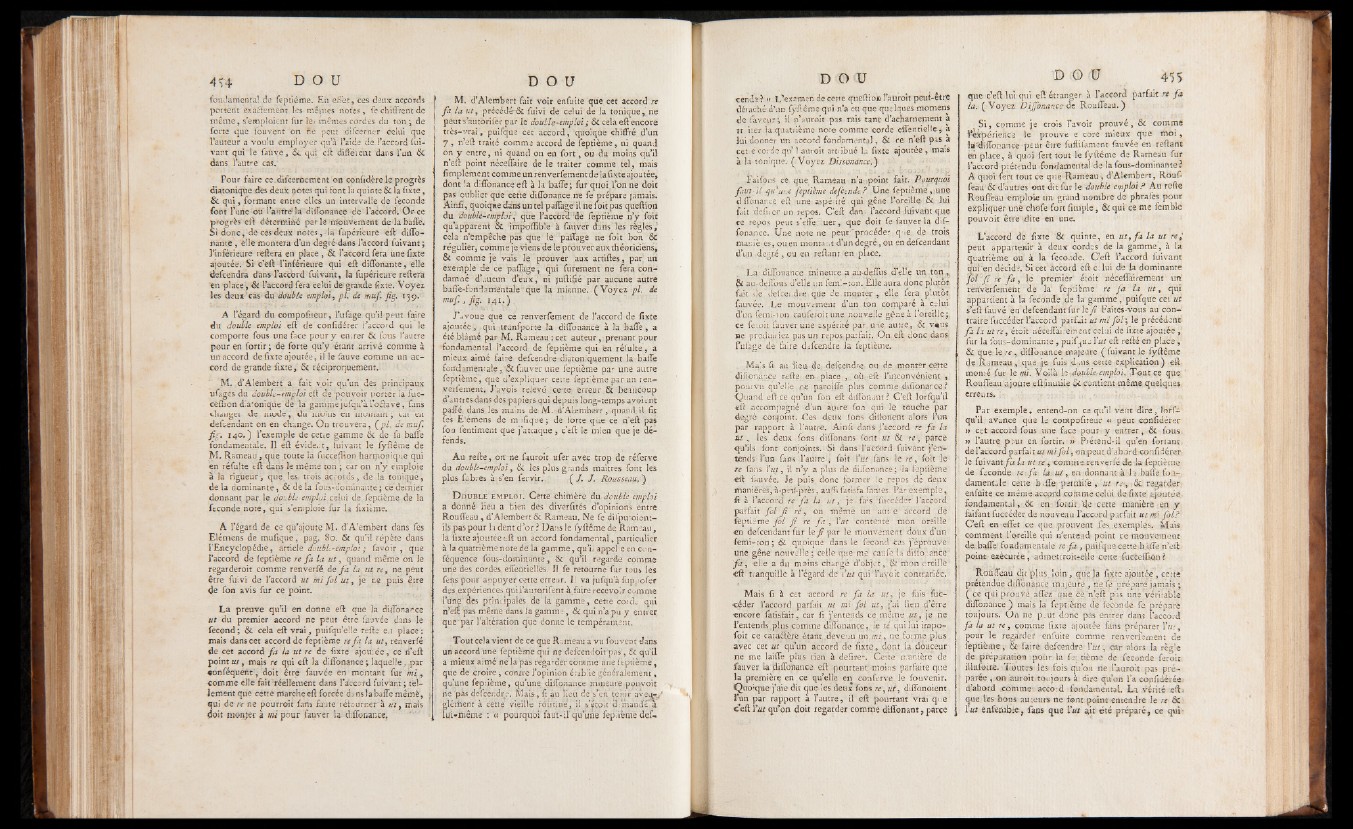
fondamental de feptième. En effet , ces deux accords
portent exactement les mêmes notes, fe chiffrent de
même, s’emploient fur le* mêmes cordes du ton,: de
forte que fou vent on ne peut difcerncr celui que
l’auteur a voulu employer qu’à l’aide de.l’accord fui-
v.ant qui le faûve, & qui'eft diffeient dans l’un &
dans l’autre cas.
Pour faire ce.difcernement on çonfidère le progrès
diatonique des deux potes qui font la quinte & la fixte,
& qui, formant entre elles un intervalle de fécondé
font l’une ou l’aUtteMâ diffonance de l’accord. Or-ce
progrès eft déterminé par lô mouvement de la baffe.
Si donc, decèsdeux notes,-là-fopérièure eft diffo-
nante , èllè montera d’un degré dans l’accord fuivant ;
l ’inférieure reftera en place, & l’accord fera une fixte
ajoutée. Si c’ëft l’inférieure qui eft diffonante, elle
defeendra dans l’accord fuivant, la fupérieure reftera
en place, & l’accord fera celui de- grande fixte. Voyez
les deux ' cas du double emploi, pl. de muf, fig. 139.'
A l’égard du compofiteur, lîufage qu’il peut faire
du double emploi eft de confidérer l’accord qui le
comporte fous une face pour y encrer & fous l’autre
pour en fortir ; de forte qu’y étant arrivé comme à
un accord de fixte ajoutée, il le fauve comme un accord
de grande fixte, & réciproquement.
M. d’Alembèrt a fait voir qu’un des principaux
lifàgès du double-emploi eft de'pouvoir porter la fuc-
cèftion dia'oniqûe’de la gammejufqu’à l’oélave, fans
changer de mode, du moins en montant; car en
defe-endant on en change. On trouvera, {pl. de muf.
fig. 140.) l’exemple de cetee gamme & de fa baffe
fondamentale. Il eft évide/.t, fuivant le fyftême de
M. Rameau , que toute ta fucceffion harmonique qui
en réfulte e f t ' dans le même ton ; car on n y emploie
à la rigueur, que.les, trois accords, de la tonique,
de la dominante, & de la fous-dominante ; ce dernier
donnant par, le double-emploi,celui de,-feptième de la
féconde note, qui s’emploie fur la fixième.
A l’égard de ce qu’ajoute M. d’A'embert dans fes
Elémens de mufique, pag. 80. & qu’il répète dans
l’Encyclopédie, article double-emploi ; (avoir , que
l’accord de feptième re fa la u t , quand même on le
regarderait comme renverfé de y» la ut re9 ne peut
être fuivi de l’accord ut mi fo l ut, je r.$ puis |:re
de fon avis fur ce point.
La preuve qu’il en donne eft que la diffonarce
u t du premier accord ne peut être fauvée dans le
fécond; & cela eft vrai, puifqu’elle refte en place:
mais dans cet accord de-feptième re fa. la ut, renverfé
de cet accord fa la ut re de fixte ajoutée, cé îî’eft
point u t , mais re qpi eft la diffonance ; laquelle, par
«onféquent , doit être fauvée en montant fur tni,,
comme elle fait 'réellement dans l’accord fuivant ; tellement
que cette marche eft forcée dans labaffe mêmè,
qui de re ne pourrait fans faute réfournef à ut, mais
doit monter à mi pour fauver la diffonance.
M. d’Alembert fait voir enfuite que cet accord re
fa la ut, précédé-'& fuivi de celui de la tonique, ne
peuts autorifer par le double-emploi ; & cela eft encore
très-vrai, puifque cet accord, quoique chiffré d’un
7 , n’eft traité comme accord de feptième, ni quand
on y entre, ni quand on en for t, ou du moins qu’il
n’eft point néceffaire de le traiter comme tel, mais
Amplement comme un renverfement de la fixte ajoutée»
dont la diffonance eft à la baffe; fur qupi l’on ne doit
pas oublier que cette diffonance ne fe prépare jamais.
Ainfi, quoique dans un tel paffage il ne loit pas queftiort
du double-emploi,' queTacçérd ‘de feptième n’ÿ foit
qu’apparent & irnpoffibîe à fauver dans lès règles^
cela n’ëmpêche pas que le paffage ne foit bon &
régulier, comme je viens de le prouver aux théoriciens 9
& comme je vais le prouver aux artiftes, par; uni
exemple de ce paffage , qui furement ne fera condamné
d’aucun d’eux, ni juftifié par aucune autre
baffe-fondamentale que la mienne. (V o y e z pl. de
J’avoue que cè renverfement de l’accord de fixte
ajoutée, qui trànfporte la diffonance à la baffe, a
été blâmé par M. Rameau: cet auteur,: prenant pour
fondamental l’accord de feptième qui en réfulte , a
mieux aimé faire defeendre diatoniquement la baffe
fond amentale, & fauver une feptième par une autre
feptième , que d’expliquer cette feptième par un ren-
verfement. J’avois relevé ce*te, erreur & beaucoup
d’autres dans des papiers qui depuis long-temps a voient
pâffé dans.les mains de. M. d’Alembert, quand, il fit
fes Elémens de m ifique; de forte que ce n’eft pas
fon fentiment que j’attaque , c’eft le mien que je défends.
Au refte, pmne fauroit ufer avec trop de réferve
du double-emploi, & les plus grands maîtres font les
plus fobres à s’en fervir. (ƒ . J. Rousseau,}
D ouble emploi. Cette chimère du double emploi
a donné lieu a bien des diverfités d’opinions entre
Rouffeau, d’Alembert & Rameau. Ne fe difpu raient-
ils pas pouT y dent d’or ? Dans le fyftême de Rameau,
la fixte ajoutée eft un accord fondamental, particulier
à la quatrième note dé la gamme, qu’ii appel e en con-
féquence fous-dominante , & qu’il regarde comme
une des cordes, effehtiell'é's. Il fe retourne fur tous les
fehs pour appuyer cette erreur. I-: va jufqu a fuppofer
des .expériencesquii’autarifent à faire recevoir comme
l’ilne'des principales de la gamme, cette cofdi; qui
n’êft;pas même dans la gamme, & qui n’a pu y entrer,
que'pâr l’altération que donne le tempérament.
Tout cela vient de ce que Rsme.au a vu fou vent dans
un accord une feptième qui ne defeendoit pas;, & qu’il
a mieux aimé né la pas regarder comme n ne feptième,
que de .croire, contre l’opinion établie généralement,
qu’une feptième, qu’une diffonance mfoçure pouyoit
ne "pâs défc'endrr. Mais-, fi au lieu devs’èn tenir’aveq-p
gléihent à cette vieille routine, îl s.’étpit d:\rnandTa
lui-même : '« pourquoi faut-il qu’une fepüènïé defcendï
f »> L'examen de cette queftiou Faiiroit peut-être
détaché d’un fyftême qui n’a eu que quelques momens
de faveur; il n’auroit pas mis tant d’acharnement a
tr r.er la quatrième note comme corde effentielie, a
lui donner un accord fondamental, & ce n’eft pas a
cet é corde qu 1 auroit attribué la fixte ajoutée, mais
à la tonique. ( Voyez Dissonance.}
. Faifons ce que Rameau n’appoint Pourquoi
faut-U ■ qtru.’ie feptième defeende? Une feptième, »une
d ffonareg eft-une aspérité qui gêne l’oreille; 8c lui
fait defirer un repos. C’eft dan-, l’accord fuivant que
ce repos peut s’effeefuer, que doit fe fauyer la. dif-,
fonance. Une r\ote ne peut'procéder que., de trois
manières, ou en montant d’un degré, ou en descendant
d’un -degré. ou en reftanr en place.,
La diffonance mineure a aq-deffus d’elle un .ton,,,
& aurdeffous d’elle un femi-ton. Elle aura donc plutôt
fuk c|e defceudie . que de mqnter , elle fera plutôt
fauvée.. Le mopvcmenr d’un ton comparé à celui
d’un femi-ton caüferoit une, nouvelle gêne à l’oreüle ;
ce feiolt. fauver une aspérité par, une autre,, & v«us
ne produiriez pas un repos parfait. On. eft donc dans.
fufage de faire defeendre. la feptième.
. Mais fi au lieu» de-deffçehdre. ou de monter cette
diffonance refte .en.. .place , y oh .-eft- rinconyénient ,
pourvu qu’elle ne parojffe plus c0mme .difionar.ee?
’Quand eft-ce qu’un fon eft diffonant ? C’eft lorfqu’il
eft accompagné d’un adiré fon qui lé touche par
degré conjoint. Ces deux fon s difibnent alors l’un
par rapport à l'autre. Ainfi dans- J’accord re fa la
tit , les deux fons diffonans font ut & re, parce
qu’ils font conjoints. Si dans l’accOrd fuivant j’entends
l’un fans l ’aUtre’ji foit Tilt fans le ré, foit le
re fans Y ut, il n’y a plus de diffonance; la feptième
eft lauvée. Je puis donc former le repos de deux
manières,-a*pnf-pVès, auffi fatisfa fautes. Par exemple,
fi a l’accord' re- fa la ut,- je . fa;s'!fuccéder l’accord
parfait f c l j î rë, on même un luit- e accord de
feptième fol f i re f a ’, Yut contenté mon oreille
•en defeendant fur le f i par le mouvement doux d’un
■ femi-ton ; & .quoique dans le fécond cas j’éprouve
une gêne nouvelle; celle tjne me caufe la diffonance'
fa , 'elle a du moins chargé d’objet, & mon oreille
•eft tranquille à l’égard -de' Yut qui l’ayok contrariée.
Mais fi à cet accord re fa la ut, je fais fuc-
céder l’accord parfait m mi fol u t,,j’ai lieu d’être
-encore fatisfait, car fi j’entends ce meme ut, je ne
l’entends plus comme diffonance,, le ri qui lui irnpo-
foit ce caractère étant'devenu un mi, ne.forrne plus
avec cet ut qu’un accord de fixte, dont la douceur
ne me laiffe plus rien à de tire % Cette''manière de
fauver la diffonance eft pourtant moins parfaite que
la première en ce qu’elle en conferve.le fouvenir.
Quoique j’aie dit que les deux fofis re, ui, diffonoient
îun par rapport à l’autre, il eft pourtant vrai que
c’eft Y ut qu’on doit regarder comme diffonant, parce
que c’eft lut-qui eft" étranger à l’accord parfait re fa
la. (Voyez Dijfonanccàt Rouffeau.)
Si, comme je crois favoir prouvé, 8c comme
Pexpériefic'e le prouve e core mieux que moi,
lal^iffonànce peur être fuffifament fauvée en reftant
ën place, à quoi fert tout le fyftême de Rameau fur
l’accord prétendu fondamental de la fous-dominante ?
A quèi/fert tout ce que Rameau, d’Alembert, Rouffeau
& d’autres ont dit fur le -double emploi ? Au refte
Rouffeau emploie un grand nombre de phrafes pour
expliquer unè chofe fort fimple, & qui ce me femble
pouvoit être 'dite en une.
L’accord dé fixte & quinte, en ut, fa la ut re9
peut appartenir à deux cordes de la gamme, à la
quatrième ou à la fecoade. C’eft l’accord fuivant
(fuï en décide. Si cet accord èft effui de la dominante
fol f i re fa , le premier' étoit néceffairement un'
renverfement de la feprième re fa la ut, qui
appartient à la fécondé de la gamme, püifqüe cet ut
s’eft fauvé en defeendant fur le fi Faites-vous au contraire
foccéder l’accord parfffr ut mi fol', lé précédent
fa la ut re, étoit néceffairement celui de fixte ajoutée ,
fur la fous-dominante, puiffjue Y ut eft refté en place,'
& que le , diffonance majeure (fuivant le fyftême
de Rameau, que je fuis, d ais, cette explication ) eft-
monté fur le mi. Voilà le--double.-emploi. Tout ce que.
Rouffeau ajoute eûânutile ^.-.contient même quelques
erreurs:.
Par exemple, entend-on ce qu’il veut dire, lorf-
qu’il avance que le compofiteur « peut confidérer
» cet accord fous une face pour y entrer, & fous.
» l’autre p:-ur en fortir. » Prétend-il qu’en for tant,
de l’accord parfait«/ mi fol, onpeut.d’abord confidérer
le fuivant fa la ut re\ -comme.renverfé de la feptième
de fécondé re • fa la ui , en ; donnant à l a baffe fon-.
damentale cette baffe permtfe , ut re-, ,8c. regarder
enfuite ce mêmeaccord .coinme celui de fixte ajoutée,
fondamental , .& en fortir 'de cette manière en y
faifant foccéder. de nouveau l’accord parfait ut mi fol?'
C’eft en effet ce que. prouvent fes. .exemples. Mais
comment l’oreille qui n’entend; point ce mouvement
de baffe* fondamentale re fa , puifque cette:b;i.ffe n’eft
point exécutée, admettroit*elle cette focceflion ?
Roüffeaü dit plus. loin, que la fixte ajoutée, cette
prétendue diffonance majeure , ne le préparé jamais.;
( ce qui prouvé, affez^çjue ce. n’eft pas une yérirable
diffonânee ) mais la feptième cle fécondé fe prépare
toujours. On ne peut donc pas entrer dans l’accord
fa la ut re, comme fixte ajoutée fans préparer 1’//;,
pour le regarder enfuite comme renverfement de
feptième , & faire; defeendre 1’«/, car alors la règle
de. préparation poiir.la fo; tième de fécondé feroit
illufoiré. Foutes; les -fois qu’on ne.l’aurolt. pas préparée
*;Giî auroit toujours à; dire qu’on l’a copfidérée
d’abord .comme' accord fondamental. La Vérité efti
que les bons auteurs ne font point entendre le re ÔC
Y ut enfembie, faas que Y ut ^it été préparé, ce qui