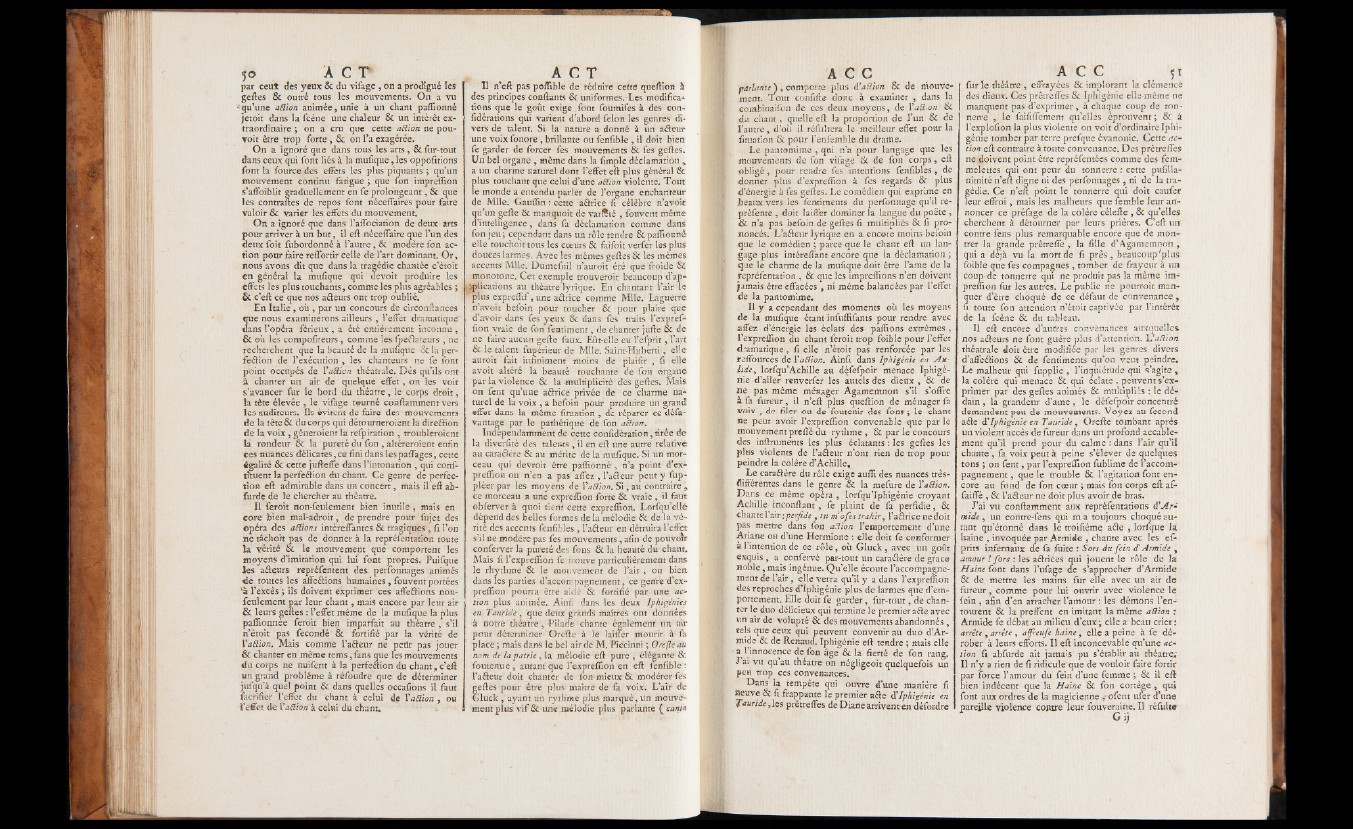
5 0 À CT
par ceut des yeux & clu vifage , on a prodîgué les
geftes 8c outré tous les mouvements. On a vu
■ qu’une a (lion animée, unie à un chant paffionné
jetoit dans la fcène une chaleur & un intérêt extraordinaire
; on a cru que cette aflion ne pou-
roit être trop forte , & on l’a exagérée.
On a ignoré que dans tous les ans, & fur-tout
dans ceux qui font liés à la mufique, les oppofitions
font la fource des effets les plus piquants ; qu’un
mouvement continu fatigue ; que fon impreffion
s’affoibüt graduellement en fe prolongeant, 8c que
les contraires de repos font néceffaires pour faire
valoir 8c varier les effets du mouvement.
On a ignoré que dans l’affociation de deux arts
pour arriver à un but, il eft néceffaire que l’un des
deux foit fubordonné à l’autre, & modère fon action
pour faire reffortir celle de l’art dominant. Or,
nous avons dit que dans la tragédie chantée c’étoit
en général la mufique qui devoit produire les
effets les plus touchants, comme les plus agréables ;
Sc c’eft ce que nos afteurs ont trop oublié.
En Italie , où , par un concours de circonftances
que nous examinerons ailleurs , l’effet dramatique"
dans l’opéra férieux , a été entièrement inconnu ,
& où les compofiteurs, comme les fpeélateurs , ne
recherchent que la beauté de la mufique 8c la perfection
de l’exécution , les chanteurs ne fe font
point occupés de Yaflion théâtrale. Dès qu’ils ont
à chanter un air de quelque effet, on les voit
s’avancer fur le bord du théâtre, le corps droit,
la tête élevée , le vifage tourné conftamment vers
les auditeurs. Ils évitent de faire des mouvements
de la tête & du corps qui détoumeroient la direction
de la voix , gêneroient la refpiration , troubleroient
la rondeur 8c la pureté du fon, altéreroient enfin
ces nuances délicates, ce fini dans les paffages, cette
égalité & cette jufteffe dans l’intonation , qui conf-
tîtuent la perfection du chant. Ce genre de perfection
eft admirable dans un concert, mais il efl ab-
furde de le chercher au théâtre.
Il feroit non-feulement bien inutile j mais en
core bien mal-adroit, de prendre pour fujet des
opéra des avions intéreffantes & tragiques , fi l’on
ne tâchort pas de donner à la représentation toute
la vérité 8c le mouvement que comportent les
moyens d’imitation qui lui font propres. Puifque
les aCteurs repréfentent des perfonnages animés
de toutes les affeCtions humaines, fouvent portées
à l’excès ; ils doivent exprimer ces affeCtions non-
feulement par leur chant, mais encore par leur air
& leurs geftes : l’effet même de la mufique la plus
pafîîonnee feroit bien imparfait au théâtre, s’il
n’êtoît pas fécondé «8c fortifié par la vérité de
Yaflion. Mais comme l’aCteur ne petit pas jouer
6c chanter en même tems, fàns que les mouvements
du corps, ne nuifent à la perfection du chant, c’eft
un grand problème à réfoudre que de déterminer
jufqu’à quel point & dans quelles occafions il faut
Sacrifier l’effet du chant à celui de Y a f l i o n ou
l’effet de Yaflion à celui du chant*
A c T
Il n’eft pas poffible de réduire cette queftion à
des principes confiants 8c uniformes. Les modifies*
fions que le goût exige font foumifes à des con-
fidérations qui varient d’abord félon les genres divers
de talent. Si la nature a donné à un adèur
une voix fonore, brillante ou fenfible , il doit bien
fe garder de forcer fes mouvements 8c fes geftes.
Un bel organe , même dans la fimple déclamation >
a un charme naturel dont l’effet eft plus général &
plus touchant que celui d’une aflion violente. Tout
le monde a entendu parler de l’organe enchanteur
de Mlle. Gauffin : cette aChiee fi célèbre n’avoit
qu’un gefte 8c manquoit de varftté , fouvent même
d’intelligence, dans fa déclamation comme dans;
fon jeu; cependant dans un rôle tendre 8c paffionné
elle touchoit tous les coeurs 8c faifoit verfer les plus
douces larmes. Avec les mêmes geftes 8c les mêmes,
accents Mlle. Dumefml n’auroit été que froide 8c
monotone. Cet exemple trouveroit beaucoup d’ap-
Splications au théâtre lyrique. En chantant l’air le
plus expreflif, une a&rice comme Mlle. Laguerre
n’avoit befoin pour toucher 8c pour plaire que
d’avoir dans fes yeux 8c dans fes traits l’expref*
fion vraie de fon fentlment, de chanter jufte 8c de
ne faire aucun gefte faux. Eût-elle eu l’efprit, l’art
8c le talent fupérieur de Mlle. Saint-Huberti, elle
auroit fait infiniment moins de plaifir , fi elle
avoit altéré la beauté touchante de fon organe
par la violence 8c la .multiplicité des geftes. mais
on fent qu’une adlrice privée de ce charme naturel
de la voix , a befoin pour produire un grand
effet dans la même fituation , de réparer ce défa-
vantage par le pathétique de. fon aflion.
Indépendamment de cette considération , tirée de
la diverfité des talents , il en eft une autre relative
au caraélere 8c au mérite de la mufique. Si. tin morceau
qui devroit être paffionné', n’a point d’ex-
preffion ou n’en a pas affèz , Fadeur peut y fup-
pléer par les moyens de Yaflion. S i, au contraire 9
ce morceau a une expreffion forte 8c vraie , il faut
obferver à quoi tient cette expreffion; Lorfqu’ellê
dépend des belles formes de la mélodie 8c de la vérité
des accents fenfibles., l’aâeur en détruira l’effet
s’il ne modère pas fes mouvements, afin de pouvait
conferver la pureté des fons 8c la beauté du chant.
Mais fi l’expreffion fe trouve particulièrement dans
le rhythme 8c le mouvement de l’air , ou bien
dans les parties d’accompagnement, ce genre d’ex-
preffion pourra être aidé 8c fortifié par une action
plus animée. Ainfi dans les deux Iphigénie?
en Tauridê ', que deux grands maîtres ont données
à notre théâtre, Pilade chante également un ait
peur déterminer Orefte à le laitier mourir àr fk
place ; mais dans le bel air de M. Piccinni ; Orefte au
nom de la patrie, la mélodie eft pure , élégante 8c
foutentie, autant que l’expreffion en eft fenfible :
Fa&eur doit chanter de fon mieux 8c modéref-fes
geftés pour être plus maître de fa voix. L’air de
Gluck , ayant un rythme plus marqué, tin meuve1-
ment plus, vif 8c une mélodie plus parlante [conte
a c c
parlante) , comporte plus (Yaflion Sc de mouvement.
Tout confifte donc à examiner , dans la
combinaifon de ces deux moyens, de Yaflion 8c
du chant, quelle eft la proportion de l’un 8c de
l’autre, d’où il réfultera le meilleur effet pour la
fituation 8c pour l’enfemble du drame.
Le pantomime , qui n’a pour langage que les
mouvements de fon vifage 8c de fon corps, eft
•obligé, pour rendre fes. intentions fenfibles, de
donner plus d’expreffion a fes regards 8c plus
d’énergie à fes geftes. Le comédien qui exprime en
beaux vers les femiments du perfonnage qu’il repréfente
, doit laiffer dominer la langue du poète ,
6c n’a pas befoin de geftes fi multipliés 8c fi prononcés.
L’a&eur lyrique en a encore moins befoin
que le comédien ; parce que le chant eft un langage
plus intéreffant encore que la déclamation ;
que le charme de la mufique doit être l’ame de la
représentation , 8c que les impreffions n’en doivent
jamais être effacées , ni même balancées par l’effet
de la pantomime.
Il y a cependant des moments où les moyens
de la mufique étant infuffifants pour rendre avec
affez d’énergie les éclats des paillons extrêmes ,
Fexpreffion du chant feroit trop foible pour l’effet
dramatique, fi elle n’étoit pas renforcée par les
reffources de Yaflion, Ainfi dans Iphigénie en Au-
Ude, lorfqu’Achille au défefpoir menace Iphigénie
d’aller renverfe^ les autels des dieux, 8c de
ne pas même ménager Agamemnon s’il s’offre
à fa fureur, il n’eft plus queftion de ménager fa
voix , de filer ou de foutenir des fons ; le chant
ne peut avoir Fexpreffion convenable 'que par le
mouvement preffé du rythme , 8c par le concours
des inftruments les plus éclatants : les geftes les
plus violents de l’a&eur n’ont rien de trop pour
peindre la colère d’Achille,
Le cara&ère du rôle exige auffi des nuances très-
fliftérentes dans le genre 8c la mefure de Yaflion.
Dans ce même opéra , lorfqu’Iphigénie croyant
Achille inconftant , fe plaint de fa perfidie, 8c
chante l’air : perfide , tu m ofes trahir, l’aélrice ne doit
pas mettre dans fon aflion l’emportement d’une
Ariane ou d’une Hermione : elle doit fe conformer
a l’intention de ce .rôle, où Gluck, avec un goût
exquis , a confervé par-tout un caractère de grâce
noble, mais ingénue. Qu’elle écoute l’accompagnement
de l’air, elle verra qu’il y a dans l’expreffion
des reproches d’Iphigénie plus de larmes que d’emportement.
Elle doit fe garder, fur-tout, de chanter
le duo délicieux qui termine le premier afte avec
un air de volupté 8c des mouvements abandonnés ,
tels que ceux qui peuvent convenir au duo d’Ar-
mide 8c de Renaud. Iphigénie eft tendre ; mais elle
a, Vinnoce°ce de fon âge 8c la fierté de fon rang.
J ai vu qu au théâtre on négligeoit quelquefois un
peu trop ces convenances.
Dans la tempête qui ouvre d’une manière fi
neuve 8c fi frappante le premier a&e dû Iphigénie en
"fauride, les prêtreffes de Diane arrivent en défordre
A C C 51
Ifùr le théâtre , effrayées 8c implorant la clémence
des dieux. Ces prêtreffes 8c Iphigénie elle-même ne
manquent pas d’exprimer , à chaque coup de tonnerre
, le faififfement qu’elles éprouvent ; 8c à
l’explofion la plus violente on voit d’ordinaire Iphigénie
tomber par terre prefque évanouie. Cette action
eft contraire à toute convenance. Des prêtreftes
ne doivent point être repréfentées comme des femmelettes
qui ont peur du tonnerre : cette pufilla-
nimité n’eft digne ni des perfonnages , ni de la tragédie.
Ce n’eft point le tonnerre qui doit caufer
leur effroi, mais les malheurs que iemble leur annoncer
ce préfage de la colère célefte , 8c qu’elles
cherchent à détourner par leurs prières. C ’eft un
contre-fcns plus remarquable encore que de montrer
la grande prêtreffe , la fille d’Agamemnon,
qui a déjà vu la mort de fi près , beaucoup 'plus
foible que fes compagnes , tomber de frayeur à un
coup de tonnerre qui ne produit pas la même im*
preflion fur les autres. Le public ne pourroit manquer
d’être choqué de ce défaut de convenance ,
fi toute fon attention n’étoit captivée par l’intérêt
de la fcène 8c du tableau.
Il eft encore d ’aufres convenances auxquelles
nos aéleurs ne font guère plus d’attention. \d aflion
théâtrale doit être modifiée par les genres divers
d’aftèéHons 8c de fentiments qu’on veut peindre*
Le malheur qui fupplie , l’inquiétude qui s’agite ,
la colère qui menace 8c qui éclaté , peuvent s’exprimer
par des geftes animés 8c multipliés : le dédain
, la grandeur d’ame, le défefpoir concentré
demandent peu de mouvements. Vo yez au fécond
aéle d! Iphigénie en Tauride , Orefte tombant après
un violent accès de fureur dans un profond accablement
qu’il prend pour du calme : dans l’air qu’il
chante , fa voix peut à peine s’élever de quelques
tons ; on fen t, par Fexpreffion fublime de l’accompagnement
, que le trouble 8c l’agitation font en*
core au fond de fon coeur ; mais fon corps eft af-
faiffé , 8c Faâeur ne doit plus avoir de bras.
J’ai vu conftamment aux repréfentations Y Ar mide
, un contre-fens qui m a toujours choqué autant
qu’étonné dans le troifième aéle , lorfque la
haine , invoquée par Armide , chante avec les ef-
prits infernaux de fa fuite : Sors du fein £ Armide ,
amour ! fors : les a&rices qui jouent le rôle de la
Haine font dans l’ufage de s’approcher d’Armide
8c de mettre les mains fur elle avec un air de
fureur, comme pour lui ouvrir avec violence le
fein , afin d’en arracher l’amour : les démons l’entourent
8c la preffent en imitant la même aflion ;
Armide fe débat au milieu d’eux ; elle a beau crier :
arrête , arrête , affreufe haine, elle a peine à fe dérober
à leurs efforts. Il eft inconcevable qu’une action
fi abfurde ait jamais pu s’établir au théâtres
Il n’y a rien de fi ridicule' que de vouloir faire fortir
par force l’amour du fein d’une femme ; 8c il eft
bien indécent que la Haine 8c fon cortège , qui
font aux ordres de la magicienne ,• ofent ufor d’une
pareille violence contre leur fouveraine. Il réfulte