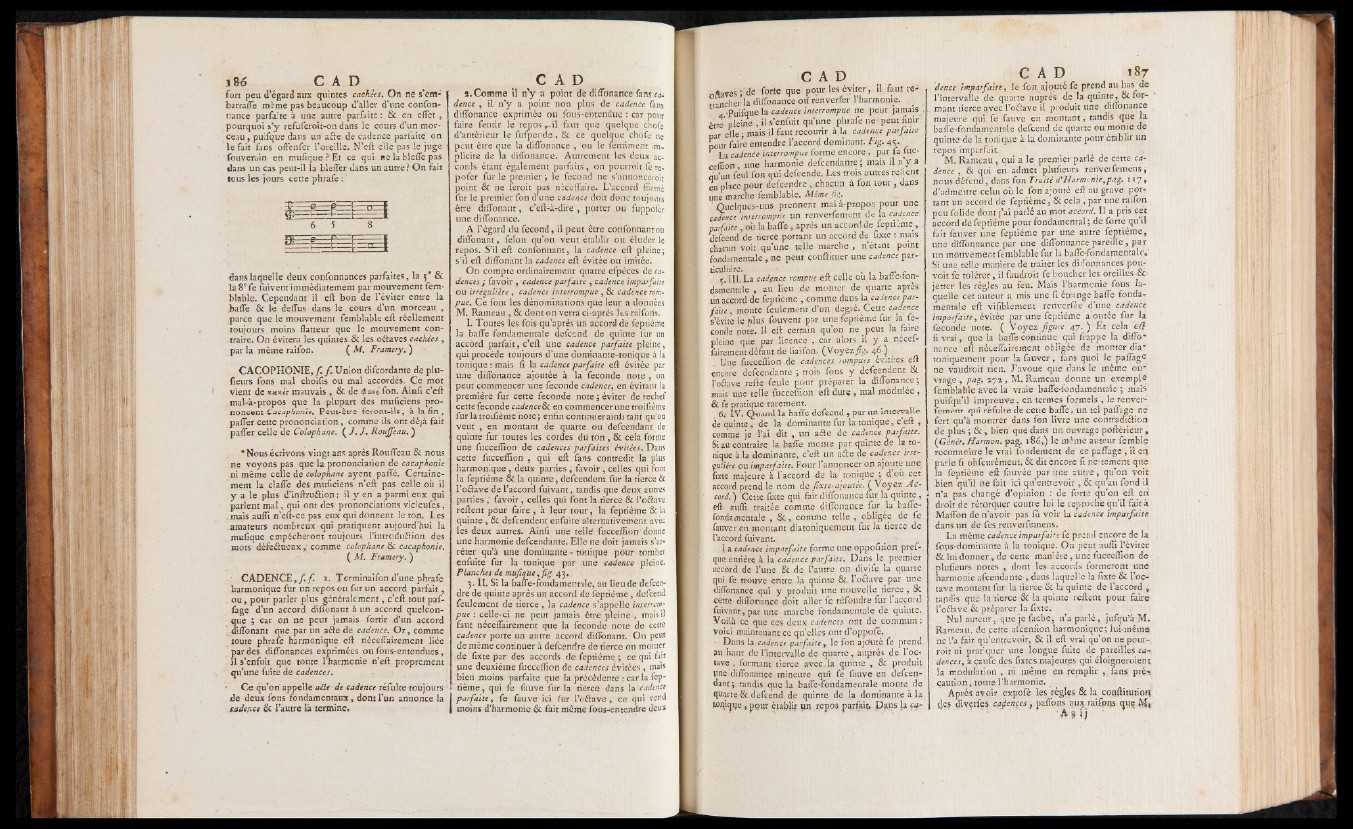
i C A D
fort peu d’égard aux quintes cachets. On rie s’em- I
barraffe meme pas beaucoup d’aller d’une confon-
nance parfaite a une autre parfaite : & en e ffet,
pourquoi s’y refuferoit-on dans le cours d’un morceau
, puifque dans un'afre de cadence parfaite on
le fait fans offenfer l’oreille. N’eft elle pas le juge
fouverain en mufique ? Et ce qui He la bleffe pas
dans un cas peut-il la bleffer dans un autre? On fait
tous les jours cette phrafe
i—
6 5 8
dans laquelle deux confonnances parfaites, la 5e &
la 8efe luivent immédiatement par mouvement fem-
blable. Cependant il eft bon de l’éviter entre la
baffe & le de (Tus dans le cours d’un morceau ,
parce que le mouvement femblable eft réellement
toujours moins flatteur que le mouvement contraire.
On évitera les quintes & les oéfaves cachées ,
par la même raifon. ( M. Framery. )
CACOPHONIE, f . f Union difcordante de plufieurs
fons mal choifis ou mal accordés. Çe mot
vient de xaxiç mauvais , & de Qmé fon. Ainft c’eft
mal-à-propos que la plupart des muficiens prononcent
Cacaphonie. Peut-être feront-ils, à la fin,
pafler cette prononciation, comme ils ont déjà fait
pafler celle de Colophane. ( / . / . RouJJeau. )
* Nous écrivons vingt ans après Rouffeau & nous
ne voyons pas que la prononciation de cacaphonie
ni même celle de colophane ayent paffé. Certainement
la clafl*e des muficiens n’eft pas celle où il
. y a le plus d’inftru&ion : il y en a parmi eux qui
parlent mal, qui ont des* prononciations vicieufes,
.mais aufli n’eft-ce pas eux qui donnent le ton. Les
amateurs nombreux qui pratiquent aujourd’hui la
mufique empêcheront toujours l’introdu&ion des
mots défe&uecx, comme colophane 6c cacaphonie.
( M. Framery. )
CAD EN C E , ƒ f . 1. Terminaifon d'une phrafe
harmonique fur un repos ou fur un accord parfait,
o u , pour parler plus généralement, c’eft tout paf-
fage d’un accord diffonânt à un accord quelconque
; car on ne peut jamais fortir d’un accord
diffonânt que par un aâe de cadence. O r , comme
toute phrafe harmonique eft néceflairement liée
par des diffonances exprimées ou fotis-enteridues,
il s’enfuit que toute l’harmonie n’eft proprement
qu’une fuite de cadences.
r Ce qù’ori appelle aEle de cadence réfui te toujours
. de deux fons fondamentaux ., dont l’un annonce la
tadejict & l ’autre là termine.
C A D
a. Comme il n’y a point dé diffonance fans ri-
dence , il n’y a point non plus de cadence fans
diffonance exprimée ou fous-entendue : car pour
faire fentir le repos ,.i l faut que quelque chofe
d’antérieur le fufpende , & c e . quelque chofe ne
peut être que la diffonance , ou le fentiment implicite
de la diffonance. Autrement les deux accords
étant également parfaits , on pourroit fe re-
pofer fur le premier ; le fécond ne s’annonceroit
point & ne leroit pas nécefï'aire. L’accord formé
fur le premier fon d’une cadence doit donc toujours
être diffonânt, c’eft-à-dire , porter ou fuppofer
une diffonance.
A l'égard du fécond, il peut être confonnant ou
diffonânt, félon qu’on veut établir ou éluder le
repos. S’il eft conlonnant, la cadence eft pleine;
s’il eft diffonânt la cadence eft évitée ou imitée.
On compte ordinairement quatre efpèces de cadences
; favoir , cadence parfaite , cadence imparfaite
ou irrégulière , cadence interrompue , & cadence rompue.
Ce font les dénominations que leur a données
M. Rameau , & dont on verra ci-après les raifôris.
I. Toutes les fois qu’après un accord de feptième
la baffe fondamentale defeend de quinte fur ïm
accord parfait, c’eft une cadence parfaite pleine,
qui procède toujours d’une dominante-tonique à la
tonique : mais fi la cadence parfaite eft évitée par
une diffonance ajoutée à la fécondé note , on
peut commencer une fécondé cadence,.çn évitant la
première fur cette fécondé note;éviter derechef
cette fécondé cadence& en commencer une troisième
fur latroifième note; enfin continuer ainft tant qu’on
veut , en montant de quarte ou defeendant de
quinte fur toutes les cordes du ton , & cela forme
une fucceflion de cadences parfaites évitées. Dans
cette fuccefîion , qui eft fans contredit la plus
harmonique, deux parties, favoir, celles qui font
la feptième & la quinte, defeendent fur la tierce &
l’odave de l’accord fuivant,. tandis que deux autres
parties favoir, celles qui font la tierce & l’o&ave
reftent pour faire, à leur tour, la feptième &1»
quinte, & defeendent enfuite alternativement avec
les deux autres. Ainft une telle? fuccefîion donne
une harmonie defeendante. Elle ne doit jamais s’arrêter
qu’à une dominante - tonique pour tomber
enfuite fur la tonique par une cadence pleine.
Planches de mufique ,fig 43..
3. IL Si la baffe-fondamentale, au lieu de defeen-
dre de quinte après un accord de feptième, defeend
feulement de tierce, la cadence s’appelle interrompue
: celle-ci ne peut jamais être pleine-., mais il
faut néceffairement que la fécondé note de cette
cadence porte un autre accord diffonânt. On peut
de même continuer à defeendre de tierce ou monter
de fixte par des accords de feptième ; ce qui fait
une deuxième fuccefîion de cadences évitées, mais
bien moins parfaite que la précédente : car la fep-
(I tième, qui le fauve fur la tierce dans la cadence parfaite, fe fauve ici fur l’o&ave, ce qui rend
moins d’harmonie & fait même fous-entendre deux
C A D
oftave's;■ de forte que popr les éviter, il faut retrancher
la diffonance oiï renverfer l’harmonie.
a -Puifque la cadence interrompue ne p,eut jamais .
être pleine , il s’enfuit qu’une phrafe né-.peut finir"
par elle; mais il faut recourir à.U caiencc parfaite
pour faire entendre l’accord dominant. Fig. 4£.
* La cadence interrompue forme encore , par fa fuc-
ceffion, une harmonie defcèndante £ mais il n’y a
qu’un feul fon qui defeende. Les trois autres reftent
en place .pour descendre, chacun à fon tour, dans
une marche femblable. Même fig.
' Quelques-uns prennent mal à-propos pour une
cadence interrompue un renverfement de la cadence
parfaite , où la baffe | après un accord de fepiième ,
defeend de tierce portant un accord de fixte : mais
chacun voit qu’une telle marche, n’étant point
fondamentale , ne peut çonftituer une cadence par--
1 .111. La cadgncp rompue eft celle où la baffe-fondamentale
, au lieu de monter de quarte après
ün accord de.feptième , comme dans la cadence parfaite,
monte feulement d’un degré. Cette cadence
s’évite le plus fouvent par une feptième fur la fécondé
note. Il eft certain qu’on ne peut la faire
pleine que par licence;, car alors il y a néçef-
fairement défaut de liaifon. (Voyez fig. 46-) ,
Une fucceflion de cadences rompues .évitées eft
encore defeendante ; trois fons y defeendent &
j’oâave .refte feule pour préparer la diffonance;
mais une telle fucceflion eft dure , mal modulee,
& fe pratique rarement.
6i IV. Quand la baffe defeend , par un intervalle
de quinte, de la dominante fur la tonique, c’eft ,
comme je . l’ai dit , un aâ e de cadence, parfaite.
•Si au contraire la baffe monte par quinte de la tonique
à la dominante, c’eft un aéie de cadence irre-
gutiére .011 imparfaite. Four l’annoncer on ajoute une,
fixte majeure à l’accord de la/ tonique ; d’où cet
accord prend le nom d q fixte-ajoutée. (V o y e z A c cord.
) Cette ftxte qui fait diffonance fur la quinte,
eft’ aufli traitée comme diffonance fur la baffe-
fondamentale , & , comme telle , obligée de fe
fauver en montant diatoniquement fur la tierce de
l’accord fuivant. ’ ■ t - •
La cadence imparfaite forme une oppofition pref-
que entière à la cadence parfaite. Dans le premier
accord de l’une & de l’autre on divife la quarte
qui fe trouve entre la quinte & l’oélave par une
diffonance qui y produit une nouvelle tierce, &
cette diffonance doit aller fe réfoudre fur l’accord
fuivant, par une marche fondamentale de quinte.
Voilà ce que ces deux cadences ont de commun ;
voici maintenant ce qu elles ont d’oppofé,
• Dans la cadence parfaite, le fon ajo'uté fe prend
au haut de l’intervalle de quarte, auprès de Toc?
tave , formant tierce avecJa quinte , & produit
P ne diffonance mineure qui fe fauve en defeeu-.
dant ; tandis que la baffe-fondamentale monte de
quarte & defeend de quinte de la dominante à la
Pqiqqe , ppur éfablif un repos parfait. Dans la f<?-
C A D 187
àence imparfaite, le fon ajouté fe prend au bas de
l’intervalle de quarte auprès de la quinte, & for-
,. mant tierce qvec l’oélave il produit une diflbnance
majeure qui fe fauve en montant, tandis que la
baffe-fondamentale defeend de quarte ou monte de
quinte de la tonique à la dominante pour établir un
repos imparfait.
M. Rameau, qui a le premier parlé de cette cadence
, & qui en admet plufieurs renverfemens ;
nous défend , dans fon Traité d'Harmonie,pag. 1 1 7 ,
d’admettre celui où le fon ajouté efl au grave portant
un accord de feptième, & cela , par une raifon
peu folide dont j’ai parlé au mot accord. Il a pris cet
accord de feptième pour fondamental ; de forte qu’il
fait fauver une feptième par une autre feptième,
une diffonnance par une diffonnance pareille, par
un mouvement femblable fur la baffe-fondamental c»
Si une telle manière de traiter les diffopnances pou-
voit fe tolérer, il faudroit fe boucher les oreilles &
jetter les règles au feu. Mais l’harmonie fous laquelle
cet auteur a mis une ft étrange baffe fonda-.
mentale eft viftblémeut renverfée d’une cadence
imparfaite, évitée par une feptième ajoutée fur là
fécondé note. ( Voyez figure 47. ) Et cela^ e/?
fi vrai, que la baffe-continue qui frappe la diffo’
nance eft néceflairement obligée de monter dia"
toniquement pour la fauver, fans quoi le paffagô
ne vaudroit rien. J’avoue que dans le ’même ou"
vrage , pag. 272., M. Rameau donne un exempl®
femblable avec la vraie baffe-fondamentale; mais
puifqu’il improuve, en termes formels , le renver- -
fement qui réfulte de cette baffe, un tel paflage ne
1 fert qu’à montrer dans fon livre une contradi&ion
; de plus ; & , bien que dans un ouvrage poftérieur ,
| ( Génér. Harmon. pag. 186,) le même auteur femble
reconnoître le vrai fondement de ce paffage, il erç
parle ft obfcurémeut, & dit encore fi nettement que
la feptième eft fauvée par une autre, qu’on voit
bien qu’il ne fait ici qu’entrevoir , & qu’au fond il
• n’a pas changé d’opinion : de forte qu’on eft en
droit de rétorquer contré lui le reproché qu’il fait à
Maffon de n’avoir pas fù voir la cadence imparfaite
dans un de fes renverfemens.
La même cadence imparfaite fe prend encore de la ,
fous-dominante à la tonique. On peut aufîi l’éviter
& lui donner, de cette manière, une fucceflion de
plufieurs notes , dont les accords formeront une
harmonie afeendante-, dans laquelle la ftxte & l’octave
montent fur la tierce & la quinte de l’accord ,
tandis que la tierce & la quinte reftent pour faire
l’oâave.& préparer la ftxte;
Nul auteur, que je fâche, n’a parlé, jufqu’à M.
Rameau, de cette afeenfion harmonique; lui-méme
ne i’a fait qq’en|revoir, & il eft vrai qu’on ne pour-
roit ni prafquer une longue fuite de pareilles ça-*
dences, à çanfe des ftxte s majeures qui éloigneroient
-la modulation , ni même en remplir , fans pré-s
caution, toute l'harmonie.
Après avoir expofé les règles & la conftitutiorç
([es $YÇrfes ca^ençes f paffons au?; raifons M*
' A a i j