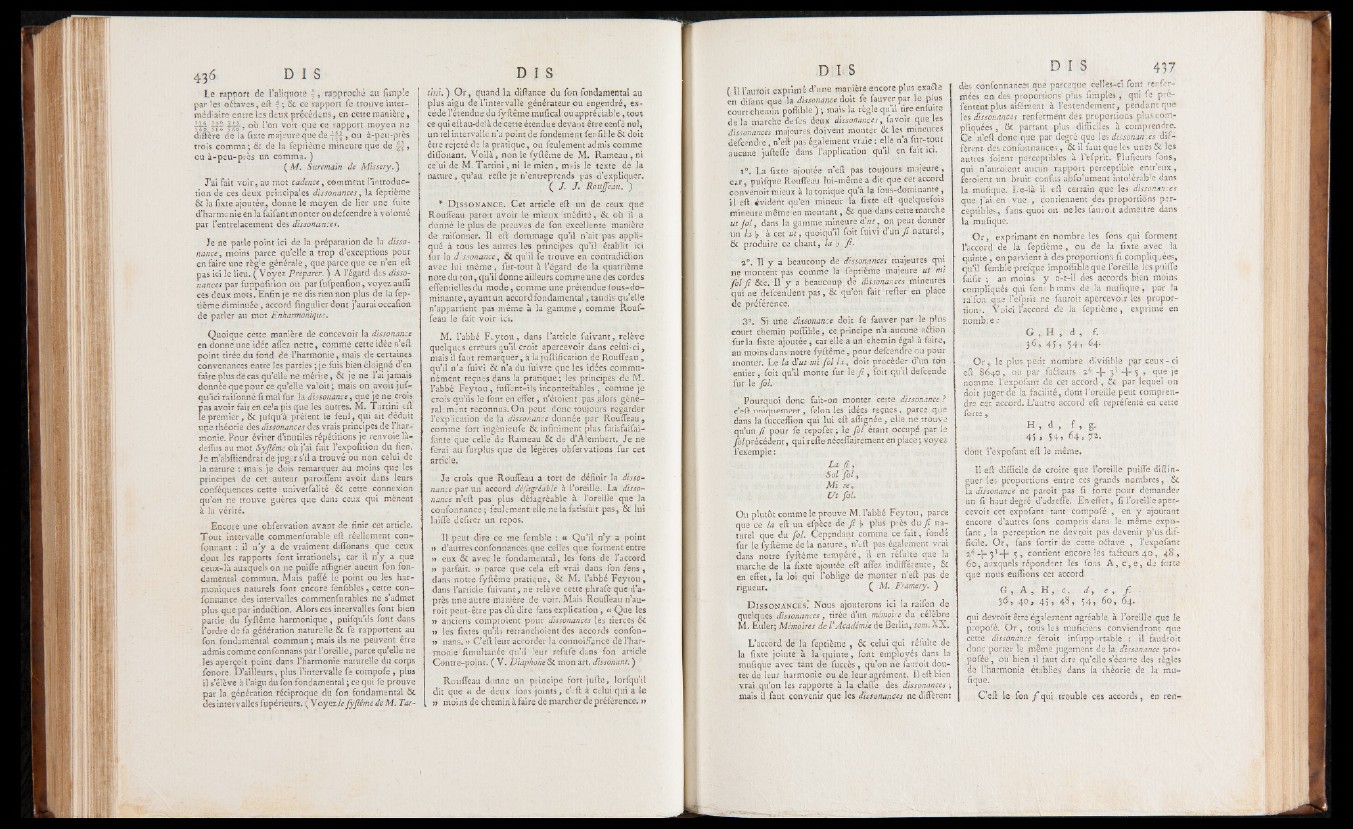
Le rapport de l’aliquote y , rapproché au {impie
par les odaves, eft y ; ÔL ce rapport fe trouve intermédiaire
entre les deux précédens, en cette manière,
I l | 1 | | m... où l’on voit que ce rapport moyen ne
diffère de la fixte majeure que de -j-f-f, ou à-peu-près
trois comma ; & de la feprième mineure que de £y,
ou à-peu-près un comma. )
( M. Suremain de Missery. )
J’ai fait voir, au mot cadence, comment l’introduction
de ces deux principales dissonances, la feptième
& la fixte ajoutée, donne le moyen de lier une fuite
d’harmonie en la faifant monter ou defcendre à volonté
par l’entrelacement des dissonances.
Je ne parle point ici de la préparation de la dissonance,
moins parce qu’elle a trop d’exceptions pour
en faire une règ!e générale, que parce que ce n’en eft
pas ici le lieu. ( Voyez Préparer. ) A l’égard des dissonances
par fuppofition ou par fufpenfion, voyez auffi
ces deux mots. Enfin je ne dis rien non plus de la feptième
diminuée, accord fingulier dont j’aurai occafion
de parler au mot Enharmonique.
Quoique cette manière de concevoir la dissonance
en donne une'idée allez nette, comme cette idée n’eft
point tirée du fond de l’harmonie, mais de certaines
convenances entre les parties ; je fuis bien éloigné d’en
faire plus de cas qu’elle ne mérite, & je ne l’ai jamais
donnée que pour ce qu’elle valoit; mais on avoit juf-
qu’ici raifonné fi mal fur la dissonance, que je ne crois
pas avoir fait en cela pis que les autres. M. Tartini eft
le premier, & jufqu’à préfent le feul, qui ait déduit
une théorie des dissonances des vrais principes de l’harmonie.
Pour éviter d’inutiles répétitions je renvoie là-
deffus au mot Syflême où j’ai fait l’expofition du fien.
Je m’abftiendrai de juger s’il a trouvé ou non celui de
la nature : mais je dois remarquer au moins que les
principes de cet auteur paroifTent avoir dans leurs
conséquences cette univerfalité & cette connexion
quon ne trouve guères que dans ceux qui mènent
à la vérité.
Encore une obfervation avant de finir cet article. ,
Tout intervalle commenfurable eft réellement con- ■
Sonnant : il n’y a de vraiment diffonans que ceux
dont les rapports font irrationels; car il n’y a que
ceux-là auxquels on ne puiffe affigner aucun fon fondamental
commun. Mais paffé le point ou lés harmoniques
naturels font encore fenfibles, cette con-
fonnance des intervalles commenfurables ne s’admet
plus que par indudion. Alors ces intervalles font bien
partie du fyftême harmonique, puifqu’ils font dans
l’ordre de fa génération naturelle & fe rapportent au
fon fondamental commun; mais ils ne peuvent être
admis comme confonnans par l’oreille, parce qu’elle ne
les aperçoit point dans l’harmonie naturelle du corps
fonore. D’ailleurs, plus l’intervalle fe compofe, plus
il s’élève à l’aigu du fon fondamental ; ce qui fe prouve
par la génération réciproque du fon fondamental &
des intervalles fupérieurs. ( Voyez le fyftême de M. Tartint.
) O r , quand la diftance du fon fondamental au
plus aigu de l’intervalle générateur ou engendré, excède
l’étendue du fyftême mufical ou appréciable, tout
ce qui eftau-deîà de cette étendue devant être cenfé nul,
un tel intervalle n’a point de fondement fenfible & doit
être rejeté de la pratique, ou feulement admis comme
diffonant. Voilà, non le fyftême de M. Rameau , ni
ce'ui de M. Tartini, ni le mien, mais le texte de la
nature, qu’au refte je n’entreprends pas d’expliquer.
( J. J. Roujfeau. )
* Dissonance. Cet article eft un de ceux que
Rouffeau paroit avoir le mieux médité, & où il a
donné le plus de preuves de fon excellente manière
de raifonner. Il eft dommage qu’il n’ait pas appliqué
à tous les autres les principes qu’il établit ici
fur la dissonance, & qu’il fe trouve en contradiction
avec lui même, fur-tout à l’égard de la quatrième
note du ton, qu’il donne ailleurs commeune des cordes
effentielles du mode, comme une prétendue fous-dominante
, ayant un accord fondamental, tandis qu’elle
n’appartient pas même à la gamme, comme Rouffeau
le fait voir ici.
M. l’abbé Feytou, dans l ’article fuivant, relève
quelques erreurs qu’il croit apercevoir dans celui-ci,
mais il faut remarquer, à la juftifi cation de Rouffeau ,
qu’il n’a fuivi & n’a du fuivre que les idées communément
reçues dans la pratique; les principes de M.
l’abbé Feytou , fuffent-ils inconteftables , comme je
crois qu’ils le font en effet, n’étoient pasxalors généralement
reconnus. On peut donc toujours regarder
l’explication de la dissonance donnée par Rouffeau,
comme fort ingénieufe & infiniment plus fatisfaifai-
fante que celle de Rameau & de d’Aîembert. Je ne
ferai au furplus que de légères obfervations fur cet
article.
Je crois que Rouffeau a tort de définir la dissonance
par un accord défagréablé à l’oreille. La dissonance
n’eft pas plus délagréable à l’oreille que la
conformance ; feulement elle ne la fatisfait pas, & lui
; laiffe defirer un repos.
Il peut dire ce me fembîe : « Qu’il n’y a point
» d’autres confonnances que celles que forment entre
» eux & avec le fondamental, les fons de l’accord
» parfait. » parce que cela eft vrai dans fon fëns ,
dans notre fyftême pratique, & M. l’abbé Feytou „
dans l’article fuivant, ne relève cette phrafe que d’après
une autre manière de voir. Mais Rouffeau n’au-
roit peut-être pas dû dire fans explication, « Que les
v anciens comptoient pour dissonances les tierces &
» les fixtes qu’ils rerranchoient des accords confon-
» nans. » C’eft leur accorder la connoiffance de l’harmonie'
fimultanée qu’il leur réfufe dans fon article
Contre-point. ( V. Diaphone & mon art. dissonant. )
Rouffeau donne un principe fort jufte, lorfqu’il
dit que « de deux fons joints, c’eft à celui qui a le
. » moins de chemin à faire de marcher de préférence. »
( U l’auroit exprimé d’une manière encore plus exade
en difant que la dissonance doit fe fauverpar le plus
court.chemin poffible ) ; mais la règle qu’il tire enfuite
de la marche defes deux dissonances, favoir quêtes
dissonances 'majeures doivent monter & les mineure«
defcendre, n’eft pas également vraie ; elle n’a fur-tout
aucune jufteffe dans l’application qu’il en fait ici.
i° . La fixte ajoutée n’eft pas toujours majeure,
car, puifque Rouffeau lui-même a dit que cet accord
convenoit mieux à la tonique qu’à la fous-dominante,
il eft évident qu’en mineur la fixte eft quelquefois
mineure même-'en montant, & que dans cette marche
ut fo l, dans la gamme mineure d ut, on peut donner
un la b à cet ut, quoiqu’il foit fuivi d’un f i naturel,
& produire ce chant, la ly . fi-
2°. Il y a beaucoup de dissonancés majeures qui
ne montent pas comme la feptième majeure ut mi
fol f i &c. Il y a beaucoup de. dissonances mineures
qui ne defeendent pas, & qu’on fait refter en plàcè
de préférence.
3°. Si une dissonance doit fe fauver par le plus
court chemin poffible, ce/principe n’a aucuné adion
fur la fixte ajoutée, car elle a un chemin égal à faire,
au moins dans notre fyftême, pour defcendre ou pour
monter. Le la d'ut mi fol la , doit procéder d’un ton
entier, foit qu’il monte fur le .f i, foit qu’il defeende
fur le fol.
Pourquoi donc fait-on monter cette dissonance ?
c’eft uniquement, félonies idées reçues, parce que
dans la fucceflion qui lui eft affignée, elle ne trouve
qu’un Jî pour fe repofer ; .le fol étantjjccupé par 1e
ƒ>ƒ précédent, qui reftenéceffairement en place; voyez
l’exemple :
La f i ,
Sol f o l ,
Mi re,
Ut f il.
Ou plutôt comme le prouve M. l’abbé Feytou, parce
que ce la eft un efpèce de f i (> plus près du ƒ naturel
que du fol. Cependant comme ce fait, fondé v
-fur le fyftême delà nature, n’eft pas.également vrai
dans notre fyftême tempéré, il en réfu’te que la
marche de la fixte ajoutée eft affez indifférente, &
en effet, la loi qui l’oblige de monter n’eft pas de
rigueur. ( M. Framery. )
D issonances! Nous ajouterons ici la raifon de
quelques dissonances , tirée d’un mémoire du célèbre
M. Euler; Mémoires de l'Académie de Berlin, tom. XX.
L’accord de la feptième , & celui qui réfulte de
la fixte jointe à la quinte, font employés dans la
mufique avec tant de fuccès , qù’on ne fauroit douter
de leur harmonie ou de leur agrément. Il eft bien
vrai.qu’on tes rapporte à la claffe des dissonances',
mais il faut convenir que les dissonances ne diffèrent
dès confonnances que pareeque celles-ci font renfermées
en des proportions plus fimples , qui fe pre-
fentent plus aifément à l’entendement, pendant que
les dissonances renferment des proportions plus compliquées
,'■ & partant-plus difficiles à comprendre.
Ce n’eft donc que par degré que les dissonances diffèrent
des confonnances, & il faut que tes unes & tes
autres foient perceptibles à l’efprit. Plufieurs fons,
qui n’auroient aucun rapport perceptible entr’eux,
feroient un bruit confus abfo'ument intoléràb’e dans
la mufique. De-là il eft certain que les dissonances
que? j'ai en vue , contiennent des proportions perceptibles
, fans quoi on ne les fauroit admettre dans
la mufique.
O r , exprimant en nombre tes fons qui forment
l’accord de la feptième, ou de la fixte avec la
quinte , on parvient à des proportions fi compliquées,
qu’il femble prefque impoffible que l’oreille tes puiffe
faifir ; au moins y a-t-il des accords bien moins
compliqués qui font bannis de la mufique, par la
ra’.fon que l’efprit ne fauroit apercevoir les proportions
Voici l’accord de la feptième, exprime en
nombre;
G , H , d , f.
, 36, 45 > 54, 64.
O r , le plus petit nombre d.vifible par ceux-ci
eft. 8640, ou par .fadeurs z6 -}- y + 5 , que je
nomme l'expofant de cet accord , & par lequel on
doit juger de la facilité, dont l’oreille peut comprendre
cet accord. L’autre accord eft repréfenté en cette
forte,
H , d 3 f , g.
45 . 54 > 6 4 ,7 1 .
dont l’expofant eft le même.
11 eft difficile de croire que l’oreille puiffe difiin-
! guer les proportions entre ces grands nombres, &
la dissonance ne paroit pas fi forte pour demander
un fi haut degré d’adreffe. En effet, fi l’oreille aper.-
cevoit cet expofant tant compofé , en y ajoutant
encore d’autres fons compris dans le même expofant
, la perception ne devr.oit pas devenir p’us difficile.
O r , fans fortir'de cette odave , l’expofant
2.6 -J- 33 -f- 5 , contient encore les fadeurs 40 , 48 ,
60, auxquels répondent tes fons A , c , e , de forte
que nous euffions cet accord
G , A , H , c , d , e y f.
36, 40, 4 5 , 48, 54, é o , Ô4.
qui devroit être egalement agréable, à l’oreille que le
propofé. O r , tous les muficiens conviendront que
cette dissonance feroit infupportqble : il faudroit
donc porter'le .même jugement de la dissonance pro-
pofée, où bien il faut dire qu’elle s’écarte des règles
de l’harmonie établies dans la théorie de la mu-
fique,
C ’eft le fon ƒ qui trouble ces accords, en ren