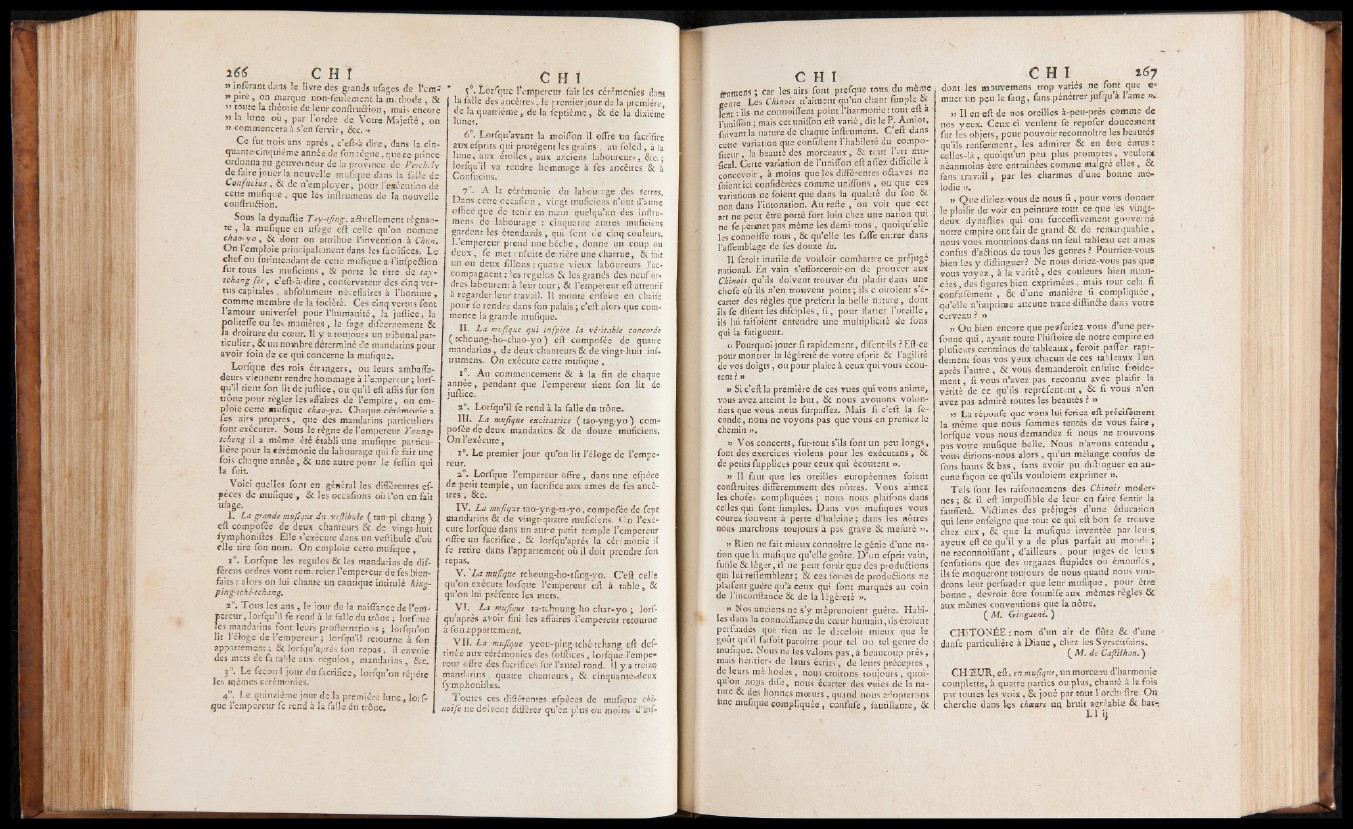
iM ch!
» inférant clans îe livre des grands ufages de Pem-
» p ire , on marque non-feulemeni la méthode , &
toute la théorie de leur conftruéfion, mai*; encore
>3 la lune où-, par l'ordre de Votre Majefté , on
» commencera à s’en fervir, &c. n
Ce fut trois ans après , c’eft-à dire, dans la cîn-
quante-cinquieme année.de fon règne, que ce prîhce
ordonna au gouverneur de la province de Petc/uly
de.faire jouer la nouvelle mufique dans la fille de
Confucius , & de n’employer, pour rexécûtion de
cette mufique, que les inftrumens de la nouvelle
conftruéfion.
Sous la dynaftie Tiy-tfing, annuellement régnante
, la mufique en ufage eft celle qu’on nomme
ckao-yo, & dont on attribue l’invention à Chun.
On l’emploie principalement dans les facrifices. Le
chef ou furintendant de cette mufique a l ’infpeÔion
fur tous les müficiens, & porte le titre de tay-
tchang fée , c’eft-à-dire , confervateur des cinq vertus
capitales , abfolument nécefiaires à l’homme ,
comme membre de la fociétê. Ces cinq vertus font
1 amour univerfel pour l’humanité, la juftice, la
politeffe ou les manières , le fige, difcernement &
la droiture du coeur. Il y a toujours un tribunal particulier
, & un nombre déterminé de mandarins pour
avoir foin de ce qui concerne la mufique.
Lorfque des rois étrangers, ou leurs ambaffa-
deurs viennent rendre hommage à l’empereur; lorf-
qu’il tient fon lit de juftice, ou qu’il eft affis fur fon
trône pour régler les affaires de l’empire, on emploie
cette mufique chao-yo. Chaque cérémonie a
fes airs propres, que des mandarins particuliers
font executer. Sous le règne de l’empereur Young-
tcheng il a même été établi une mufique particulière
pour Iacérémonie du labourage qui fe fait une
fois chaque année, & une autre pour le feftin qui
la fuit.
Voici quelles font en général les différentes ef-
pèces de mufique , 6c les ©ccafions où l’on en fait
ufage.
I. La grande mufique du vejlibule (tan-pi chang )
eft compofée de deux chanteurs & de vingt-huit
fymphoniftes Elle s’exécute dans un veftibule d’où
elle tire fon nom. On emploie cette mufique ,
. i° . Lorfque les regulos & le s mandarins de dif-
férens ordres vont remercier l’empereur de fes bienfaits
: alors on lui chante un cantique intitulé kin<*~
pïng-fché-tchane.
2 • Tous les ans, le jour de la nailîance de î’eni -
pereur, lorfqu’il fe rend à la falle du trône ; lorfrue
les mandarins font leurs prolîernations ; lôrfqu’on
lit l’éloge de l’empereur ; lorfqu’il retourne à fon
appartement ; & lorfqu’aprês fon repas-, il envoie
des mets de fa table aux- regulos, mandarins , &c.
J". Le fécond jour du facrifics, lorfqu’on répète
les mêmes cérémonies.
4°. Le quinzième jour de la première lune., lorf-
que l’empereur fe rend à la falle du trône.
C H t
5 • Lorftrue lVmpereur fait les cérémonies dans
la falle des ancêtres, le premier jour de la première,
de la quatrième, de la feptième, 6c de la dixième
lunes.
6°. Lorfqu’avant la moifibn il offre tm facrifice
auxefprits qui protègent les grains , aii foleil, à la
lune, aux étoiles, aux anciens laboureurs, & c . ;
lorfqu il va rendre hommage à fes ancêtres & à
Confucius.
7°, A la cérémonie du labourage des ferres.
Dans cette cccaficn , vingt müficiens n’ont d’autre
office' que de tenir, en main quelqu’un des inftru-
mens de labourage : cinquante autres müficiens
gardent les étendards , qiii font ce cinq couleurs.
L’empereur prend une bêche, donne un coup ou
deux, fe met cnfuite de;rière une charrue, & fait
lin ou deux filions : quatre vieux labôureurs Tac*
compagnent : les regulos & les grands des neuf ordres
labourent à leur tour; 6c l’empereur eft attentif
à regarder leui* travail. Il monte enfuue en chaife
pour fe rendre dans fon palais; c’eft alors que commence
la grande mufique.
II. La rnvfique qui infpire la véritable concorde
( tchoung-ho-chao-yo ) eft compofée de quatre
mandarins, de deux'chanteurs 6c de vingt-huit inf-
trumens. On exécute cette mufique,
i . Au commencement & à la fin de chaque
année, pendant que l’empereur tient fon lit de
juftice.
2°. Lorfqu’il fe rend à la falle du trône.
III. La mufique excitatrice ( tao-yng-yo ) compofée
de deux mandarins 6c de douze müficiens.
On l’exécute,
i°. Le premier jour qn*on lit l’éloge de l ’empereur.
a0. Lorfque l’empereur offre, dans une efpêce
de petit temple, un facrifice aux âmes de fes ancêtres
, &c.
IV. La mufique tao-yng-ta-yo, compofée de fept
mandarins & de vingt-qliatre müficiens. On l’exécute
lorfque dans un autre petit temple l’empereur
offre un facrifice , & lorfqu’après la cérémonie il
fe retire dans l’appartement où il doit prendre fon
repas.
V . 'La mufique tchmmg-ho-tfiflg-yo. C ’eft celle
qu’on exécute lorfque l’empereur eft à table, &
qu’on lui préfente les mets.
V I . La mufique ta-tchoung-ho char-yo ; lorfqu’aprês
avoir fini les affaires l'empereur retourne
à fon appartement.
VII. La mufique yeou-ping-tché-tchang eft destinée
aux'eérémonies des folftices, lorfque l’empereur
offre des facrifices fur l’autel rond. Il y a treize
mandarins , quatre chanteurs, & cinquantendeux
fymphoniftes.
Toutes ces différentes efpèces de mufique chie
noife ne doivent différer qu’en plus ou moins d’infr
C H I
trumens ; car les airs font prefque tous, du même
genre Les Chinois n’aiment qu’un chant Simple &
t ils ne connoiftent point l’harmonie : tout eft a
l’imiflon ; mais cet uniffon eft varié, dit le P^- Amiot,
fuivant la nature de chaque inftrument. C ’eft dans
cette variation que confiftent l'habileté du compo-
fiteur, la beauté des morceaux, 6c tout l’art mu-
'fical. Cette variation de l’uniffon eft affez difficile à
concevoir, à moins que les différentes oélaves ne
foiènt ici confidérées comme unifions, ou que ces
variations ne foient que dans la qualité du fon &
non dans l’intonation. Au refte , on voit que cet
art ne peut être porté fort loin chez une nation qui i
ne fe permet pas même les demi-tons, quoiqu’elle
les connoiffe tous, & qu’elle les faffe entrer dans
l’affemblage de fes douze lu.
Il feroit inutile de vouloir combattre ce préjugé
national. En vain s’efforceroit-on de prouver aux
Chinois qu’ils doivent trouver du plaffir dans une
çhofe où ils n’en trouvent point ; ils c oiroienr s’ê- .
carter des règles que preferit la belle nature , dont .
ils fe difent les dilciples, f i , pour flatter l’oreille,
ils lui faifoient entendre une multiplicité de fons
qui la fatiguent.
te Pourquoi jouer fi rapidement, difent-ils ? Eft-ce
pour montrer la légèreté de votre efprit & l’agilité
de vos doigts, ou pour plaire à ceux qui vous écoutent
? »
v Si c’eft la première de ces vues qui vous anime,
vous avez atteint le b ut, 6c nous avouons volontiers
que vous nous furpaffez. Mais fi c’eft la fécondé
, nous ne voyons pas que vous en preniez le
chemin ».
» Vos concerts, fur-tout s’ils font un peu longs,
font des exercices violens pour les exécutans , 6c
de petits fupplices pour ceux qui écôutent »,
» 11 faut que les oreilles européennes foient
conftruites différemment des nôtres. Vous aimez
les chofes compliquées ; nous nous plaifons dans
celles qui font fimples. Dans vos- mufiques vous
courez fouvent à perte d’haleine; dans les nôtres
nous marchons toujours à pas grave 6c mefuré ». :
» Rien ne fait mieux connoître le génie d’une na- :
tion que la mufique qu’elle goûte. D ’ un efprit vain,
futile 6c léger., il ne peut fortir'que des produ&ions
qui lui reffemblent ; & ces fortes de produâions ne
plaifent guère qu’à ceux qui font marqués au coin
de l’inconftance & de la lègéreté ».
» Nos anciens ne s’y mêprenoient guère. Habiles
dans la connoiflance du coeur humain, ils étoient
perfuadés que rien ne le déceloit mieux que le
goût qu’il faîfoit paroîrre pour tel ou tel genre de
rnufique. Nous ne les valons pas, à beaucoup près ;
mais heritiers de leurs écrits, de leurs préceptes ,
de leurs njêffiodes , nous croirons toujours , quoi-
qu on nops dife, nous écarter des Voies de la nature
6c des bonnes moeurs, quand nous adopterons
ime mufique compliquée, confufe, fautillante, 6c
c m
dont les mouvemens trop variés ne font c{ue e*
muer un peu le fang, fans pénétrer jufqu’à l’ame
,3 II en eft de nos oreilles à-peu-près comme de
nos yeux. Ceux-ci veulent fe repofer doucement
fur les objets, pour pouvoir reconnoître les beautés
qu’ils renferment, les admirer 6c en être énrus:
celles-là, quoiqu’un peu plus promptes, veulent
néanmoins être entraînées comme malgré elles , &
fans travail, par les charmes d’une bonne mélodie
».
» Que diriez-vous de nous fi , pour vous donner
le plaifir de" voir en peinture tout ce que les Vingt-
deux dynafties qui ont fucceffivement gouverné
notre empire ont fait de grand & de remarquable ,
nous vous montrions dans un feul tableau cet amas
confus d’a&ions de tous les genres ? Pourriez-vous
bien les y diftinguer? Ne nous diriez-vous pas que
vous v o y e z , à la vérité, des couleurs bien nuanc
é e s , des figures bien exprimées, mais tout cela fi
confufémenc , & d’une manière fi compliquée,
aa’elle n’imprime aucune trace -diftinéte dans votre
cerveau ? »
» Ou bien encore que peaferiez vous d’une per-
fonne qui, ayant toute l’hiftoire de notre empire en
plufieurs centaines de tableaux, feroit paffer rapidement
fous vos yeux chacun de ces tableaux l’un
après l’autre , & vous demanderoit enfuite froidement
, fi vous n’avez pas reconnu avec plaifir^ la
vérité de ce qu’ils repréfent^nt, & fi vous n’en
avez pas admiré toutes les beautés ? »
» La réponfe que vous lui feriez eft précifément
la même que nous Tommes tentés de vous faire,
lorfque vous nous demandez fi nous ne trouvons
pas votre mufique belle. Nous n’avons entendu ,
vous dirions-nous alors , qu’un mélange confus de
fons hauts & bas , fans avoir pu diftinguer en aucune
façon ce qu’ils vouloient exprimer ».
Tels font les raifonnemens des Chinois moder*
nés ; 6c il eft impoffible de leur en faire fentir la
fauffeté. Vi&imes des préjugés d’une éducation
qui leur enfeigne que tout ce qui eft bon fe trouve
chez eu x , 6c que la mufique inventée par leurs,
ayeux eft ce qu’il y a de plus parfait au monde ;
ne reconnoiffant, d’ailleurs , pour juges de leu: s
fenfations que des organes ftupides ou émoufiès,
ils fe moqueront toujours de nous quand nous voudrons
leur perfuader que leur mufique, pour être
bonne , devroit être foumife aux mêmes règles ôc
aux mêmes conventions que la nôtre,
( M. Ginguenè. )
' CHÎTONÉE : nom d’un air de flûte & d’une
danfe particulière à Diane, chez les Syracufains.
( M. de Cajlilhon. )
CH-jSUR, eft, en mufique, un morceau d’harmonie
complette, à quatre parties ou plus, chanté à la fois
par toutes les voix , & joué par tout l’orchcftre. On
cherche dans les choeurs un bruit agréable & hav-.
L î ij