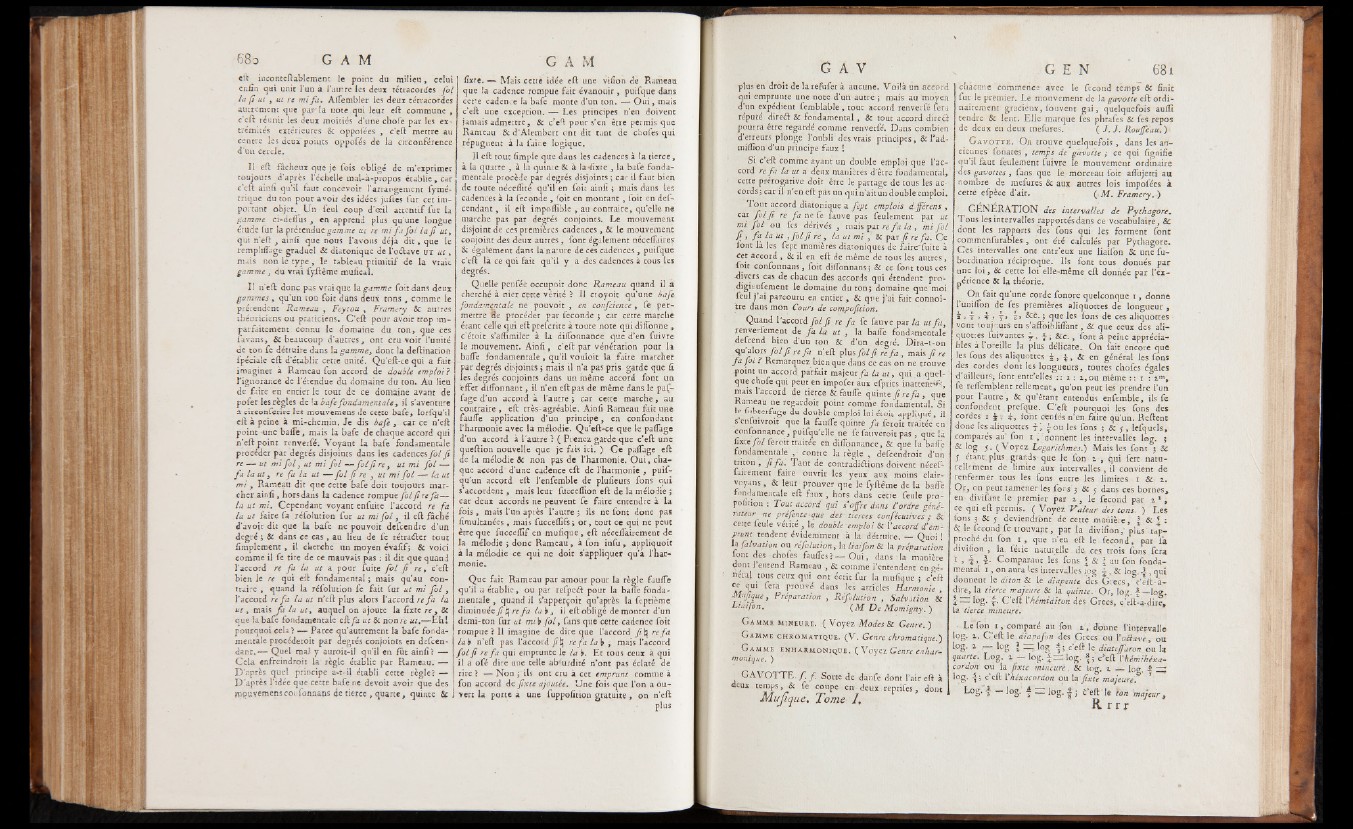
eft incontcftablement le point du milieu, celui
enfin qui unit l’un à l’autre les deux tétracordes fo l
la fi ut , ut re mi fa. AiTembler les deux tétracordes
autrement que p a r l a note qui leur eft commune ,
c'eft réunir les deux moitiés d’une chofe par les extrémités
extérieures & oppofées , c'eft mettre au
centre lès deux points oppofés de la circonférence
d'un cerclé.
Il eft fâcheux que je fois obligé de m’exprimer
toujours d’après l’échelle mal-à-propos établie, car ;
c’eft ainfi qu’il faut concevoir l’arrangement fymé- i
trique du ton pour avoir des idées juftes fur cet important
objet. Un feul coup d’oeil attentif fur la
gamme ci-deflus , en apprend plus qu’une longue
étude fur la prétendue gamme ut re mi fa fo l la f i ut,
qui n’eft , ainfi que nous l’avons déjà d it, que le
remphflage graduel & diatonique de l’oétave ut u t ,
mais non le type, le tableau primitif de la vraie
gamme 3 du vrai fyftême mufical.
Il n’eft donc pas vrai que Va. gamme foitdans deux
gammes , qu’un ton foit dans deux tons , comme le
prétendcnc Rameau , Feytou , Framery & autres
théoriciens ou praticiens. C ’eft pour avoir trop imparfaitement
connu le domaine du ton, que ces
la vans, & beaucoup d’autres, ont cru voir l’unité
de ton fe détruire dans la gamme, dont la deftination
fpéciale eft d’établir cette unité. Qu’eft-ce qui a fait
imaginer à Rameau fon accord de double emploi ?
l ’ignorance de l ’étendue du domaine du ton. Au lieu
de faire en entier le tour de ce domaine avant de
pofer les règles de la bafe fondamentale, il s’aventure
à cireonfcrire les mouvemens de cette bafe, lorfqu’il
eft à peine à mi-chemin. Je dis bafe , car ce n’eft
point «une bafie , mais la bafe de chaque accord qui
n’eft point renverfé; Voyant la bafe fondamentale
procéder par degrés disjoints dans les cadences fo l f i
re — ut mi f o l , ut mi fo l —- fo lfi re , ut mi fo l —
fa la ut y re fa la ut — fo l f i re 3 ut mi fo l — la ut
mi , Rameau dit que cette bafe doit toujours marcher
ainfi, hors dans la cadence rompue fo lfi re fa—
la ut mi. Cependant voyant enfuite l’accord re fa
la ut faire fa réfolution fur ut mi f o l , il eft fâché
d’avojr dit que la bafe ne pou voit defeendre d’un
degré 5 8c dans ce cas , au lieu de fe rétra&er tout
fimplement, il cherche un moyen évafif, & voici
comme il fe tire de ce mauvais pas : il dit que quand
l ’accord rç fa la ut a. pour fuite fo l f i re, c’eft
bien le re qui eft fondamental j mais qu’au contraire
, quand la réfolution fe fait fur ut mi fo l ,
l’accord re fa la ut n’eft plus alors l’accord re fa la
u t , mais fa la ut, auquel on ajoute la fixte re , 8c
que la bafe fondamentale eft/z ut & non rè ut.— Ehî
pourquoi cela ? — Parce qu’autrement la bafe fondamentale
prpcéderoit par degrés conjoints en defeen-
dant.— Quel mal y auroit-il qu’il en fut ainfi? —
Cela enfreindrait la règle établie par Rameau. —
D ’après quel principe a-t-il établi cette règle? —
D ’après l’idée que cette bafe ne devoit avoir que des
mquvemens confonnans de tierce, quarte, quinte 8c
fixfe. — Mais cetré idée eft une vifion de Rameau
que la cadence rompue fait évanouir , puifque dans
cette cadence la bafe monte d’un ton. — O u i, mais
c’eft une exception. — Les principes n’en doivent
jamais admettre, & c’ eft pour s’en être permis que
Rameau & d’Alembcrt ont dit tant de chofes qui
répugnent à la faine logique.
Il eft tout fimple que dans les cadences à la tierce,
à la quarte , à la quinte & à la«fixre , la bafe fondamentale
procède par degrés disjoints ; car il faut bien
de toute néceflké qu’il en foie ainfi ; mais dans les
cadences à la fécondé , foit en montant, foit en def-
cendant , il eft impoflible , au contraire, qu’elle ne
marche pas par degrés conjoints. Le mouvement
disjoint de ces premières cadences , & le mouvement
conjoint des deux autres, font également nécelfaires
& également dans la nature de ces cadences, puifque
c’eft là ce qui fait qu’il y a des cadences à cous les
degrés.
Quelle penfée occupoit donc Rameau quand il a
cherché à nier tfptte vérité ? Il croyoit qu’une bafe
fondamentale ne pouvoit , en confcience , fe permettre
ne procéder par fécondé j car cetre marche
étant celle qui eft preferite à toute note qui diflonne ,
c’étoit s’alfimilcr à la difTonnance que d’en fuivre
le mouvement. Ainfi, c’eft par vénération pour la
bafTe fondamentale, qu’il vouloit la faire marcher
par degrés disjoints ; mais il n’a pas pris garde que fi
les degrés conjoints dans un même accord font un
effet diflonnant, il n’en eft pas de même dans le paf-
fage d’un accord à l’autre ; car cetre marche, au
contraire , eft très-agréable. Ainfi Rameau fait une
faufie application d’un principe, en confondant
l’harmonie avec la mélodie. Qu’eft-ce que le pafTage
d’un accord à l'autre ? ( Prenez garde que c’eft une
ueftion nouvelle que je fais ici. ) Ce pafTage eft
e la mélodie & non pas de l’harmonie. Oui, chaque
accord d’une cadence eft de l’harmonie , puif-
qu’un accprd eft l'enfemble de plufieurs fons qui
s’accordent, mais leur fiiccefïion eft de la mélodie j
car deux accords ne peuvent fe faire entendre à la
fois , mais l’un après l’autre ; ils ne font donc pas
fimultanées , mais fucceffifs > o r , tout ce qui ne peut
être que fucceffif en mufique, eft nécefTairemenc de
la mélodie > donc Rameau, à fon infu, appliquoic
à la mélodie ce qui ne doit s’appliquer qu’à l’harmonie.
Que fait Rameau par amour pour la règle faufTe
qu’il a établie, ou par refpeéfc pour la baffe fondamentale
, quand il s’apperçoit qu’après la feptième
diminuée fi\\re fa la'b, il eft obligé démonter d’un
demi-ton fur ut mi |> fo l, fans que cette cadence foit
rompue ? Il imagine de dire que l’accord f i b re fa
la 1» n’eft pas l ’accord fi t] refa lai» -, mais l’accord
fo l f i re fa qui emprunte le la |>. Et tous ceux à qui
il a ofé dire une telle abfurdité n’ont pas éclaté de
rire ? — Non ; ils ont cru à cet emprunt comme à
fon accord de fixte ajoutée. Une fois que l’on a ouvert
la porte à une fuppofition gratuite, on n’eft
plus en droit delarefufer à aucune. Voilà un accord
qui emprunte une note d’un autre $ mais au moyen
d’un expédient femblable , tout accord renverfé fera
réputé direél & fondamental , & tout accord direét
pourra être regardé, comme renverfé. Dans combien
d’erreurs plonge l’oubli des vrais principes, & Tad-
miffion d'un principe faux î
Si c’eft comme ayant un double emploi que l ’accord
refa la ut a deux manières d’être fondamental,
* cette prérogative dofr être le partage de tous les ac-
cordsj car il n’en eft pas un qui n’ait un double emploi.
Tout accord diatonique a fept emplois dfférens ,
car fo l f i re fa ne fe fauve pas feulement par ut
mi fo i ou fes dérivés , mais par re fa la , mi fo l
f i i fa la ut t fo l fi re , la ut mi , & par fi ré fa. Ce
font là les fept manières diatoniques de faire'fuite à
cet accord , & il en eft de même de tous les autres,
foie confonnans, foit difTonnansj & ce font tous ces
-divers cas de chacun des accords qui étendent pro-
.digieufement le domaine dutonj domaine que'moi
feul j ai parcouru en entier , & que j’ai fait connoî- j
tre dans mon Cours de compofition.
Quand l ’accord fo l f i re fa fe fauve par la ut fa 3
renverfement de fa la u t la bafle fondamentale
defeend bien d’un ton & d’un degré. Dira-t-on
qu’alors fo l f i re fa n|eft plus fo l fi refa , mais f i re •
fa fo l? Remarquez^ bien que dans ce cas on ne trouve
point un accord parlait majeur fa la ut, qui a quelque
chofe qui peut en impofer aux efprits inattennfs,
mais 1 accord de tierce & faufie quinte f i refa , que
Rameau ne regardoit point comme fondamental. Si
le fubterfuge du double emploi lui étoit appliqué, il
s enfuivroit que la faufie quinte fa ferait traitée en
confonnance , puifqu’elle ne fe fauveroit pas , que la
.fixte/?ƒ ferait traitée en difionnance, & que la bafle
fondamentale , contre la règle , defeendroit d’un
triton , f i fa^ Tant de contradictions doivent néeef-
fairement faire ouvrir les yeux aux moins clair-
voyans, & leur prouver que le fyftême de la bafle
fondamentale eft faux, hors dans cette feule pro-
pofirion : Tout accord qui s3offre dans l3 ordre générateur
ne prefente-que des tierces confécutives ,■ &
cette feule vérité , le double-emploi & T accord d'èm- S
prunt teridenf évidemment à la détruire. — Quoi 1
la falvation ou réfolution, la liai fon & la préparation
font des chofes faufles?^- Oui, dans-la manière
çont 1 entend Rameau , & comme l’entendent en général
tous ceux qui ont écrit fur la mufique j c;eft
ce qui fera prouvé dans les articles Harmonie , !
Mufique y Préparation , Réfolution , Sahàtion &
Liai fon. (M De Momigny.')
G amme m in eu r e . ( Voyez Modes & Genre.)
G amme c h r om a t iq u e . (V. Genre chromatique)
G amme en h a rm o n iq u e . ( Voyez Genre enhar-
tootiïque. )
G A V O T T E ./ , f Sorte de danfe dont l’air eft à
deux temps, & fe coupe en -deux reprifes, donc
Mujlque. Tome I,
chacune commence avec le fécond temps & finit
fur le premier. Le mouvemenr de la gavotte eft ordinairement
gracieux, fou vent g a i, quelquefois aufii
tendre & lent. Elle marque fes phrafes & fes repos
de deux en deux mefures. ( J. J. Rouffeau. )
G a v o t t e . On trouve quelquefois , dans les anciennes
fonatés , temps de gavotte ; ce qui fignifîe
qu’il faut feulement fuivre le mouvemenc ordinaire
•des gavottes, fans, que le morceau foit aflujetti ati
nombre de mefures & aux autres lois impofées à
cette efpèce d’air. - fM . Framery.)
GÉNÉRATION des intervalles de Pythagore.
Tous les intervalles rapportés dans ce vocabulaire, 8c
dont les rapports des fons qui les forment font
commenfurables , ont été calculés par Pythagore.
Ces intervalles ont entr’eux une liaifon & une fu-
bordination réciproque. Ils font tous donnés par
une lo i, & cette loi elle-même eft donnée par l’expérience
& la théorie.
On fait qu une corde fonore quelconque i , donne
1 uniflon de Tes premières aliquocces de longueur ,
i i T > t y T» ?» ; que les fons de ces aliquottes
vont toujours en s’alfoibliflànt, & que ceux des ali—
quotres fuivantes j , & c ., font à peine appréciables
à 1 oreille la plus délicate^ On fait encore que
les fons des aliquottes | , i , & en général les fons
des cordes dont les longueurs, toutes chofes égales
-d ailleurs^ font entr elles :: i : z,ou même i : i :
fe refiemblent tellement, qu’on peut les prendre l’un
pour l’autre, & qu'étant entendus enfemble, ils fe
confondent prefque. C'eft pourquoi les fons des
cordes r 5 - ç , font oenfés n’en faire qu’un. Relient
donc les aliquottes f ) fo u les fons ? & y , lefquels,:
comparés au' fon i j ^donnent lès intervalles leg. 5
& log 5• (V oyez Logarithmes) Mais les fons 3 8c
y étant plus grands-que le fon i , qui fert naturellement
de limite aux intervalles, il convient de
renfermer tous les fons entre-les limites 1 & 2.
Or, on peut ramener les for.s 3 & y dans ces bornes,
en divifant le premier par 2 , le fécond par 2 1 ,
ce qui eft permis. ( Voyez Valeur des tons. ) Les
Ions 3 & y deviendront de cette manière, \ & * z
& le.fécond fe trouvant, par la divifion,' plus rapproché
du fon 1 , que n’en eft le - fécond, par la
divifion , la. feiie naturelle do .ces. trais Ions fera
î.i 4 > ï* Comparant des fons jj- & \ au fon fondamental
1 , on aura les intervalles; iog. ^ , & log. , qui
donnent le diton & le diapente des Grecs, c'ëlt-à-
dire, la tierce majeure & la quinte. Or, log. f — lo<*.
ï ^ l ô g . f . C ’eft l’hémiditon des Grecs, ç’eft-à-dire,
la tierce mineure.
- Lé fon 1 , comparé au fon 1 , donne l’inçeçvalle
log. 2. C ’eft le diapafon des Grecs ou^ YoÆave, ou
log. 2- log 2 =^log f ; c’eft le diatejfaron ou la
quarte. Log. x — log. log. » ; c'eft Yhémihéxa-
cordon ou la fixte mineure, & log. 2 — log. è. z z
log- f ï c’eft 1 hêxacordon ou la fixte majeure.
I Log. \ — log. f IZ log. 1 5 t ’eft le ton majeur 9
R r r r