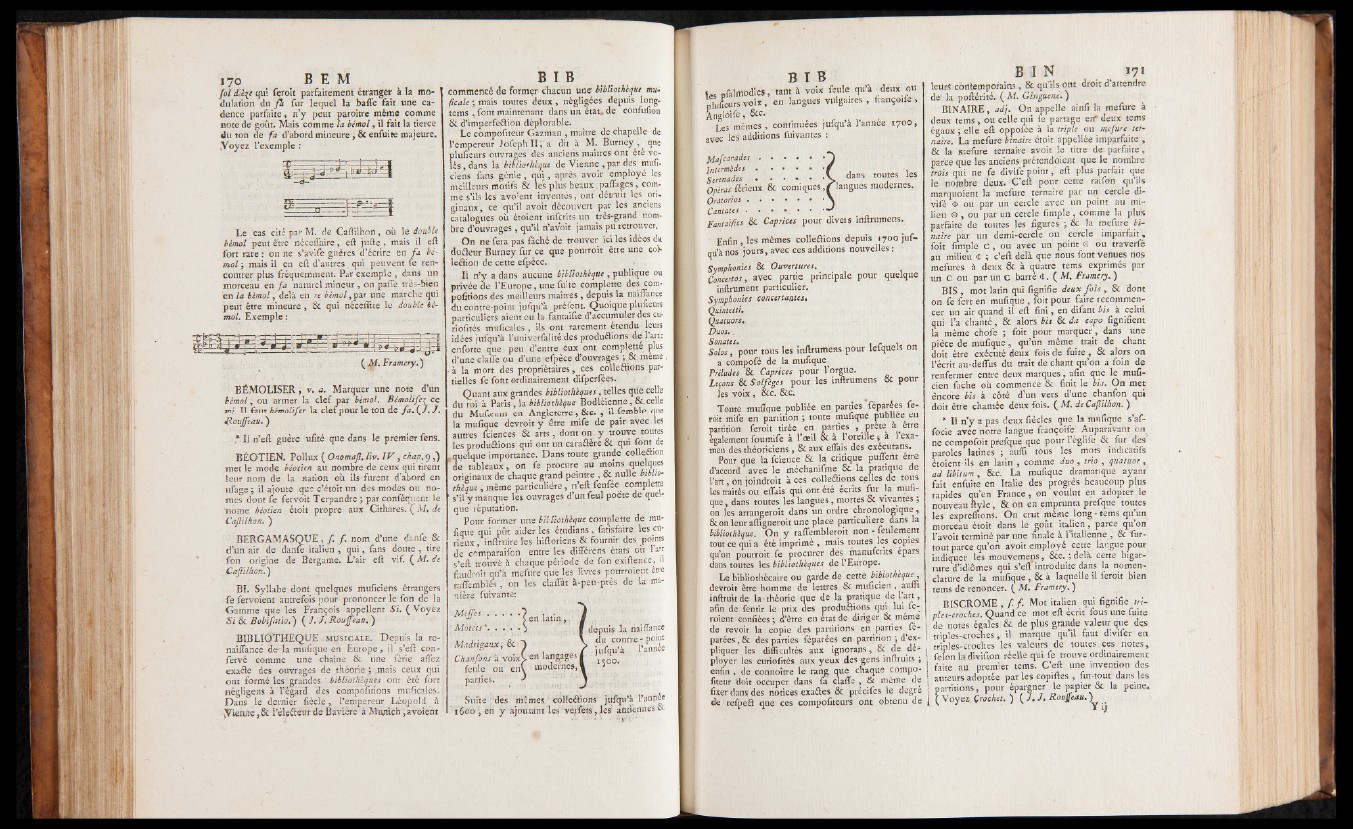
i7o B E M
fo l di'e^e qui feroit parfaitement étranger à la mo- 1
dulation du ƒ& fur lequel la baffe fait une cadence
parfaite , n’y peut paroître même comme
note de goût. Mais comme la bémol, il fait la tierce
du ton de fa d’abord mineure, & enfuite majeure.
y oyez l’exemple :
Le cas cité par M. de Cafliîhon, où le double
bémol peut être néceffaire, eft jufte » mais il eft
fort rare : on ne s’àvife guères d’écrire en fa bémol
y mais il en eft d’autres qui peuvent fe rencontrer
plus fréquemment. Par exemple , dans un
morceau en fa naturel mineur , on paffe très-bien
en la bémol, delà en re bémof par une marche qui
peut être mineure , & qui néceflite le double bémol.
Exemple :
( 44. Framery.)
BÉMOLISER , v. a. Marquer une note d’un
bémol, ou armer la clef par bémol. B émotife{ ce
mi. Il faut bèmolifer la cle f pour le ton de fa . ( / . J.
Qoujfeau. )
* Il n’eft guère uftté que dans le premier fens.
BÉOTIEN. Pollux ( Onomafl. tiv. IV , chap. 9 ,)
met le mode béotien au nombre de ceux qui tirent
leur nom de la nation où ils furent d’abord en
ufage ; il ajoute que c’étoit un des modes ou nomes
dont fe fervoit Terpandre ; par conféquent le
’nome béotien étoit propre aux Cithares, f M* de
Cafliîhon. )
BERGAMASQUE , f f nom d’une danfe &
d’un air de danfe italien , qui , fans doute, tire
fon origine de Rergame. L’air eft vif. ( M. de
Cafliîhon. )
BI. Syllabe dont quelques muficiens étrangers
fefervoient autrefois pour prononcer le fon de la
Gamme que les François appellent Si. (V o y e z
Si & Bobifatio.) ( J. J. Rouffeau. )
BIBLIOTHEQUE musicale. Depuis la re-
naiffancé de-la mufique en Europe, il s’eft con-
fervé comme une chaîne & une férié affez
exaéle des ouvrages de théorie ; .mais ceux qui
ont formé les grandes -bibliothèques ont été fort
négligens à l ’égard des compositions muficales.
Dans le dernier fiècle, l’empereur Léqpold à
Vienne, & l’éle&eyr de Bavière à Munich, avoient
B 1 B
commencé de former chacun une bibliothèque mu-
fie ale y mais toutes deux , négligées depuis long-
tems , font maintenant dans un état» de confufion
& d’imperfeftion déplorable.
Le compofiteur Gazman , maître de chapelle de
l’empereur JofephlI; a dit à M. Burney, que
plufieurs ouvrages des anciens maîtres ont été volés,
dans la bibliothèque de Vienne , par des muficiens
fans génie, qui , après avoir employé les
meilleurs motifs & les plus beaux. paffages, comme
s’ils les' avo:ent inventés, ont détruit les originaux,
ce qu’ il avoit découvert par les anciens
catalogues où étoient inferits un très-grand nombre
d’ouvrages , qu’il n’avoit jamais pu retrouver.
On ne fera pas fâché de trouver ici les ideos du
doéleur Burney fur ce que poürroit etre une colf-
leâion de cette efpèce.
Il n’y a dans aucune bibliothèque , publique ou
privée de l’Europe, une fuite complette des com-
pofitions des meilleurs maîtres , depuis la naiffance
du contre-point jufqu’à préfent. Quoique plufieurs
particuliers aient eu la fantaifie d’accumuler des eu-
riofités muficales, ils ont rarement étendu leurs
idées jufqu’à l’univerfalité des productions de 1 art:
enforte que peu d’entre eux ont completté plus
d’une claffe ou d’une efpèce d’ouvrages ; même ,
-à la mort des propriétaires, ces collections partielles
fe font ordinairement difperféçs.
Quant aux grandes bibliothèques, telles que celle
du roi à Paris , la bibliothèque Bodleienne, & celle
du Mufæum en Angleterre , &c. , il femble que
la mufique devroit y être mife de pair avec les
autres fciences & arts, dont on y trouve toutes
les productions qui ont un caradère & qui font de
quelque importance. Dans toute grande colleChon
de tableaux, on fé procure au moins quelques
originaux de chaque grand peintre , & nulle bibliothèque
, même particulière, n’eft fenfee complette
s’il y manque les ouvrages d’un feul poète de quelque
réputation.
Pour former une bibliothèque complette de mufique
qui put aider les étudians, fatisfaire les curieux
, instruire les hiftoriens & fournir des points
de comparaifon entre les différens états où 1 art
s’eft trouvé à chaque période de fon exiftence, il
faudroit qu’à mefure que les livres pourroient être
raffemblés , "on les claffàt à-peu-ptès de la manière
fuivante:
Mejfes .
Motets*.
Madrigaux; &
en latin, ,
depuis la naiffance
du contre- point
r i t jufqu’à l’année
Charîfons 'k voix > en langages 1 *
feule ou éflV modernes,»
parties; f
Suite des mêmes collections jufqu’à l’année
160O } en y ajoutant les veffets, Jles1 afitïenne's &
b 1 B
Us nfalmodies, tant à voix feule qu’à deux ou
plufieurs v o ix , en langues vulgaires , françoife î,
Angldiie, &c. '
Les mêmes ,■ continuées jufqu’à l ’année . 1700,
avec les additions fuivantes ;•
JAafcarades...............................J
M 8 ..................v,, dans t0T s Opéras férieux & comiques,jT langues modernes.
Oratorios . . . . . . • \
Cantates . . . .
Fantai/tes & Caprices pour diveis inftrumens.
Enfin, les mêmes colleftions depuis 1700 jufqu’à
nos jours, avec ces additions nouvelles :
Symphonies & Ouvertures.
: Concertos, avec partie principale pour quelque
infiniment particulier.
! S ym p h o n ie s co n c e r ta n te s .
Quintettu
i Quatuors.
j Duos*.
[ Solos, pour tous les inftrumens pour lefquels on
a compofé de la mufique.
Préludes & Caprices pour l’orgue.
Leçons & Solfèges pour les inftrumens SC pour
les v o ix , &c. &c.
Toute mufique publiée en parties feparées fe-
[ rôit mife en partition ; toute mufique publiée^ en
partition feroit tirée en parties , prête a etre
j également foumife à l’oeil oc à l’oreille 5 a 1 examen
des théoriciens , & aux effais des exécutans.
Pour que la fcience & la critique puffeiit etre
d’accord avec le méchanifme 6c la pratique de
l’art, on joindroit à ces colleaions celles de tous
j les traités ou effais qui ont été écrits fur la mufique
, dans toutes les langues, mortes & vivantes ;
on les arrangeroit dans un ordre chronologique,
\ & on leur afligneroit une place particulière dans la
bibliothèque. On y raffembleroit non - feulement
tout ce qui a été imprimé , mais toutes les copies
qu’on poürroit fe procurer des inanuferits epars
dans toutes les bibliothèques de l’Europe.
Le bibliothécaire ou garde de cette bibiotheque,
devroit être homme de lettres 8c muficien , ■ auffi
inftruit de la" théorie que de la pratique de t art,
afin de fentir le prix des productions qui Jg|j le- •
roient confiées ; d’être en état de diriger & meme
de revoir la copie des partitions en parties Réparées
, & des parties fêparées en partition ; d’ex- I
pliquer les difficultés aux ignorans, & de dé- i
ployer les curiofités aux yeux des gens inftruits ;
enfin , de connoître le rang que chaque compofiteur
doit occuper dans fa claffe , & même de
fixer dans des notices exactes & précifes le degré
de refpeét que ces compofiteurs ont obtenu de [
BI N *7*
leurs contemporains, & qu’ils ont droit d’attendre
de’ la poftérité. ( M. Ginguené. )
BINAIRE, adj. On appelle ainfi la mefure à •
deux tems, ou celle qui fe partage em deux teins
égaux ; elle eft oppofée à la triple ou rnefure ternaire.
La mefure binaire étoit appellée imparfaite ,
& la mefure ternaire avoit le titre de parfaite,
parce que les anciens prétendoient que le nombre
trois qui ne fe divife point,' eft plus parfait que
le nombre deux. C ’eft pour cette raifon qu’ils
marquoient la mefure ternaire par un cercle di-
vifé ou par un cercle avec un point au milieu
© , ou par un cercle fitnpie , comme la plus
parfaite de toutes les figures , & la mefure binaire
par un demi-cercle ou cercle imparfait,
foit fimple c , ou avec un point @ ou traverfé
au milieu 4 ; c’eft delà que nous font venues nos
mefures à deux & à quatre tems exprimés par
un C ou par un C barre 4 . ( M. Framery. )
B IS , mot latin qui fignifie deux fois , & dont
on fe fert en mufique , loit pour faire recommencer
un air quand il eft fini, en ci Tant bis a celui
qui l’a chanté, & alors bis & da eapo fignifient
la même chofe j foit pour marquer, dans une
pièce de mufique, qu’un même _ trait de chant
doit être exécuté deux fois de fuite , & alors on
l ’écrit au-deffus du trait de chant qu’on a foin de
renfermer entre deux marques , afin que le muficien
fâche où commence & finit le bis. On met
encore bis à côté d’un vers d’une chanfon qui
doit être chantée deux fois. ( M. de Cajlilhon. ).
* Il n’y a pas deux fièçles que la mufique s’af-
focie avec notre langue françoife Auparavant on
ne compofoit prefque que pour t’eglife & fur des
paroles latines ; auffi tous les mots indicatifs
etoient-ils en latin , comme duo, trio , quatuor,
a i libitum, &c. La mufique dramatique ayant
fait enfuite en Italie des progrès beaucoup plus
rapides qu’en France , on voulut en adopter le
nouveau ftyle , & o n en emprunta prefque toutes
les expreffions. On crut même long - tems qujun
morceau étoit dans le ROut italien , parce qu on
l’avoit terminé par une finale à ritalienne , & fur-
tout parce qu’on avoit employé cette langue pour
indiquer les mouvemens, &c. ; delà, cette bigarrure
d’idiômes qui s’eft’ introduite dans la nomenclature
de la mufique , & à laquelle il feroit bien
tems de renoncer. ^ M. Framery.')
B 1SCROME , f. f . Mot italien qui fignifie triples
croches. Quand ce mot eft écrit fous une fuite
de notes égales & de plus grande valeur que des
triples-croches, il marque qu’il faut divifer eu
triples-croches les valeurs de' toutes,ces notes,
félon la divifion réelle qui fe trouve ordinairement
faite au premier tems. C ’eft une invention des
auteurs adoptée pat les copiftes , fur-tout dans les
partitions, pour épargner le papier & la peine.
£ Voyez, Crochet. ) ( J. J. Routfeau.)