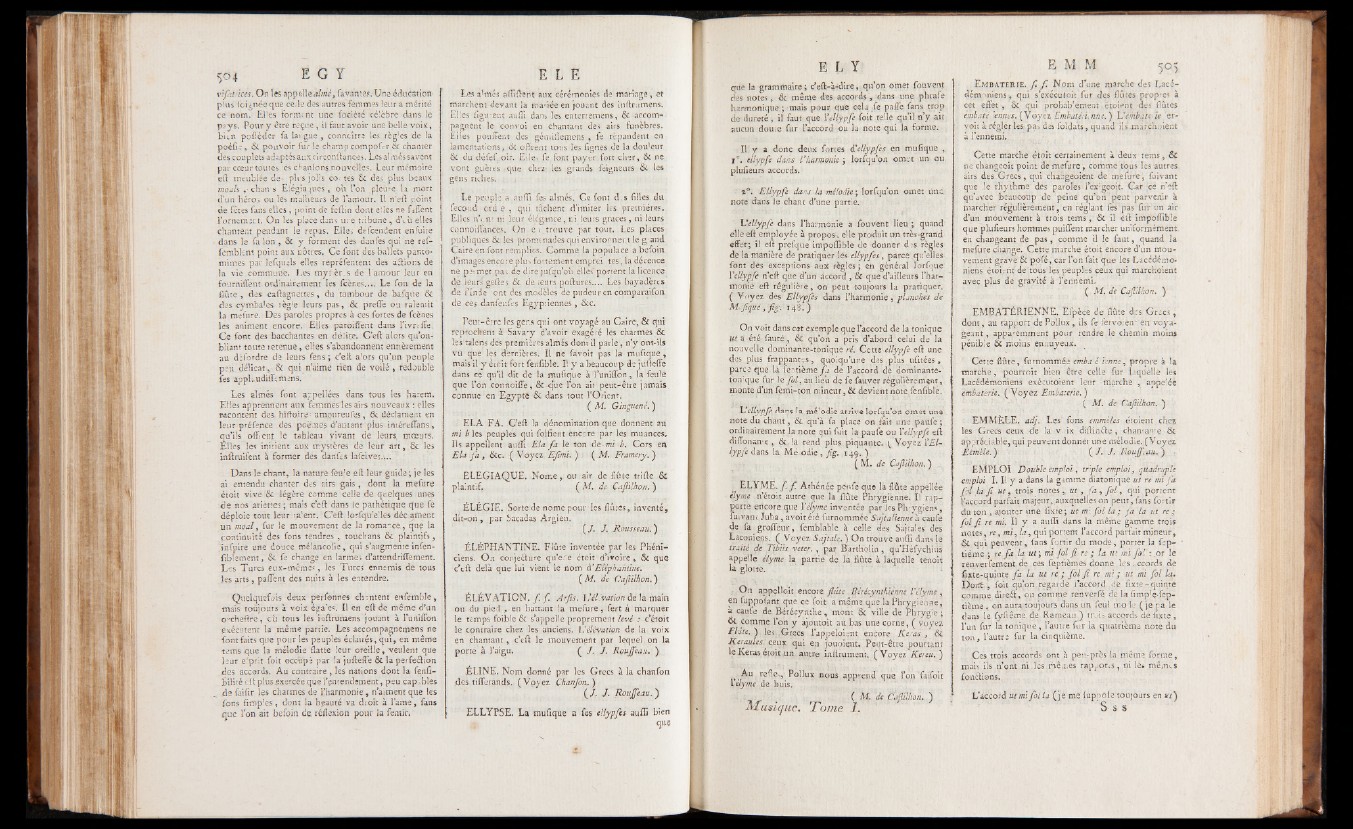
vlfiiLiices. On les appelle a/wé, favantes. Une éducation
plus foitf née que ce.-le des autres femmes leur a mérité
ce nom. E l!es forment une foclété célèbre dans le
pays. Pour y être reçue , il faut avoir une belle vo ix ,
bien pofléder fa laugue, conncître les règles de la
poéfie , & pouvoir fur le champ çompofer 6c chanter
des couplets ad aptes aux circqnftances. Les al mes savent
par coeur toutes es chanfonçjiouvelles. Leur mémoire
eft meublée de< plus jolis cor tes & des. plus beaux
moals ,- chan s Eiég ia ju e s , où Ton plèùre la mort
d’un héros ou les malheurs de l’amour. Il n'eft point
de fêtes fans elles , point de feftin dont elles ne faffent
l’ornement. On les place dans une tribune, dVùelles
chantent pendant le repas. Elles descendent en fuite
dans le fa Io n , & y forment des danfes qui ne ref-
femblsnt point aux nôtres. C e font des ballets pantomimes
par lefquels elles repréfehtent des actions de
la vie commune. Les m y lè r .s de l ’amour leur en
fournitTent ordinairement les feènes.... Le fon de la
flûte , des caftagnettes, du tambour de bafque 8c
des cymbales règle leurs pa s, 8c preffe ou ralentit
la mefure. Des paroles propres à ces fortes de feènes
les animent encore. Elles paroiffent dans l’ivre ffe.
C e font des bacchantes en délire. G ’eft alors qu’oubliant
toute tetenue, elles s’abandonnent entièrement
au défordre de leurs fens ; c’eft alors qu’un peuple
peù délicat , & qui n’aime rien de v o i lé , redouble
fes applaudiffcmens.
Les aimés font appeilées dans tous les harem.
Elles apprennent aux femmesies airs nouveaux : elles
racontent des- hiftoire' amonreufes , & déclament en
leur préfençe des poèmes d’autant plus iniéreffansi,
qu’ils offrent le tableau vivant de leurs, moeurs.
Elles les initient aux mystères de leur a r t , ôc les
inftruifent à former des danfes lafcives.1,.. ï
Dans le chant, la nature feu'e eft leur guide ; je les
ai entendu chanter des airs gais , dont la mefure
étoit vive & légère comme celle de quelques unes
d e nos ariettes ; mais c’eft dans Je pathétique que fe
déploie tout leur ra’ent. C ’eft lorsqu'elles déclament
un moal, fur le mouvement de la romar.ee, que la
continuité des fons tendres , touebans & plaintifs,
jnfpire une douce mélancolie, qui s’augmenteinfen-
fiblement, & fe change en larmes d’attendriftement.
Les Turcs eux-mêmes, les Turc s ennemis de tous
les a rts , paffent des nuits à les entendre.
Quelquefois deux perfonnes chantent enfembJe,
mais toujours à voix éga’es. Il en eft de même d’un
orcheftre , cù tous les inftrumens jouant à Yunifibn
exécutent la même partie. Les aecompagnemens ne
font faits que pour les peuples éclairés, qui, en même
tems que la mélodie flatte leur oreille, veulent que
leur efprît foit occupé par la jufteffe & la perfection
des accords. Au contraire , les nations dont la fenfi-
bilitè eft plus exercée que l’entendement, peu capables
de fai fi r les charmes de l’harmonie, n’aiment que les
fons fimp’e s , dont la beauté va droit à lam e , fans
que l’on ait befoin de. réflexion pour la fentir.
Les ahnés afliftent aux cérémonies de mariage, et
marchent devant la manée en jouant des inftrumens.
Elles Agirent auffi dans les enterremens, 8c accompagnent
le convoi en chantant des airs funèbres,
biles pouffent des géniiilemer.s , fe répandent en
lamentations, Ôt offrent tous les Agnes de la dou'eur
ëc du défefj.oir. Eiles fe font payer fort cher, & ne
vont guèies que chez: les grands feigneurs & les
gens riches.
Le peuple a suffi fes aimés. Ce font d .s Ailes du
fécond crd e , qui tâchent d’imiter les premières.
Elles n’. n* ni leur élégance, ni leurs grâces, ni leurs
connoiffances. On e i trouve par tout. Les places
publiques & les promenades qui environnent le g 1 and
Caire en font remplies. Comme la populace a befoin
d’images encore plus fortement emprei tes , la décence
ne p3:met pas de dire jufqu’où,elles* portent la licence
de leurs geftes 8c de leurs poftures.... Les bayadères
de l’ Inde ont des modèles de pudeur en comparaifon
de ces danfeufes Egypiiennes, &ç.
Peut-être les gens qui ont voyagé au Caire, & qui
reprochent à Sava-y d’avoir exagéré les charmes &
les talens des premières aimés dont il parle, n’y ont-ils
vu que les dernières: Il ne fâvoit pas la mufique,
mais il y éceit fort fenfible. Il y a beaucoup de jufteffe
dans ce qu’il dit de la mufique à l’uniffon, la feule
que l’on connoiffe, 8c .q*ue l’on ait peut-être jamais
connue en Egypte ôc dans tout l’Orient.
( M. Ginguenê. )
; E L A FA . C 7eft la dénomination que donnent au
mi b les peuples qui fqlAent èncore par les muances;
Ils appellent auffi Ela fa le ton àe-mib. Cors en
E h f a , & c . ^ V o y e z Efimi. ) s ( M. Framery. )
E L E G IA Q U E . N om e , ou air de flûte trifte &
plaintif.. ( M. de Çajlilhon. )
É L ÉG IE . Sorte de nome pour les flûres, inventé,
dit-ori , par Sacadas Argien.
( J. J. Rousseau. )
ÉL É PH AN T IN E . Flûte inventée par les Phéniciens.
O n conjecture qu’erle étoit d’ivoire , & que
c’ t ft delà que lui vient le nom d ’Eiéphahtinç.
( M. de Çajlilhon, )
É L É V A T IO N , f f Arfis. ïé élévation de la main
ou du pied , en battant la mefure, fert à marquer
le temps foible 8c s’appelle proprement levé : c’étoit
le contraire chez les anciens, h'élévation de la voix
en chantant, c’eft le mouvement par lequel on la
porte à l’aigu. ( J. J. Rçujfeau. )
ÉL INE . Nom donné par les Grecs à la chanfon
des tifferands. (V p y e z Chanfon, )
( J. J. Roujfeau. )
E L L Y P SE . La tnuflque a fes ellypfes aufli bien
que
que la grammaire; c’eft-à-dire, qu’on omet fouvent
des n otes, & même des accords, dans une phrafe
harmonique ; mais pour que cela .fe paffe fans trop
de dureté , il faut que Y ellypfe foit telle qu’il n’y ait ,
aucun doute fur l’accord ou la note qui la forme.
Il y a donc deux fortes dCellypfes en mufique
1°. ellypfe dans Vharmonie ; lorfqu’on om ît un ou
plufieurs accords.
i ° . Ellypfe dans la mélodie ; lorfqu’on omet line,
note dans le chant d’une partie.
L’ellypfe dans l’harmonie a fou vent lieu-; quand
elle eft employée à propos-, elle produit un très-grand
effet; il eft prefque impoflible de donner d;s règles
de la manière de pratiquer les ellypfes \ parce q u ’elles
font des exceptions aux règles ; en général lorfque
Y ellypfe n’eft que d’un dccord, & que d’ailleurs l'harmonie
eft régulière, on peut toujours la pratiquer.
( V o y ez des Ëllypjes dans l’harmonie , planches de
M. fique , flg. 14 8 .)
On voit dans cat exemple que l’accord de la tonique
Ut a été fauté, & qu’on a pris d’abord celui de la
nouvelle dominante-tonique ré. Cette ellypfe eft une
des plus frappantes-, quoiqu’une des plus ufitées,
parce ffue |4 fe^tième fa de l’accord de dominante-
ton que fur le fo l, au lieu de fe fauver régulièrement,
monte d’un femi-ton mineur, & devient notefenfible.
Vellypfe dans la mé’odie arrive lorfqü’on omet une
note du chant, & qu’à fa place on fait une pâüfé ;
ordinairement la note qui fuit la paufe ou Y ellypfe eft
diffonan'e , & . la rend plus piquante. ^ V o y e z ŸEl-
lypfe dans la Mé.odie , fig. 149. )
( M. de Cajliljhop. ) .
E L YM Ç . f f Athénée penfe que là flûte appellée
ilyme n’étoit autre que la flûte Phrygienne* Il rapporte
encore que Yèlyme inventée par les Phrygiens,
fuivanc Juba, avoit éré furnommèe Sajtalienne à caufe
de fa groffeur, femblable à celle des Sajtalés dès
Laconieps. ( V o y e z Sajtale. ) On trouve auffi dans je
traité de Tibiis veter. , par BàrtHolin , qû’Héfyeliins
appelle élyme la partie de la flûte à laquelle tenoit
la glotte. .
. ,O n appelloit encore flûte Bérécynthicnne Vélyme ,
en fuppofant que ce foit a même quë la Phrygienne,
à caufe de Bérécynthe, mont & ville de Phrygie ;
& comme l’on y àjoutoit au bas une corne, ( voyez
Flûte. ) les .Gr.ecs l’appeloient encore lieras > &
Keraules çeuç qui en jouoient. Peut-être pourtant
le Keras étoit ,un autre inlii-umem. ( V o y e z Kereu. )
Au refle., Pollux nous apprend que l’on faifoit
1 élyme de buis.
v ' ( M. de Caftilhoti.. 1
Musique. Tome 1 .
Embaterie. f f . Nom d’une marche des Lacédémoniens,
qui s’exéculoit fur des flûtes propres à
cet effet , & qui probab'ëment étoient des flûtes
embaté iennes. (V o y e z EmbatérL n nt. ) L 'e.fnbatc ie er-
vpit à régléf lesi pas des foldàts, quand ilshmarchoient
à l’ennemi.
Cette marche étoit certainement à deux tems, &
ne changeoit point de mefure, comme tous les autres,
airs des G re c s , qui changeoient de mefure, fuivant
que le rhythme des paroles l’ex:geoit. Car ce n’eft
qu’avec beaucoup de peine qu’on peut parvenir à
marcher régulièrement, en réglant fes pas fur un air
d’un mouvement à trois tems , & il eft impoflible
que plufieurs hommes puiffent marcher uniformément
en changeant de p a s , comme il le fau t, quand la
mefure change. Cette marche étoit encore d’un mouvement
grave & pofé, car l’on fait que les Lacédémoniens
étoieiit de'tous :les peuples ceux qui marchoient
avec plus dé gravité à l’ennèmi.
( M . de Çajlilhon. )
EM B A TÉ R IEN N E . Efpèce de flûte des G r e c s ,
dont, au rapport de Pollux, ils fe fervoiên: en v o y a geant
, apparemment pour rendre le chemin moins
pénible & moins ennuyeux.
Cette flûte, furnommée emba é im n e , propre à la
marche, pourroit bien être celle fur laqüèlle les
Lacédémoniens exécutoient leur marche , appeîéè
embaterie. ( V o y e z Embaterie. )
( M . de Çajlilhon. )
EM M Ê LE , ad.). Les fons emmêles croient chez
les Grecs ceux de la v ix diftinéle , chantan'e &
appréciable, qui peuvent donner une mélodie. (V o y e z
Ecrrièle. ) . ( J. J. Roufftau. ) j
EMPLOI. Double emploi, triple emploi, quadruple
emploi I. Il y a dans la gamme diatonique u t re mi f a
fol la fi ut, trois notes , u t , f a , f o l , qui portent
l’açcord parfait majeur,.auxquelles on peut, fans fortir
du ton , ajouter une Axte; u t m\ f o l la ; f a la u t re ;
fo l j i re mi. Il y a auffi dans la même gamme trois
notes, re y m i) la , qui portent l’accord parfait mineur,
& qui peuvent, fans fortir du mode, porter la fep-
tième .; re f a la ut ; mi fo l j i re ; la u t mi f o l : .or le
renverfement d e . ces feptièmes donne les iccords de
fixte-quinte f a la ut re ; f o l j i re mi ; ut mi f o l la.
D o n t., foit qu’on regarde i’accord de Axte-quinte
comme direft, ou comme renverfé de la Amp^-fep-
tième, oh aura toujours dans un feul m o k ( j e pa le
dans le fyfiême de Rameau ) tro-is accords de lix t e ,
l’un fur la ton ique, l’autre fur la quatrième note du
ton , l’autre fur la cinquième.
Ces trois accords ont à pen.-près la même forme,
mais ils n’ont ni.les mêmes rapports, ni le* mêon-s
fondions.
L’accord ut mi fo l U ( je me fuppôle toujours en v t )
S s s