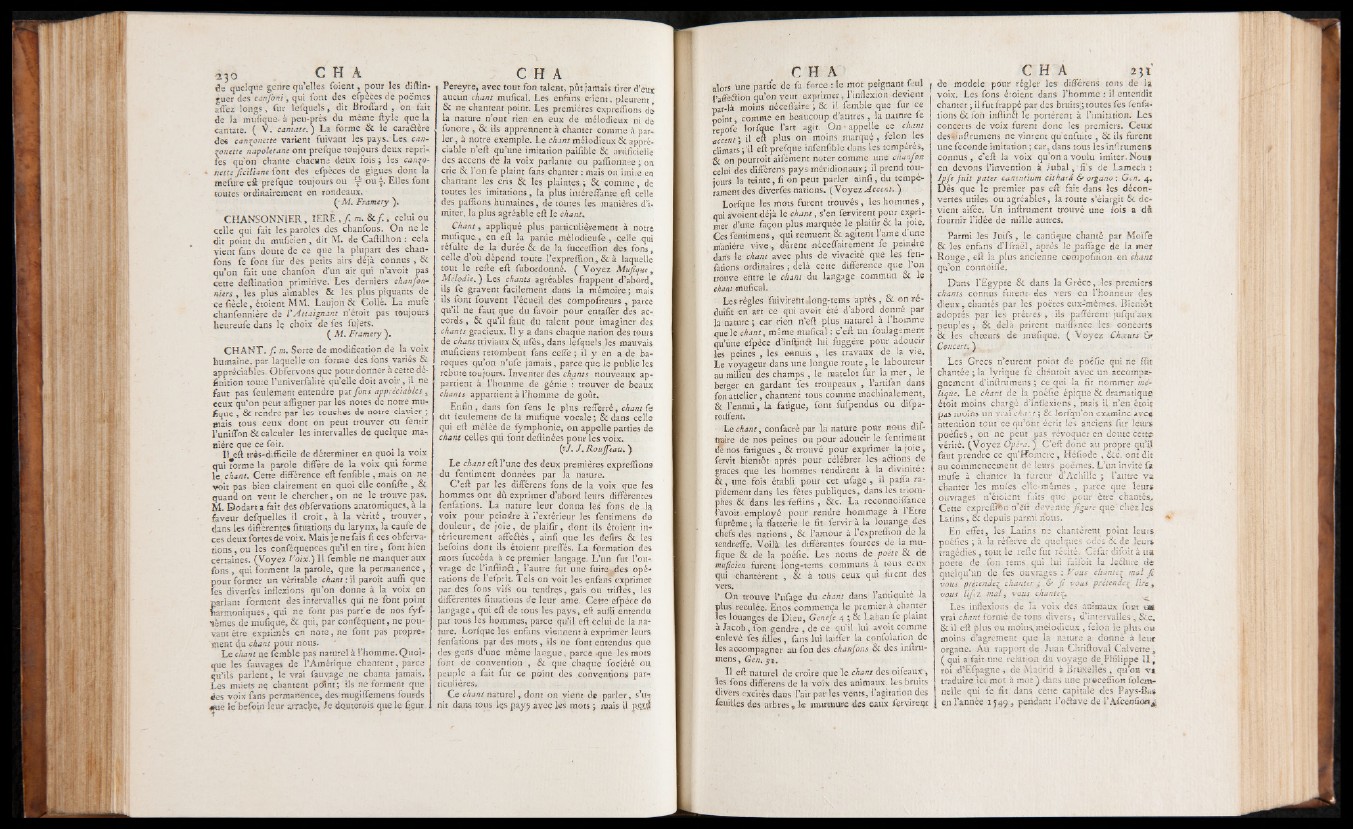
0 R À
6e quelque genre qu’elles (oient, pour les diffin-
iuer des cunfoni, qui font des efpeces de poëmes
affez longs, fur lefquels, dit Broffard , on fait
de la mufique. à peu-près du même ftyle que la
cantate. ( V . cantate. ) La forme & le cara'ftère
des cantfonette varient fuivant les pays.’Les can-
rontttc napoletane ont prefque toujours deux repri-,
les qu'on chante chacune deux- fois ; les canço-
nette ftciliane font des cfpèces de gigues dont la
raefure e£t prefque toujours ou (3 ou y. Elles font
toutes ordinairement en rondeaux.
(• M. Framery ).
CHANSONNIER, 5ERE . f .m .S t f . , celui ou
celle qui fait les paroles des chanfons. On ne le
dit point du muficien, dit M. de Caililhon : cela
vient fans doute de ce que la plupart dès chanfons
fe font (lir des petits airs déjà connus , &
qu’on fait une chanfon d’un air qui n’avoit pas
cette deftinatioîi primitive. Les derniers chanfon-
mers , les plus aimables 5c les plus piquants de
’Ce fiècle, étoient MM. Laujon & Collé. La mufe
chanfennière de l 'Atteignant n’étoit pas toujours
heureufe dans lq choix de fes fujets.
( M. Framery ).
CH AN T , f . m. Sorte de modification de la voix
humaine, par laquelle on forme des feins variés &
appréciables, Obfervons que pour donner à cette définition
toute l’univerfalité qu’elle doit avoir, il ne
faut pas feulement entendre par font appréciables ,
ceux qu’on peut affigner par les notes de notre mu.
fique , & rendre par les touches de notre clavier ;
mais tous ceux dont on peut trouver où fentir
l’uniffon & calculer les intervalles de quelque ma.
Bière que ce foit.
Il eft très-difficile de déterminer en quoi la voix
qui forme la parole diffère de la voix qui forme
le chant. Cette différence eft fenfible , mais on ne
voit pas bien clairement en quoi elle confifte , 8ç
quand on veut le chercher, on ne le trouve pas.
M. Bodart a fait des obfervations anatomiques, à la
laveur defquelles il croit, à la vérité , trouver,
dans les différentes fituatloqs du larynx, la caufe de
ces deux fortes de voix. Mais je ne fais fi ces obfervations
, ou les conféquences qu’il en tire , font bien
certaines. (Voyez Voix.) 11 femble ne manquer aux
fons , qui forment la parole, que la permanence,
pour former un véritable chant-.\\ paroît auffi que
les diverfes inflexions qu’on donne à la voix en
arlanî forment des intervalles qui ne font point
armoniques, qui ne font pas parte de nos fyf-
vèmes de mufique, & qui, par conféquent, ne pouvant
être exprimés en note, ne font pas propre-,
ment cfo chant pour nous.
Le chant ne femble pas naturel à l’homme. Quoique
les fauvages de l’Amérique chantent, parce
qu’ils parlent, le vrai fauyage ne chanta jamais.
Les imiets ne chantent pdînt; ils ne forment que
des voix fans permanence, des mugiffemens fourds
#ue le befoin leur arrache. Je dqnterois que le fieur
C R A
Pereyfe, avec tout fon talent, pût jamais tirer d’eux
aucun chant mufical. Les enfans crient, pleurent
& ne chantent point. Les premières expreflions de
la nature n’ont rien en eux de mélodieux ni de
fonore , Sc ils apprennent à chanter comme à parle
r , à notre exemple. Le chant mélodieux 8c appréciable
n’eft qu’une imitation paifible 8c artificielle
des accens de la voix parlante ou paflionnée ; on
crie 8c l’on fe plaint fans chanter : mais on imite en
chantant les cris 8t les plaintes,; Sç comme, de
toutes les imitations, la plus intéirelîante, eft celle
des pafîions humaines, de toutes les manières d’i-
miter, la plus agréable eft le chant„
Chant, appliqué plus particulièrement à notre
mufique, en eft la partie mélodieufo, celle qui
réfulte de la durée 8c de la fuçceflîon des fons,
celle d’où dépend toute l’expreftion, 8c à laquelle
tout le refte eft fubordonné. ( Voyez Mufique t
Mélodie. ) Les chants agréables frappent d’abord,
il$ fe gravent facilement dans la mémoire; mais
ils font fouvent l ’écueil des compofiteurs, parce
qu’il ne faut que du favoir pour entaffer des accords
, 8c qu’il faut du talent pour imaginer des
chants gracieux. Il y a dans chaque nation des tours
de chant triviaux 8c ufés, dans lefquels les mauvais
muficiens retombent fans ceffe ; il y en a de baroques
qu’on n’ufe jamais, parce que le public les
rebute toujours. Inventer des ckants nouveaux appartient
à l’homme de -génie : trouver de beaux
chants appartient à l’homme de goût.
Enfin, dans fon fens le plus re (Terré, chant fe
dit feulement de la mufique vocale ; 8c dans celle
qui eft mêlée de fymphonie, on appelle parties de
chant celles qui font deftinées pour les voix,
(tj, ƒ. Roujfeau. )
Le chant eft Tune des deux premières expreflion9
du fentîment données par la nature.
C ’eft par les. différens fons de la voix que lesf
hommes ont dû exprimer d’abord leurs différentes
fenfations. La nature leur donna les fons de la
voix pour peindre a l’extérieur les fentimens de
douleur, de jo ie , deplaifir, dont ils étoient in*
térieurement affeélés , ainfi que les defirs 8c les
hefoins dont ils étoient preffés. La formation des
mots fuccéda à ce premier langage. L’un fut l’oun
vrage de l’inftinft, l ’ântre fut une fuite-gdes opérations
de l’efprit. Tels on voit les enfans exprimer
par des fons vifs ou tendres, gais ou triftes, les
différentes fituations de leur amç. Cette efpèce de
langage, qui eft de tous les pays, eft aufti entendu
par tous les hommes, parce qu’il eft Celui de la nature.
Lorfque les enfans viennent à exprimer leurs
fenfations par des mots, ils ne font entendus que
des gens d’une même langue, parce «que les mots
font de convention , & que chaque fociété ou
peuple a fait fur ce point des conventions pat*
ticulières,.
Ce chant naturel, dont on vient de parler, s’u?
nit dans tous les pay? avec les mots ; mais il
C H A
alors une partie de fa force : le mot peignant foui
l’affeftion qu’on veut exprimer , l’inflexion devient
par-là moins néceffaire ; 8c il femble que fur ce
point, comme en beaucoup d’autres , la natnre fe
repofe lorfque l’art agit. On-appelle as chant
accent', il eft plus on moins marqué, félon les
climats;'il eft prefque infenfible dans les tempérés,
& on pourroit aifément noter comme une chanfon
celui des différens pays méridionaux ; il prend toujours
la teinte, fi on peut parler ainfi, du tempérament
des diverfes nations. (V oy e z Accent.)
Lorfque les mots furent trouvés, les hommes,
qui aVoientdéjà le chant, s’en fervirent pour exprimer
d’une façon plus marquée le plaifir 8c la joie.
Ces fontimens, qui remuent 8c agitent l’ame d’une
manière v ive -, durent néceffaire ment fe peindre
dans le chant avec plus de vivacité que les fen-
fotions ordinaires ; delà cette différence que l’on
trouve entre le chant du langage commun 8c le
chant mufical.
Les règles fuivireftt *long-tems 'après , 8c on réduisit
en art ce qui avoit été d’abord donné par
la nature ; car rien n-eft plus naturel à l’homme
que le chant, même mufical ^ c’eft un Soulagement
qu’une efpèce d’inftinéè lui fuggère pour adoucir
les peines , les ©»nuis , les travaux de la vie.
Le voyageur dans une longue route 9 le laboureur
au milieu des champs , le matelot fur la mer, le
berger en gardant fes troupeaux , l’artifan dans
fon attelier , chantent tous comme machinalement,
& l’ennui , la fatigue, font fufpendus ou difpa-
roiffent.
Le chant, confacrè par la nature poür nous dit-
iraire de nos peines ou pour adoucir le fontiment
lie nos fatigues , 8c trouvé poür exprimer la jo ie ,
fervit bientôt après pour célébrer les aélions de
grâces que les hommes rendirent à la divinité :
& , une fois établi pour cet ufage, il pafla rapidement
dans les fêtes publiques, dans les triomphes
8c dans les feftins , 8cc. La reconnoiffance
l’avoit. employé pour rendre ho ni mage à l’Etre
fuprême ; la flatterie le fit fervir à la louange, des
chefs des nations , 8c ï’amcmr à l’expreftion de la
tendreffe. Voilà les différentes fourçes de la mu-
fique 8c de la poéfie. Les noms de poète 8c de
muficien furent long-tems communs a tous ceux
qui chantèrent , & à tous ceux qui firent des
vers.
On trouve l’ ufage du chant dans l’antiquité la
plus reculée. Enos commença le premier à chanter
les louanges de Dieu, Genefe 4 ; 8c Laban fe plaint
à Jacob, fon gendre , de ce qu’il lui avoit comme
enlevé fes filles, fans lui lai (Ter la confolation de
les acoompagner au fon des chanfons 8c des inftru-
mens, Gen. j i .
Il eft naturel de croire que le chant des oifeaux,
les fons différens de la voix des animaux, les bruits
divers excités dans l’air par les vents, l’agitation des
fouilles des arbres » 1« murmure des eaux fier virent
C H A Mt
j de modèle pour régler les différens tons de la
I voix. Les fions étoient dans l’homme : il entendit
chanter ; il fut frappé par des bruits;; toutes fes fenfa-
j tioiis 8c fon inftiné! le portèrent à l’imitation. Les
concerts de voix furent donc les premiers. Ceux
des%inftrumens ne vinrent quenfui te , 8c ils furent
une fécondé imitation ; car, dans tous les inftrumens
connus , e’eft la voix qu’on a voulu imiter. Nous
en devons l’invention à Jubal, fi s de Lamech i
Ipfe fuit pater camntium cïlharâ & oreano : Gen, 4,
Dès que le premier pas eft fait dans les découvertes
utiles ou agréables, la route s’élargit 8c devient
aifée. Un inftrument trouvé une fois a dâ
fournir l’idée de mille autres.
Parmi les Juifs, le cantique chanté par Moïfe
8c les enfans d’ Ifraël, après le jpaffage de la mef
Rouge , eft 12 plus ancienne compofition en chant
qu’on connoiue.
Dans l’Egypte 8c dans la Grèce,des premiers
chants connus furent- des vers en l'honneur des
dieux, chantés par les poètes eux-mêmes. Bientôt
adoptés par les prêtres, ils paffèrent jiifqu’aux
peuples ; & delà prirent naiffance. les- concerts
8c les choeurs de mufique. ( Voyez Choeurs
Concert^}
Les Grecs n’eurent point de poéfie qui ne fut
chantée ; la lyrique fe çhântoit avec un accompagnement
d'infini mens ; ce qui la fie nommer rné-
liqùe. Le chant de la poéfie épique 8c dramatique?
é'toit moins chargé d’inflexions, mais il n’en étoit
pas moins un vrai charte 8c lorfqu’on examine avec
attention tout ce qu’ont écrit les anciens fur leurs
poéfieS, on ne peut pas révoquer en doute cette
vérité. (V oyez Opéra. ) C ’eft donc au propre qu’il
faut prendre ce qu’ffomere, Héfiode , 8cc. ont dit
au commencement de leurs poëmes. L’un invite fa
mufe à chanter la fureur a Achille ; l ’autre va
chanter les mu Tes ellc-mêmes , p^rce que leurs
ouvrages n’étoient fûts que pour être chantés..
Cette exprefïfàn n’ éft devenue figure que'chez les
Latins, 8c depuis parmi nous.
En effet les Latins ne chantèrent point leurs
poéfies; à la néferve de quel cpies odes 8c de leurs
tragédies, tout le refte fut réc■ fié Céfar difioTr à 11a
poëte de fon . tems qui lui f'aifoit la Jeçîure de
quelqu’un de fes ouvrages : Vous chante£ 1nal fi
vous préie.nde^ chanter ; & f i vous prétendeç lire,
vous l i f t mal , vous chanteç.
Les inflexions de la voix des animaux font m
vrai chant formé de tons divers, d’intervalles , 8cc.
8c il eft plus ou moins,mélodieux , félon le plus ou
moins d’agrement que la nature a donné à leur
organe. Au rapport de Juan Chriftoval Calvette ,
( qui a fait une relation du voyage de Philippe II ,
roi •.d’Efpagne , de Madrid à Bruxelles , qu’on va
traduirer.ici mot à mot ) dans une preceflion folem-
! nelle qui fe fit dans cette capitale des Pays-Bas
I en l’année 1549, pendant l’oâ:ave de l’Afcenûoo^