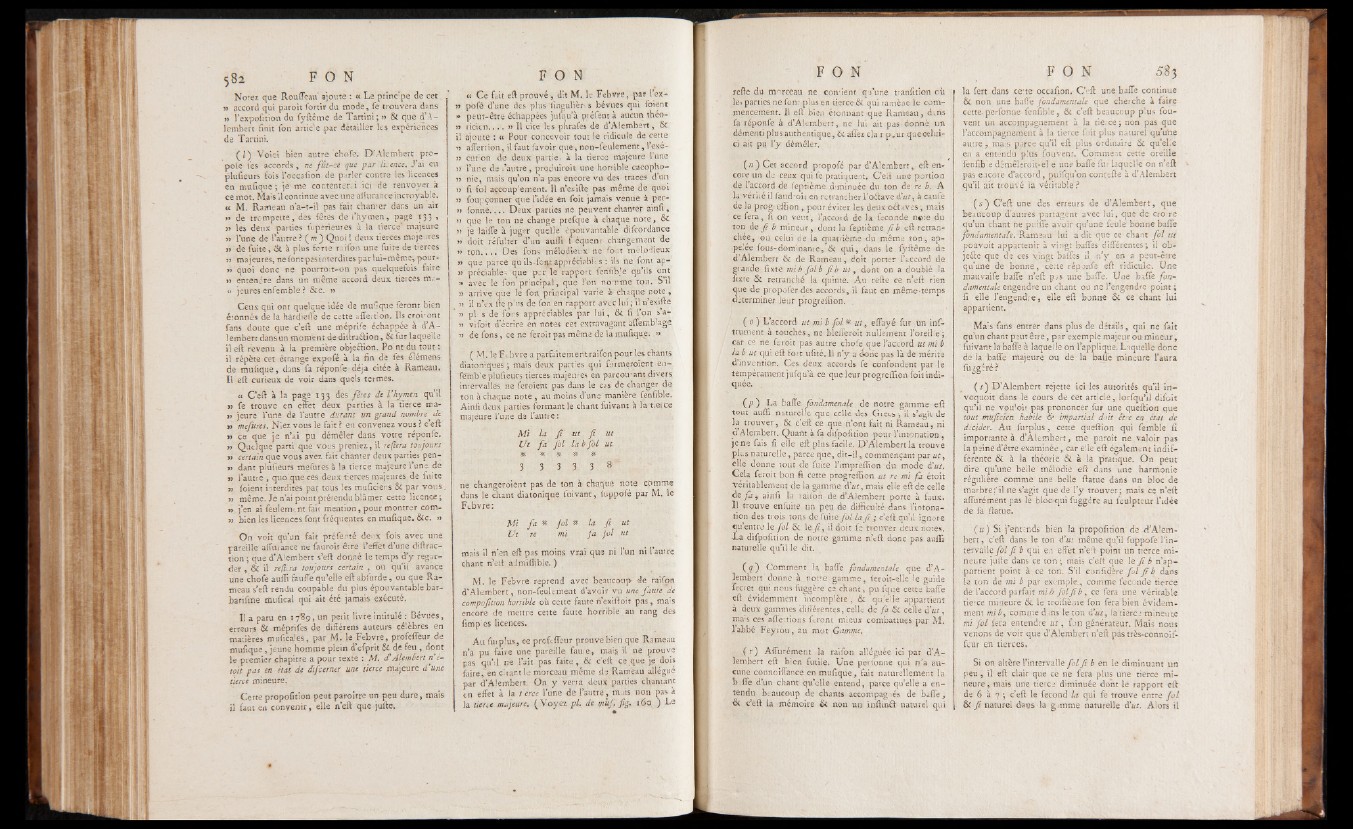
Notez que Rouffeau ajoute : « Le principe de cet
î> accord qui paroît fortir du mode, fe trouvera dans
j) l'expofition du fyftême de Tartini; » & que d’Alembert
finit Ton article par détailler les expériences
de Tartini.
(Z ) Voici bien autre chofe. D'Alembert pro-
poie les accords, ne fut-ce que par licence. J’ai eu
plufieuFS fois l’occafion de parler contre les licences
en mufique; je' me contenterai ici de renvoyer à
ce mot. M,ais il continue avec une allnrance incroyable.
«t M. Rameau n’a-t-il pas fait chanter dans un air
n de trompette, des fêtes de l’hymen, page 133 ,
» les deux parties lupérieures à ia tierce majeure
» l’une de l’autre? (m ) Quoi l deux tierces majeures
» de fuite, ÔL à plus forte rsifon une fuite de tierces
jj majeures, ne font pas interdites par lui-meme, pour-
j> quoi donc ne pourro;t-on pas quelquetois faire
» entendre dans un même accord deux tierces m<:-
« jeures enfemble ? &c. »
Ceux qui ont quelque idée de mufique feront bien
étonnés de la hàrdieffe de cette ?.ffert:on. Ils croiront
fans doute que c’eft une méprife échappée à d’A -
lemberr dans un moment de diftrattion, & fur laquelle
il eft revenu à la première objeéfion. Po nt du tout :
il répète cet étrange expofé à la fin de les elemens
de mufique, dans fa réponfe déjà citée a Rameau.
Il eft curieux de voir dans quels termes.
« C ’eft à la page 133 des fêtes de Vhymen qu’il
» fe trouve en effet deux parties à la tierce roa-
» jeure l’une de l’autre durant un grand nombre de
» mefures. Niez vous le fait ? en convenez vous ? c’eft
» ce que je n’ai pu démêler dans votre réponfe.
jj Quelque parti que vous preniez, il refiera toujours
j> certain que vous avez fait chanter deux parties pen-
jj dant plufiéurs mefures à la tierce majeure l’une, de
jj l’autre, quoqueces deux tierces majeures de fuite
jj foient interdites par tous les muficiens & par vous.
» même. Je n’ai point prérendu blâmer cette licence;
» j’en ai feulement fait mention, pour montrer com-
j j bien les licences foqt fréquentes en mufique. &c. »
On voit qu’un fait préfenté deux fois avec une
pareille afiuraace ne fauroit être l’effet d’une diffraction
; que d’Alembert s’eft donné le temps d’y regarder
, & il reftaa toujours certain , ou qu’il avance
une chofe aufli fauffe qu’elle eft abfurde, ou que Rameau
s’eft rendu coupable du plus épouvantable bar-
barifme mufical qui ait été jamais exécuté.
Il a paru en 1789, un périt livre intitulé : Bévues,
erreurs & méprifes de différens auteurs célèbres en
matières muficales, par M. le Febvre, proféffeur de
mufique, jeune homme plein d’efprit & de feu , dont
îe premier chapitre a pour texte : M. <£ AfemBert ne-
toit pas en état de difeerner une tierce majeure d’une
tierce mineure.
Cette propofition peut paroitre un peu dure, mais
il faut en convenir, elle n’eft que jufte.
« Ce fait eft prouvé, dit M.. le Febvre, par l’ex-
jj pofé d’une des plus fingulièr-. s bévues qui foient
» peut-être échappées jufqu’à préfent à aucun theo-
» ricien.. . . » Il cite les phrafes de d’Alembert, &
il ajoute : « Pour concevoir tout le ridicule de cette
» affertion, il faut favoir que, noo-féulement, l’exe-
» cut’on de deux partie, à la tierce majeure lune
» l’une de l’autre, procluiroit une horrible cacopho-
» nie, mais qu’on n’a pas encore vu des traces d’un
» fi fol açcoup'ement. Il n’exifte pas même de quoi
» foupçonner que l’idée en foit jamais venue à per-
» fonne.. . . Deux parties ne peuvent chanter ainfi,
» que le ton ne change prefque à chaque note, &
» je laiffe à juger quelle épouvantable difcordance
» doit réfulter d’un aufti fréquent changement de
» to n .... Des fons mélodieux ne foat mélodieux
» que parce qü ils-font appréciabiVs : ils ne font ap-
» préciables que par. le rapport fehfibje qu’ils ont
» avec le fon principal, què l’on nomme ton. S il
» arrive que le fon principal varie à- chaque note ,
» il n’é'x fte p'us de fon en rapport avec lui ; il n’exifte
» pl. s de fors appréciables par lui, & fi l’on s’a-
» vifoit d’écrire en notes cet extravagant affemblage
» de fons, ce ne feroit pas même de la mufique;.»
( M. le Febvre a parfaitement rai fon pour les chants
diatoniques ; mais deux parties qui fdrmeroient en-
fe'mb'e plufiéurs tierces majeures en parcourant divers
intervalles ne feroient pas dans le cas' de changer de
ton à chaque note, au moins d'une manière fenfible.
Ainfideux parties formant le chant fuivant à la tieice
majeure l’une de l’autre :
Mi la. f i ' ut f i ut
Ut fa fol la b fol ut
X * * • #
3 3 3 3 3 8 "
ne changeraient pas de ton à chaque note comme
dans le chant diatonique fuivant, fuppofé par M. le
Ftbvre:
Mi fa * fol * la f i ut
Ut re mi fa Jol ut
mais il n'en eft pas moins vrai que ni l’un ni l’autre
chant n’eft admiffible. )
M. le Febvre reprend avec beaucoup- de raifon
d’Alembert, non-feulement d’avoir vu une faute de
compofition horrible où cette faute ri’exiftoit pas, mais
encore de mettre cette faute horrible au rang des
fimp es licences.
Au fur plus, ce prefiffeur prouve bien que Rameau
n’a pu faire une pareille fau.e, mais il ne prouve
pas quM ne l’ait pas faite, & c’eft ce que je dois
faire,'en citant le morceau même de Rameau allégué
par d’Alembert. On y verra deii* parties chantant
en effet à la t erce l’une de l’autre, mais non pas à
la tierce majeure. (V oy e z pl. de iflitfi fig.. 160,. ) Le
refte du morceau ne --confient q j ’une tranfition eu
lés parties ne fon; plus en tierce,& qui ramène le commencement.
Il eft bien étonnant que Rameau, dins
fa réponfe à d’Alembert, ne lui ait pas'donné un
démenti plus authentique, & affez cia r p„ur que celui-
ci ait pii Yy démêler.
(».) Cet accord propofé par d’Alembert, eft encore
un de ceux qui fe pratiquent. C’eft une portion
de l’accord de leptième diminuée du ton de re b. A
la vérité il faud'oit en retrancher l’o&ave d’utx à caufe
de la progi effio-n , pour éviter les deux octaves ; mais
ce fera, fi on veut, l’accotd de la fécondé n©:e du
ton de f i b mineur, dont la feptième f i b eft. retranchée,
ou celui de la quatrième du même ton, appelée
fous-dominante, & qui, dans le fyftême de
d’Alembert & de Rameau, doit porter l’accord de
grande fixte mi b .fol b f i b ut, dont on a doublé la
fixte & retranché la quinte. Au refte ce n’eft rien
que de propofer des accords, il faut en même-temps
déterminer leur progreffion.
O ) L’accord ut mi b fol % ut a effayé fur un inf-
trument à touches, ne blefferoit nullement l’oreille;,
car ce ne fer Oit pas autre chofe que l’accord ut mi b
la b. ut qui eft fort ufité. Il n’y a donc pas là de mérite
d’invention. Ces deux accords fe confondent par le
tempérament jufqu’à. ce que leur progreffion foit indi- .
quée.
(ƒ>) La baffe fondamenale de notre gamme eft
tout aufti naturelle que celle des Grecs il s’agit de
la trouver, & c’eft ce que n’ont fait ni Rameau, ni
d Alembert. Quant à fa difpofition pour l’intonation,
je ne fais fi elle eft plus facile. D ’Alembert la trouve
pits naturelle, parce que, dit-il, commençant par ut,
elle donne tout de fuite l’impreftion du mode d’ut.
Cela feroit bon fi cette progreffion ut re mi fa étoit
véritablement de la gamme d’ut, mais elle eft de celle
oq f a , ainfi la îaifoh de d’Alembert porte à faux.
11 trouve enfuite un peu de difficulté dans l’intonation
des trois tons de faite folia f i ; c’eft quM ignore
qu’entr>j le fol & le f i i il doit fe trouver deux notes.
La difpofition de notre gamme n’eft donc pas aufti
naturelle qu’il le dit.
( 7 ) Comment la, baffe fondamentale que d’A lembert
donne à notre gamme, feroit-elle le guide
fecret qui nous fuggère ce chant, pu fque cette baffe
eft évidemment incomplète, & qu’elle- appartient
à deux gammes "différentes, celle de fa & celle d’ut,
ma’s ces affections feront mieux combattues par M.
l’abbé Feytou, au mot Gamme.
( r) Affurément la raifon alléguée ici par d'Alembert
eft bien futile. Une perlonne qui n’a aucune
connoiffance en mufique, fait naturellement la
b.ffe d’un chant qu’elle entend, parce qu’elle a entendu
beaucoup de chants accompagnés de baffe,
& çleft la mémoire & non un inftinét naturel qui
la fert dans ce:te occafion. C ’eft une baffe continue
& non une baffe fondamentale que cherche à faire
cette, perfonne fenfible, & c’eft beaucoup plus fou-
vent un accompagnement à la tie; ce ; non pas que
l’accompagnement à la tierce foit plus naturel qu’une
autre , mais parce qu’il eft plus ordinaire & qu’elle
en a entendu plus fouvênr. Comment cette oreille
fenfible démêlcroit-el e une baffe fur laqueHé on n’eft
pas encore d’accord, puifqu’on conte fte à d’Alembert
qu’il ait trouvé la véritable ?
( j ) C’eft une des erreurs de d’Alembert, que
beaucoup d’autres partagent avec lui , que de cro-re
qu’un chant ne pififfe avoir qu’une feule bonne baffe
fondamentale. Rameau lui a dit que ce chant fol ut
pôûvoit appartenir à vingt baffes différentes; il objecte
que de ces vingt baffes il n’y en a peut-être
qu’une de bonne, ce;te réponfe eft ridicule. Une
màuvaife baffe n’eft pss une baffe. Une baffe fondamentale
engendre un chant ou ne l’engendre point ;
fi elle l’engendre, elle eft bonne & ce chant lui
appartient. /
Ma:s fans entrer dans plus de détails, qui ne fait
qu’un chant peut être, par exemple majeur ou mineur,
‘ fuivant la baffe à laquelle on l’applique. Laquelle donc
de la baffe majeure ou de la baffe mineure l’aura
fuggéré?
( / ) D ’Alembert rejette ici les autorités qu’il in-
voquoit dans le cours de cet article, lorfqu’il difeit
qu’il ne vou'oir pas prononcer fur une queftion que
tout muficien habile & impartial doit être en état de
décider. Au furplus, cette queftion qui femble fi
importante à. d’Alembert, me paroît ne valoir pas
la peine d’être examinée, car elle eft également indifférente
& à la théorie & à la pratique. On peut
dire qu’une belle mélodie eft dans 'une harmonie
régülièrè comme une belle ftatue dans un bloc de
marbre;'il ne s’agit que de l’y trouver; mais ce n’eft
affurément pas le bloc qui fuggère au fculpteur l’idée
de fa ftatue.
(u ) Si j’ent-nds bien la propofition de d’A'em-
bert, c’eft dans le ton déut même qu’il fuppofe l’intervalle
fol f i b qui en effet n’e't point un tierce mineure
jufte dans ce ton ; mais c’eft que 1 e f i b n’appartient
point à ce ton. S’il confidère fol f i b dans
le ton de mi b par exemple., comme fécondé tierce
de l’accord parfait mi b fol f i b , ce fera une véritable
tierce mineure & le troifième fon fera bien évidemment
mib, comme dans le ton d’«r, la tierci mineute
mi fol fera entendre u t , fon générateur. Mais nous
venons de voir que d’Alembert n’eft pas très-connoif-
feur en tierces.
Si on altère l’intervalle fo l f i b e n le diminuant un
peu , il eft clair que ce ne fera plus une tierce mineure,
mais une tierce diminuée dont le rapport eft
de 6 à 7 ; c’eft le fécond la qui fe trouve entre Jol
& f i naturel dacs la gamme naturelle d'ut. Alors il