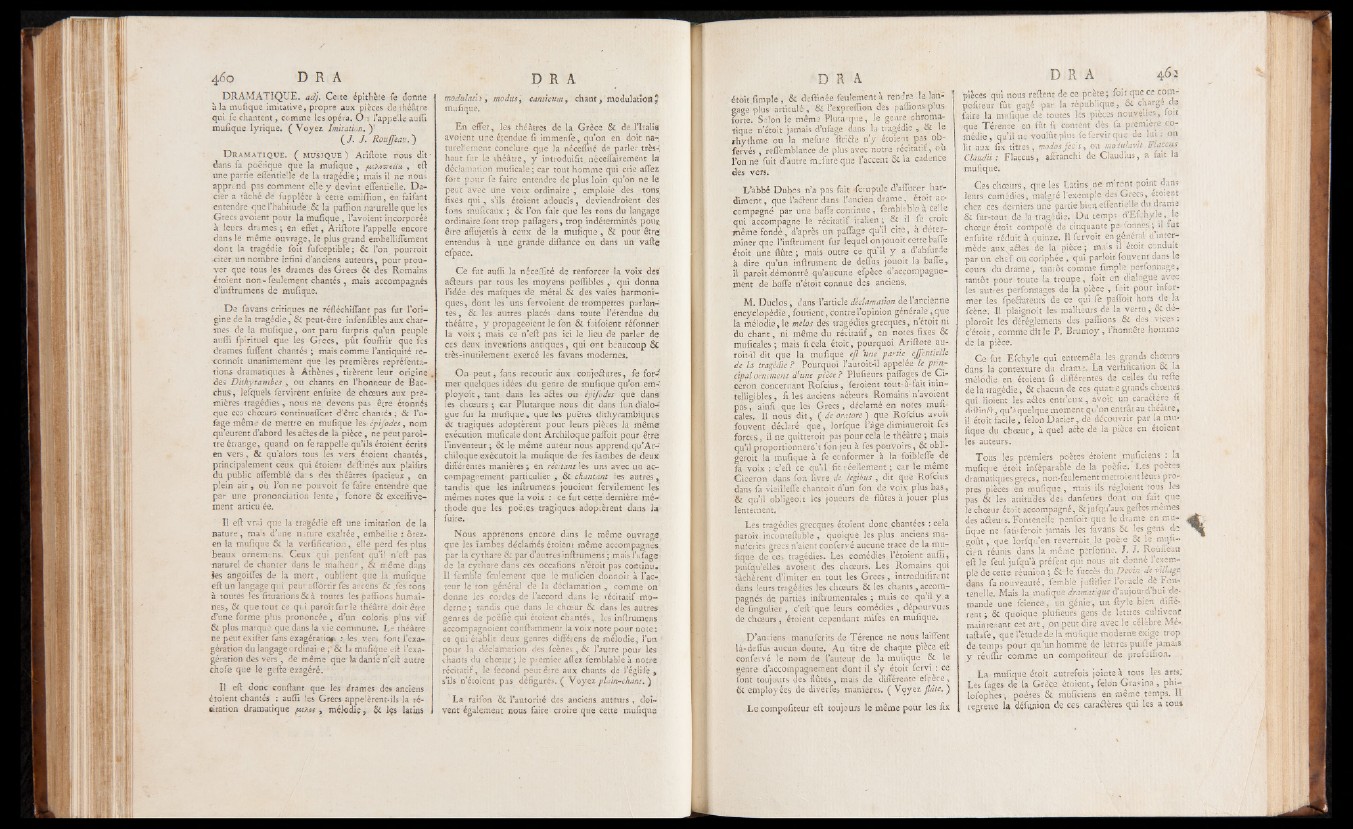
DR AMATIQUE, adj. Cette épithète fe donne
à la mufique imitative, propre aux pièces de théâtre
qui fe chantent, comme les opéra. On l’appelle auffi
mufique lyrique. ( Voyez Imitation. ) ’
( J. J. RouJJeau. )
Dramatique. ( musique) Ariftote nous dit *
dans fa poétique que la mufique , piXozrotïcc , eft
une partie effentie'le de la tragédie ; mais il ne nous
apprend pas comment elle y devint effentielle. Da-
cier a tâché de fuppléer à cette omiflion, en faifant
entendre que l’habitude _& la paffion naturelle que les
Grecs avoient pour la mufique, l’avoient incorporée
à leurs drames ; en effet, Ariftote l’appelle encore
dans le même ouvrage, le plus grand embellifïement
dont la tragédie foit fufceptible; - & l’on pourroit
citer, un nombre infini d’anciens auteurs, pour prouver
que tous les drames des Grecs & des Romains
étoient non- feulement chantés , mais accompagnés
d’inftrumens de mufique.
De favans critiques ne réfléchiflant pas fur l’origine
de la tragédie, & peut-être infenfibles aux charmes
de la mufique, ont paru furpris qu’un peuple
auffi fpirituel que les Grecs, pût fouffrir que fes
drames fuffent chantés ; mais comme l’antiquité re-
•connoît unanimement que les premières repréfenta-
tions dramatiques à Athènes, tirèrent leur origine ,
des Dithyrambes , ou chants en l’honneur de Bac-
chus, lefquels fervirent enfuite de choeurs aux premières
tragédies, nous ne devons pas être étonnés
que ces choeurs continuaffent d’être chantés ; & l’u-
fage même de mettre en mufique les épifodes, nom
qu’eurent d’abord les aéles de la pièce, ne peut paroî-
tre étrange, quand on fe rappelle qu’ils étoient écrits
en vers, & qu’alprs tous les vers étoient chantés,
principalement ceux qui étoient deftinés aux plaifirs
du public affemblé dar s des théâtres fpacieux , en
plein air, où l’on ne pouvoit fe faire entendre que
par une prononciation lente, fonore & exceffive-
ment articulée.
Il eft vrai que la tragédie eft une imitation de la
sature, ma-s d’une nature exaltée, embellie : ôtez-
en la mufique & la verfification, elle perd fes plus
beaux ornemens. Ceux qui penfent qu’il n’eft pas
naturel de chanter dans le malheur, & même dans
les angoiffes de la mort, oublient que la mufique
eft un langage qui peut afîôrtir fes aeeeris & .fes tons
à toutes les fituations & à toutes les gaffions humaines,
& que tout ce qui paroît fur le théâtre doit être
d’une forme plus prononcée, d’un coloris plus vif
& plus marqué que dans la vie commune. Le théâtre
ne peut exifter fans exagération ; les vers font l’exagération
du langage ordinai re ; & la mufique eft l’exagération
des vers , de même que la danfe n’eft autre
chofe que le gefte exagéré.'
Il eft donc confiant que les drames des anciens
étoient chantés : auffi les Grecs appelèrent-ils la ré- I
citation dramatique fciMs, mélodie, & lçs latins 1
modulati j , modus'y canticum, chant, modulation £
mufique.
En effet, les théâtres de la Grèce & de l’Itali«
avoient une étendue fi immenfe, qu’on en doit na-{
tureHement conclure qiie la néceffité de parler très«{
haut.fur le théâtre, y introduifit, néceffairement la'
déclamation muficale; car tout homme qui crie allez
fort pour fe faire entendre de plus loin qu’on ne le
peut avec une voix ordinaire emploie des tons
fixes qui, s’ils étoient adoucis, deviendroient des
fons muficaux ; & l’on fait que les tons du langage
ordinaire font trop paffagers, trop indéterminés pour,
être affujettis à ceux de la mufique, & pour être'
entendus à une grande diftance ou dans un vafte
efpace.
Ce fut auffi la néceffité de renforcer la voix des
aéleurs par tous les moyens poffibles , qui donna
l’idée des mafques de métal & des vafes harmoniques,
dont les uns fervoient de trompettes parlan-l
tes, & les autres placés dans toute l’étendue du
théâtre, y propageoient le fon & faifoient réfonner
la voix ; mais ce n’eft pas ici le lieu de parler de
ces deux inventions antiques, qui ont béaucoup ÔC
très-inutilement exercé les favans modernes.
On peut, fans recourir aux . conjectures, fe for-»
mer quelques idées du genre de mufique qu’on em-
ployoît, tant dans les aétes ou épifodes que dans
les choeurs ; car Plutarque nous dit dans fon dialo^
gue fur la mufique, que les poètes dithyrambiques
& tragiques adoptèrent pour leurs pièces la même
exécution muficale dont Àrchiloque paffoit pour être
l’inventeur; & le même auteur nous apprend qu’Ar-
chiloque exécutoit la mufique de fes ïambes de deux
différentes manières ; en récitant les uns avec un accompagnement
particulier , & chantant les autres,
tandis que les inftrumer.s jouoient fervilement les
mêmes notes que la voix : ce fut cette! dernière méthode
que les poètes tragiques adoptèrent dans la
fuite.
Nous apprenons encore dans le même ouvragé
que les ïambes déclamés étoient même accompagnés,
par la cythare & par d’autres inftrumens ; mais l’ufage
de la cythare dans ces occafions n’étoit pas continu.
Il femble feulement que le mufiden donnoit à l’acteur
le ton général de la déclamation , comme on
donne les cordes de l’accord dans le récitatif moderne
; tandis que dans le choeur & dans les autres
genres de poëfie qui étoient chantés , les infirumens
accompagnoienr co.nftammenr la voix note pour note :
ce qui établit deux genres différens de mélodie, l’un '
pour la déclamation des fcènes , oC l’autre pour les
chants du choeur ; le premier affez femhlable à notre
récitatif, le fécond peut être aux chants de l’églife *
s’ils n’étoient pas défigurés. ( Voyez plain-chant. )
La raifon & l’autorité des anciens auteurs , doivent
également nous faire croire que cette mufique
étoit fimple , & deftinée feulement à rendre le lan- T
gage plus articulé, & l’expreffion des paffions plus 1
forte. Selon le même Plutarque, le genre chromatique
n’étoit jamais d’ufage dans la tragédie , & le
rhythme ou la mefure ftriéte n’y étoient pas ob-
fervés , reffemblance de plus avec notre récitatif, ou
l’on ne fuit d’autre hufure que l’accent & la cadence
des vers.
L’abbé Dubos n’a pas fait -fcrupule d’affurer hardiment
, que l’a&eur dans l’ancien drame, étoit accompagné
par une baffe continue, fembieble a celle
qui accompagne le récitatif italien ; & il fe croit
même fondé, d’après un paffage qu il cite, a déterminer
que l’inftrument fur lequel on jouoit cette baffe
étoit une flûte; mais outre ce qu’il y a dabfurde
à dire qu’un inftrument de deffus jouoit la baffe,
il paroît démontré qu’aucune eîpèce d’accompagnement
de baffe ri’étoit connue des anciens.
M. Duclos, dans l’article déclamation de l’ancienne
encyclopédie, foutient, contre l’opinion générale ,.que
la mélodie, le rnelos des tragédies grecques, n’étoit ni
du chant, ni même du récitatif, en notes fixes &
muficales ; mais ficela étoit, pourquoi Ariftote au-
roit-il dit que la mufique efl une partie effentielle
de la tragédie ? Pourquoi l’auroit-il appelée le principal
ornement d'une pièce ? Plufieurs paflagés de Cicéron
concernant Rofçius, feroient tout-a-fait inintelligibles
, fi les anciens aéteurs Romains n’avoient
pas, ainfi que les Grecs, déclamé en notes muficales.
11 nous dit, ( de oratore ) que Rofcius avoit
fouvent déclaré que, lorfque l’âge diminueroit fes
forces, il ne quitteroit pas pour cela le théâtre ; mais
qu’il proportionnerait fon jeu à fes pouvoirs, & obligea
it la mufique à fe conformer à la foibleffe^ de
fa voix : c’eft ce qu’il fit réellement ; car le même
Cicéron dans fon livre de legibus , dit que Rofcius
dans fa vieilleffe chantoit d’un fon de voix plus bas,
& qu’il obligèoit les joueurs de flûtes à jouer plus
lentement.
Les tragédies grecques étoient donc chantées : cela
paroît inconteftable , quoique les plus anciens ma-
nuferits grecs n’aient confervé aucune trace de la mufique
de ces tragédies. Les comédies. l’étoient auffi,
puifqu’elles avoient des choeurs. Les Romains qui
tâchèrent d’imiter en tout les Grecs , introduifirent
dans leurs tragédies les choeurs & les chants , accompagnés
de parties inftrumentales ; mais ce qu il y a
de fingulier , c’eft que leurs comédies, dépourvues
de choeurs, étoient cependant mifes en mufique.
D ’anciens manuferits de Térence ne nous laîffent
là-deffus aucun doute. Au titre de chaque pièce eft
confervé le nom de l’auteur de la mufique & le
genre d’accompagnement dont il s’y étoit fervi : ce
font toujours des flûtes, mais de. différente elpèce,
& employées de di ver fes manières. ( Voyez flûte. )
L e compofiteur eft toujours le même pour les fix
pièces qui nous reftent de ce poète; foit que ce com-
pofiteur fût gagé par la république, & chargé de
faire la mufique de toutes les pièces nouvelles, foit
que Térence en fût fi content dès fa première comédie
, qu’il ne voulût plus fe fervir que de lui : on
lit aux fix titres, modos fecit, ou moiulavit Wlaccu s
Claudii : Flaçcus, affranchi de Claudius, a fait la
mufique.
Ces choeurs, que les Latins ne m rent point dans
leurs comédies, malgré l’exemple des Grecs, etoient
chez ces derniers une partie bien effentielle du drame
& fur-tout de la tragédie. Du temps d’Efchyle, le
choeur étoit compoié de cinquante perfonnes; il fut
enfuite réduit à quinze. Il fervoit en général d’intermède
aux aétes de la pièce ; mais il étoit conduit
par un chef ou coriphée , qui parloir fouvent dans le
cours du drame, tantôt comme fimple perfonjiage,
tantôt pour toute la troupe, foit en dialogue avec
les autres perfonnages de la pièce , foit pour informer
les fpe&ateurs de ce qui fe paffoit hors de la
fcène. Il plaignoit les malheurs de la vertu, & dé-
ploroit les déréglemens des paffions & des vices :
c’étoit, comme dit le P. Brumoy, ihonnete homme
de la pièce.
Ce fut Efchyle qui entremêla les grands chcfeurs
dans la contexture du drami, La verfification & la
mélodie en étoient fi différentes de celles eu refte
de la tragédie, & chacun de ces quatre grands choeurs
qui lioient les a êtes entr’eux, avoit un caractère u
diftinâ, qu’à quelque moment qu’on entrât au théâtre,
il étoit facile, félon Dacfer, de découvrir par la mufique
du choeur, à quel aâe de la pièce en etoient
les auteurs.
Tous les premiers poètes étoient mu fi ci en s : la
mufique étoit inféparable de la poëfie. Les poetes
dramatiques grecs, non-feulement mettoient leurs propres
pièces en mufique , mais ils regloient tous les
pas & les attitudes des danfeurs dont on fai que
le choeur étoit accompagné, & jufqu’aux geftes memes
des aéfeu! s. Fontenelle penfoit que lé drame en mufique
ne fatisferoit jamais les favans & les gens de
goût, que lorfqu’on reverroit. le poète & le nau.fi-
ci en réunis dans la même perfonne. J. J. Roùffeau
eft le feul ju{qu’à préfent qui nous ait donné l’exemple
de cette réunion ; & le fuccès du Devin de village
dans fa nouveauté, femble juftifief 1 oracle dè Fcn-
tenelle. Mais la mufique dramatique d’aujourd’hui de-
mande une fcience, un génie, un ftyle bien différent
; & quoique plufieurs gens de lettres cultivent:
maintenant cet art, on peut dire avec le célèbre Mé-,
taftafe, que l’étude de la mufique moderne exige trop
de temps pour qu’un homme de lettres puifiejamais
y réuffir comme un compofiteur de prefeffion.
La mufique étoit autrefois jointe à tous les arts.’
Les fages de la Grèce étoient, félon Gravina, philosophes
, poètes & müfïçiens en même temps. Il
regrette la défiüûon de ces caraéfères qui les a tou*