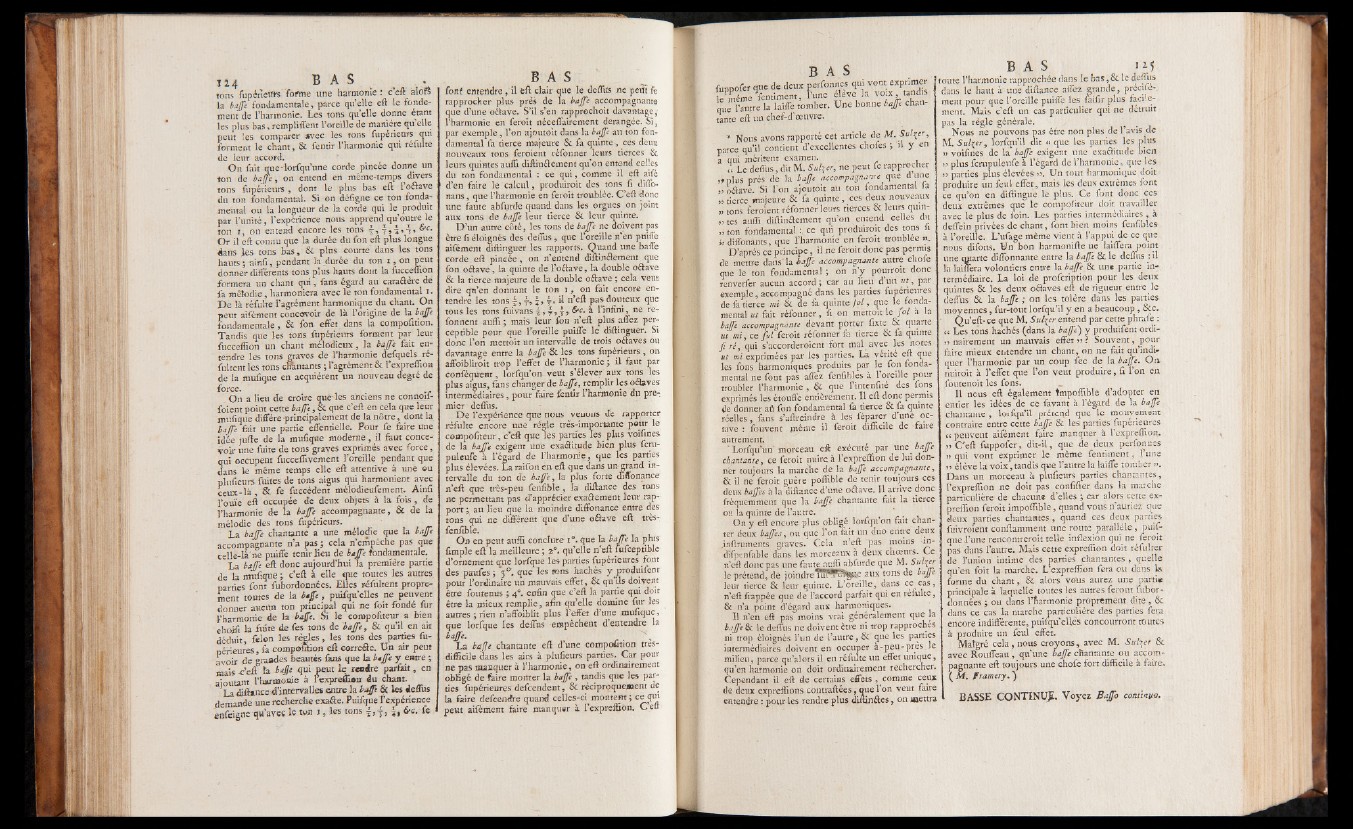
124 B A S
tons fupéneiws forme une harmonie: c’eri àlofs
la baffe fondamentale, parce qu’elle eft le fondement
de l’harmonie. Les tons qu’elle donne étant
les plus bas, rempliffent l’oreille de manière qu elle
peut les comparer avec les tons fupenenrs qui
forment le chant, & fentir l’harmonie qui refulte
de leur accord.
On lait que-loriqu’nne corde pincée donne un
ton de baffe, on entend en même-temps divers
tons ftipérieurs , dont le: plus bas eft Fo&ave
du ton fondamental. Si on déftgne ce ton fondamental
ou la longueur de la corde qui le^ produit
par l’unité, l'expérience nous apprend qu’outre le
ton i , on entend encore les tons fo*
Or il eft connu que la durée du fon eft plus longue
dans Jcs tons bas, & pins courte dans les tons
hauts ; ainfi , pendant la durée du ton i , on peut
donner différents tons plus hauts dont la lucceflion
formera un chant qui, fans egard au caractère de
fa mélodie, harmoniera avec le ton fondamental 1.
I le là réfulte l’agrément harmonique du chant. On
peut aifémènt concevoir de là l’origine de la baffe
fondamentale, & fon effet dans la compofition.
Tandis que les tons ftipérieurs forment par leur
fucceffion un chant mélodieux, la baffe fait en-
tendre les tons graves de l’harmonie defquels re-
fultent les tons crantants ; l’agrément & l’expreflion
de la mufique en acquièrent un nouveau degré de
force.
On a lieu de croire que les anciens ne connoif-
foient point cette baffe, & que c’eft en cela que leur
mufique diffère'principalement de la nôtre, dont la
baffe fait une partie effentielle. Four fe foire une
idée jufte de la mufique moderne, il fout concevoir
une fuite de tons graves exprimés avec force,
qui occupent fucceflivement l'oreille pendant que
dans le même temps elle eft attentive à une ou
plufieurs fuites de tons aigus qui harmonient avec
c e u x - là , & fe fuccèdent mélodieufément. Ainfi
l ’ouïe eft occupée de deux objets à la fo is , de
l ’harmonie de la baffe accompagnante, & de la
mélodie des tons ftipérieurs.
La baffe chantante a une mélodie que la baffe
accompagnante n’a pas ; cela n’empêche pas que
celle-là ne puiffe tenir lieu de baffe fondamentale,
La baffe eft donc aujourd’hui la première partie
de la mufique; c’eft à elle que toutes les autres
parties font fubordonnêes. Elles réfultent proprement
toutes de la baffe, puifqu’elles ne peuvent
donner aucun ton principal qui ne foit fondé fur
l’harmonie de la baffe. Si le compofiteur a bien
ehcâfi la foute de fes tons de baffe, & qu’il en art
déduit, félon les règles , les tons des patries fu-
périeures, fa compoSrion eft correâe. Un air peut
avoir de grandes beautés fous que la baffe y entre ;
mais -c’eft ta bage qui peut le rendre parfoit, en
ajoutant l’harmonie à lexpreflinn du chant.
La d;ft,nce d’intervalles entre la baffe & les deffus
demande une recherche exaâe. Puifque l’expérience
enfeigne qu'avec le ton ï , les tons v * 7 , 41 d’e» fe
B A S
font entendre,'U eft clair que le deffus ne peut fe
rapprocher plus près de la baffe accompagnante
que d’une oélave. S’il s’en rapprochoit davantage ,•
l’harmome en feroït néceffairement dérangée.Si,
par exemple, l’on ajoutôit dans la baffe au ton fondamental
fa tierce majeure & fa quinte , ces deux
nouveaux tons feroient réfonner leurs tierces &
leurs quintes aufli diftrn élément qu’on entend celles
du ton fondamental : ce qui, comme il eft aifé
d’en faire le calcul, produiroit des tons fi diffo-
nans, que l’harmonie en feroit troublée. C ’eft donc
une faute abfurde quand dans les orgues on joint
aux tons de baffe leur tierce & leur quinte.
D ’un autre côté, les tons de baffe ne doivent pas
être fi éloignés des defius, que l’oreille n'en puiffe
aifémènt diftinguer les rapports. Quand une baffe
corde eft pincée, on n’entend diftinélement que
fon oélave, la quinte de l'oéiave, la double oélave
& la tierce majeure de la double oélave ; cela veut
dire qu’en donnant le ton i , on fait encore entendre
les tons h ü n’eft pas douteux que
tous les tons fuivans-f , y , •§-, &c.k l’infini, ne re-
fonnent aufli ; mais leur fon n’eft plus affez perceptible
pour que l’oreille puiffe le diftinguer. Si
donc l’on mettoit un intervalle de trois oélaves ou
davantage entre la baffe & les tons fuperieurs, on
affoibliroit trop l’effet de l’harmonie; i l faut par
conféquent, lorfqu’on veut s’élever aux tons les
plus aigus, fans changer de baffe, remplir les oélaves
intermédiaires, pour faire fentir l’harmonie du premier
defliis. -
De l’expérience que nous venons fie rapporter
réfulte encore une règle très-importante pour le
compofiteur, c’eft que les parties les plus voifines
de la baffe exigent une exaéïitude bien plüs feru-
puleufe à l’égard de l ’harmonie, que les parties
plus élevées. La raifon en eft. que dans un- grand intervalle
du ton de baffe, la plus forte diffonance
n’eft que très-peu fenfible, la diftance des tons
ne permettant pas d’apprécier exaâement leur rapport
Ï au lieu que la moindre diffonance entre des
tons qui ne diffèrent que d’une oélave eft tres-
fenfible.
On en peut aufli conclure ï®. que la baffe la pius
fimple eft la meilleure ; 2i°. qu’elle n’eft îufceptible
d’ornement que lorfque les parties fuperieures font
des paufes ; 50. que les tous hachés y pradiiifont
pour l’ordinaire un mauvais effet, & qu ils doivent
être foutenus ; 40. enfin que c’eft la partie qui doit
être la mieux remplie, afin qu’elle domine fur les
autres ; rien n’affoiblit plus l’effet d’une mufique,
que lorfque les deffus -empêchent d’entendre la
baffe. Ï ||f< A
La baffe chantante eft d’une compofition tres-
difficile dans les airs à plufieurs parties. Car pour
ne pas manquer à l’harmonie, on eft ordinairement
obligé de faire monter la baffe , tandis que les parties
fiipérieures defeendent, & réciproquement de
la foire defeendre quand celles-ci montent; ce cpû
peut aifémènt faire manquer à l’exprefficm. Ceft
B A S
fuppofer que de deux perfonnes qui vont exprimer
le même ftntimeut, l’une eleve la v o ix , tandis
pue lVujre la laiffe tomber. Une bonne baffe chantante
eft un chef-d'oeuvre.
* Nous avons rapporté cet article de M. Suider,
parce qu’il contient d’excellentes chofes ; il y en
a qui méritent examen. , .
I Le deffus, dit M. Suider, ne peut fe rapprocher
,4plus près de la baffe accompagnante que dune
"» oÛÏVe. Si l'on ajoutoit au ton fondamental la
,, tierce majeure & fa quinte, ceS-deux nouveaux
„ tons feroient réfonner leurs tierces & leurs qum-
„ tes aufli diflinfoement qu’on entend celles du
„ ton fondamental ce qui produiroit des tons fi ,
b diffonants, que l’harmonie en feroit troublée ».
D ’après ce principe, il ne feroit donc pas permis
de mettre dans" la baffe accompagnante autre chofe
que le ton fondamental ; on n’y pourrait donc
renverfer aucun accord ; car au lieu d’un ut, par
exemple, accompagné dans les parties fupérieures
de fa tierce mi & de fa quinte Jol, que le fondamental
ut fait réfonner, fi on mettoit le fo l à la
baffe accompagnante devant porter fixte & quarte
ut mi, ce fui feroit réfonner fa tierce & fa quinte
fi ré, qui s'accorderaient fort mal avec les notes
ut mi exprimées par les parties. La vérité eft que
les fons harmoniques produits par le fon fondamental
ne font pas affez fenfibles a 1 oreille pour
troubler l’harmonie , §£ que fintenfité des fons
exprimés les étouffe entièrement. Il eft donc permis
de donner aû fon fondamental fo tierce & fa quinte
réelles, fans s’aftreindre à les feparer d une octave
: fouvent meme il feroit difficile de faire
.autrement
"Lorfqu’un morceau eft exécuté par une baffe
chantantece feroit nuire à l’expreffion de lui donner
toujours la marche de la baffe accompagnante,
& il ne feroit guère poffible de tenir toujours ces
deux baffes à la diftance d’une oélave. 11 arrive donc
fréquemment que la baffe chantante fait la tierce
ou la quinte de l’autre.
On y eft encore plus oblige lorfqu on fait chanter
deux biffes, ou que l’on fait un duo entre deux
„inftruments graves. Cela n’eft pas moins in-
difpenfable dans les morceaux à deux choeurs. Ce
n’eft donc pas une faute aufli abfurde que M. Suider
le prétend, de j oindre aux tons de baffe
leur tierce & leur quinte. L’oreille, dans ce cas,
n’eft frappée que de l’accord parfait qui en refulte , j
& n’a point d’égard aux harmoniques. ;
Il n’en eft pas moins vrai généralement que la
baffe & le demis ne doivent être ni trop rapprochés
ni trop éloignés l’un de l’autre, & que les parties
intermédiaires doivent en occuper à-peu-près_le
milieu, parce qu’alors il en réfulte un effet unique,
qu’en harmonie on doit ordinairement rechercher.
Cependant il eft de certains effets , comme ceux
de deux expreffions contraftées, oue l ’on veut faire
entendre : pour les rendre plus diiunéles, on mettra
B A S iM
'toute l’harmonie rapprochée dans le bas ,& le deffus
dans le haut à-une diftance affez grande, precife-
ment pour que l’oreille puiffe les foifir plus facilement.
Mais c’eft un cas particulier qui ne détruit
pas la règle générale.
Nous ne pouvons pas être non plus de l’avis de
M. Suider, lorfqu’il dit « que les parties les plus
v voifines de la baffe exigent une exaéïitude bien
» plus fcrupuleufe à l’égard de l’harmonie , que les
jj parties plus élevées ». Un tout harmonique doit
produire un foui effet, mais les deux extrêmes font
ce qu’on en diftingue le plus. Ce font donc ces
deux extrêmes que le compofiteur doit travailler
avec le plus de foin. Les parties intermédiaires, à
deffein privées de chant, font bien moins fonfibles
à l’oreille. L ’ufage même vient à l’appui de ce que
nous difons. Un bon harmonifte ne laiffera point
une aparté diffonnante entre la baffe & le deffus : il
la laiffera volontiers entre la baffe & une partie intermédiaire.
La loi de profeription pour les deux
quintes & les deux oélaves eft de rigueur entre le
deffus & la baffe ; on les tolère dans les parties
moyennes, fur-tout lorfqu’il y.en a beaucoup, &c.
• Q u’eft-ce que M. Suider entend par cette phrafe :
cc Les tons hachés (dans la baffe') y prodiiifent ordi-
?» nairement un mauvais effet»? Souvent, pour
faire mieux entendre un chant, on ne fait qu’indiquer
l’harmonie par un coup foc de la baffe. Oit
nuiroit à l’effet que l’on veut produire, fi l’on en
foutenoit les fons.
Il nous eft également tmpofîible d’adopter en
entier les idées de ce favant à l’égard de la baffe
chantante , lorfqu’il prétend que le mouvement
contraire entre cette baffe & les parties'fupérieures
i cc peuvent aifémènt faire manquer à l’expreffion.
» C ’ eft fuppofer, dit-il, que de deux perfonnes
» qui vont exprimer le même fentiment, l’une
» élève la v oix , tandis que l ’autre la laiffe tomber >».
Dans un morceau 4 plufieurs parties chantantes,
l’expreffion ne doit pas confifter dans la marche
particulière de chacune d’elles ; car alors cette ex-
preffion feroit impoffible, quand vous n’auriez que
deux parties chantantes-, quand ces deux parties
fuivroient conftamment une route parallèle , puifque
l ’une rencontrerait telle inflexion qui ne feroit
pas dans l’autre. Mais cette expreflion doit réfulter
de l’union intime des parties chantantes , quelle
qu’en foit la marche. L’expreffion fora pu dans la
forme du chant, & alors vous aurez une partie
principale a laquelle toutes les autres feront fubordonnées
; ou dans l’harmonie proprement dite, &
dans ce cas la marche particulière des parties fera
encore indifférente, puifqu’ellès concourront toutes
à produire un foui effet.
Malgré cela, nous croyons, avec M. Suider &
avec Rouffeau, qu’une baffe chantante ou accompagnante
eft toujours une chofe fort difficile à faire.
( M . framery.')
B A S S E C O N T IN U J L V o y e z Baffb continua.