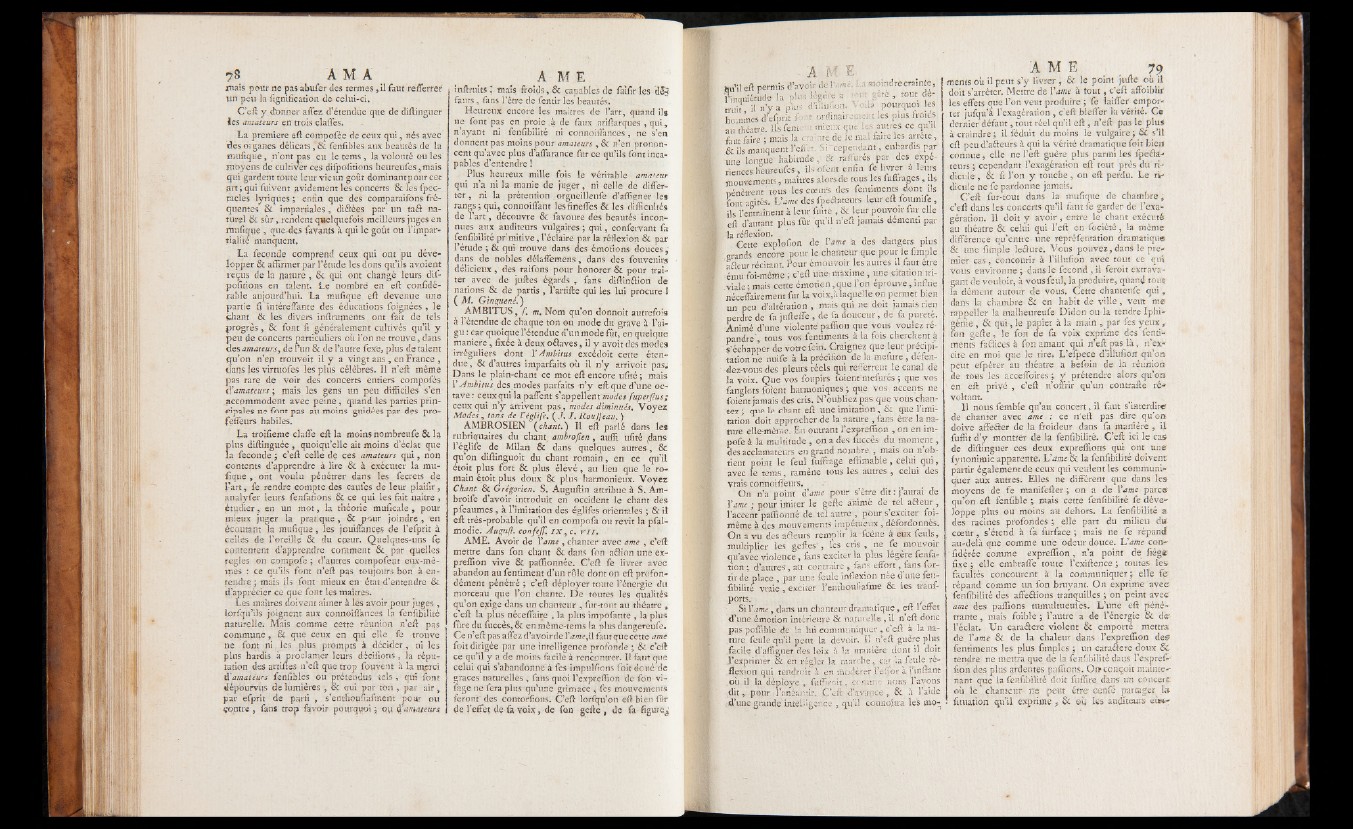
73 A M A
mais pour ne pas abufer des termes, il faut refferref
un peu la lignification de celui-ci.
C ’eft y donner affez d’étendue que de diftinguer
les amateurs en trois çlafTes.
La première eft compofée de ceux qui, nés avec
des organes déliçats ,*& fenfibles aux beautés de la
mufique, n’ont pas eu le te ms, la volonté ou les
moyens de cultiver ces difpolitions heureufes, mais
qui gardent toute leur vie un goût dominant pour ce t
art; qui fuivent avidement lés concerts St les fpec-
taçles lyriques ; enfin que des comparaifons fréquentes
St impartiales, diélées par un ta& naturel
St sûr ».rendent quelquefois meilleurs juges en
mufique » que-des fayants à qui le goût ou l'impartialité
manquent,
La fécondé comprend ceux qui ont pu développer
& affirmer par l’étude les dons qu’ils avoient
reçus de la nature, & qui ont changé leurs dif-
pofitions en talent. Le nombre en eft çonfidé-
rable aujourd’hui. La mufique eft devenue une
partie fi intéreffantç des éducations foignées , le
çhant & les divers inftrumerits ont fait de tels
progrès, & font fi généralement cultivés qu’il y
peu de concerts particuliers où l’on ne trouve , dans
des amateurs, de l’un & de l’autre fexe, plus de talent
qu’on n’en trouveit il y a vingt ans, en France ,
dans les virtuofes les plus célèbres. Il n’eft même
pas rare de voir des concerts entiers compofés
d’amateurs ; mais les gens un peu difficiles s’én
^accommodent avec peine, quand les parties principales
ne font pas au moins guidées par des pro-
feffeurs habiles.
La troifieme claffe eft la moins nombreufe & la
plus diftinguée , quoiqu’elle ait moins d’éclat que
la fécondé ; c’eft celle de ces amateurs q u i, non
contents d’apprendre à lire & à exécuter la mufique
, ont voulu pénétrer dans les fecrets de
l ’art, fe rendre compte des caillés de leur plaifir,
analyfer leurs fenfations ce qui les fait naître >
ètydier, en un mot, la théorie muficale, pour
mieux juger la pratique, & pour joindre , en
écoutant la mufique, les jouiffançes de l’efprit à
celles. de l ’oreille & du cpeur. Quelques-uns fe
contentent d’apprendre comment St par quelles
réglés on compofe ; d’autres compofent eux-mêmes
: ce qu’ils font n’eft pas toujours bon à entendre;
mais ils font mieux en état d’entendre &
d’apprécier ce que font les maîtres.
Les maîtres doivent aimer à les avoir pour juges ,
lorfqu’ils joignent aux connoiffances la fenfibilité
naturelle. Mais comme cette réunion n’eft pas
commune, St que ceux en qui elle fe trouve
ne font ni, les plus prompts à décider, ni les
plus hardis à proclamer leurs décifions, la réputation
des artiftes n’eft que trop fouvent à la merci
d’amateurs fenfibles ou prétendus te ls , qui font
dépourvus de lumières , & qui par ton , par air,
par efprit de parti , s’enthoufiafment pour ou
çoptre, fans trop favoir pourquoi ; ou $ amateurs
A M E
inftruits J mais froids, & capables de faifir les d§4
fauts, fans l’être de fentir les beautés.
Heureux encore le s maîtres de l’art, quand ils
ne font pas en proie _à de faux ariftarques , qui,
n’ayant ni fenfibilité ni connoiffances, ne s’en
donnent pas moins pour amateurs , & n’en prononcent
qu’avec plus d’aflùrance fur ce qu’ils font incapables
d’entendre !
Plus heureux mille fois le véritable amateur
qui n’a ni la manie de juger, ni celle de differ-
te r , ni la prétention orgueillenfe d’affigner les
rangs; qui, connoiffant lesfineftés & les difficultés
de l’a r t, découvre & favoure des beautés inconnues
aux auditeurs vulgaires ; q u i, confervant fa
fenfibilité primitive, l’éclâire par la réflexion & par
l’étude ; & qui trouve dans dès émotions douces ;
dans de nobles délaffemens, dans des fouvenirs
délicieux, des raifons pour honorer & pour traite
r avec de juftes égards, fans diftin&ion de
nations & de partis , l’artifte qui les lui procure I
( M. Ginguené.)
AMB1T U S , Ç. m. Nom qu’on donnoit autrefois
à l’étendue de chaque ton ou mode du grave à l’aigu
: car quoique l’étendue d’un mode fût, en quelque
maniéré, fixée à deux oéfaves, il y avoit des modes
irréguliers dont 1 ’ Ambitus excédoit cette étendue,
& d’autres imparfaits où il n’v arrivoit pas;
Dans le plain-chant ce mot eft encore nfité ; mais
Y Ambitus des modes parfaits -n’y efl que d’une octave
: ceux qui la paffent s’appellent modes fuperflus;
ceux qui n’y arrivent pas, modes diminués. Vo y e z
Modes, tons de Vèglife. ( j . J. Rouffeau.')
AMBROSIEN ( chant.) Il eft parlé dans les
rubri quaires du chant, ambrojîen, auffi ufité dans
l’églife de Milan & dans quelques autres, &
qu’on diftinguoit du chant romain, en ce qu’il
étoit plus fort & plus é le vé , au lieu que le romain
étoit plus doux & plus harmonieux. Voyez
Chant & Grégorien. S. Auguftin attribue à S. Àm-
broife d’avoir introduit en occident le chant des
pfeaumes, à l’imitation des églifes orientales ; & il
eft très-probable qu’il en compofa ou revit la pfal-
modie. Augufl. confeff. i x , c. v u .
AME. Avoir de Yame , chanter avec ame , c’eft
mettre dans fon chant St dans fon aâion une ex-
preffion vive & paffionnée. C ’eft fe livrer avec
abandon au fentiment d’un rôle dont on eft profondément
pénétré ; c’eft déployer toute l’énergie du
morceau que l’on chante. De toutes les qualités
qu’on exige dans un chanteur , fur-tout au théâtre ,
c’eft la plus néceffaire , la plus impofante , la plus
fure du fuccès, & en même-tems la plus dangereufe.
Ce n’eft pas affez d’avoir de YamcJX faut que cette ame
foit dirigée par une intelligence profonde ; & c’eft
ce qu’il y a de moins facile à rencontrer. Il faut que
celui qui s’abandonne à fes impulfions foit doué de
grâces naturelles , fans quoi l’expreflion de fon vi-
fage ne fera plus qu’une grimace , fes mouvements
feront des contorfions. C ’eft lorftju’on eft bien fur
de l’effet de & v o ix , de fon gefte , de fa figurai
moindre crainte,
gâté tout dé-
ià pourquoi les
u les plus, froids
:s autres ce qu’il
1 faire les arrête,
ant, enhardis par
jhu il eft permis d’avoir de Yame. L
linquiêtude la pins legeie a toi
irait, il n’y a piiw dUUnton. V t
hommes d’efprit font ordinairen*
au théâtre. Ils fentei >t mieux que
faut faire ; mais la crainte de le m
& ils manquent l'effet. Si cepend ...
une longue habitude , & raffures par des expériences
heureufes, ilsofent enfin fe livrer à leurs
mouvements., maîtres alors de tous les fuftrages, ils
pénètrent -tous les coeurs des fentiments dont ils
font agités. L'ame des fpeaateurs leur eft foumife ,
ils l’entraînent à leur fuite , & leur pouvoir fur elle
eft d’autant plus fur qu’il n’eft jamais démenti par
la réflexion. . '
Gette explofion de 1 ame a des dangers plus
grands encore pour le chanteur que pour le (impie
aéteur récitant. Pour émouvoir les autres il faut être
ému foi-même ; c’eft une' maxime, une citation tri- •
viale ; mais cette émotion, que l’on éprouve, influe,
néceftairement fut la voix,a!aqueUe on permet bien
un peu d’altération , mais qui ne doit jamais rien
perdre de fa jufteffe , de fa douceur, de fa pureté.
Animé d’une violenté paillon que vous voulez répandre",
tous vos. fentiments. à la fois cherchent à
s’échapper de votre fein. Craignez que leur précipitation
ne nuife à la précifion de la mefure , défendez
vous des pleurs reels qui refferrent le canal de
la voix. Que vos foupirs loienfmefurés ; que vos
fanglots foîént harmoniques ; que vos accents ne
foient jamais des cris. N’oubliez pas que vous chantez
; que lé chant eft une imitation, & que l’imitation
doit approcher de la nature , fans être la nature
elle-même. En outrant l’expreflion , on en im-
pofe à la multitude , on a des fiiccès du moment,
des acclamateurs en grand nombre., mais on n obtient
point le feul Suffrage eftimable , celui qui,
avec le tems,. ramène tous les autres , celui des
vrais connoiffeurs. - .
On n’a point S ame pour s’être dit : j’aurai de
l’ame ; pour imiter le gefte anime de tel aéteîir,
l’accent paflionné de tel autre , pour s exciter foi-
même à des mouvements impétueux, défordonnes.
On a vu des aélenrs remplit la fcène à eux feuls,
multiplier les geftes’ , les cris , ne fe .mouvoir
qu’avec violence, fans exciter la plus légère fenfa-
tion; d’autres, au contraire , fans effort, fans for-
tir de place , par une feule inflexion nee d une len-
fibilitè vraie, exciter l’entlioufiafme &. les tranfports.'
.
Si Vame, dans un chanteur dramatique, eft l’effet
d’une émotion intérieure & naturelle, il n’eft donc
pas pofîible de Sa lui communiquer , c’eft à la nature
feule qu’il pent la devoir, il n’eft guère plus
.facile d’affigner des loix à la manière dont il doit
.l’exprimer oc en régler la marche, car ta feule reflexion
qui tendreit à en modérer l’effor à i’inftant
.où il la déployé, fulîtrolt, corn inc nous l’avons
d it, pour l'anéantir. C ’eft d’avance, & à l’aide
d’une grande intelligence , qu’il connoitra les nto-
A M E 7 ?
rtients où il peut s’y livrer , St le point jnfte où il
doit s’arrêter. Mettre de Yame à tou t, c’eft affoibfir
les effets que l’on veut produire ; fe laifler emporter
jufqu’à l’exagération , c’eft blefler la vérité. Ce
dernier défaut, tout réel qu’il e ft, n’eft pas le plus
à craindre ; il féduit du moins le vulgaire ; & s’il
eft peu d’a&eurs à qui la vérité dramatique foit bien
connue, elle ne l’eft guère plus parmi les fpeéîa-
teurs ; cependant l’exagération eft tout près du ridicule
, & fi l’on y touche, on eft perdu. Le ridicule
ne fe pardonne jamais,
C ’eft fur-tout dans la mufique de chambre,
c’eft dans les concerts qu’il faut fe garder de l’exagération.
11 doit y avoir, entre le chant exécuté
au théâtre & celui qui l’eft, en fociété, la même
différence qu’entre une repréfentation dramatique
& une fimple leâure. Vous pouvez, dans le premier
cas, concourir à l’illufion avec tout ce qui
vous environne ; clans le fécond , il feroit extravagant
de vouloir, à vous feul, la produire, quand tous
la dément autour de vous. Cette chanteufe q ui,
dans la chambre & en habit de v ille , veut me
rappeller la malheureufe Didon ou la tendre Iphigénie
, St qui-, le papier à la main , par fes y e u x ,
ion gefte, le fon de fa voix exprime des fentiments
faéfices à fon amant qui n’eft pas là t n’èx-
cite en moi que le rire. L ’efpece d’iîlufioiî qu’on
peut efpérer au théâtre a befoin de la réunion
de tous les acceftbires ; ÿ prétendre alors qu’on
en eft privé , c’eft n offrir qu’un contrafte révoltant.
11 nous fembîe qu’au concert, il faut s’interdire
; de chanter avec ame : ce n’eft pas dire qu’oit
doive affe&er de la froideur dans fa manière , il
fuffit d’y montrer de la fenfibilité. C ’eft ici le cas
de diftinguer ces deux expreffions qui ont une
fynonimie apparente. L'ame St la fenfibilité doivent
partir également de ceux qui veulent les commune
quer aux autres. Elles ne différent que dans les
moyens de fe manifefter ; on a de Yame parc®
qu’on eft fenfible ; mais cette fenfibilité fe déve*-
Joppe plus ou moins au dehors. La fenfibilité a
des racines profondes ; elle part du milieu dtf
coeur, s’étend à fa furface ; mais ne fe répand
au-delà que comme une odeur douce. Uame con-
fidérée comme expreffion, n’a point de liège
fixe ; elle emhraffe toute l’exiftence ; toutes les
facultés concourent à la communiquer ; elle fe
répand comme un fon bruyant. On. exprime avec
fenfibilité des affe&ions tranquilles ; on peint avec
ame des pallions tumultueufes. L ’une eft pénétrante
, mais foible ; l’autre a de l’énergie & de
l’éclat. Un cara&ere violent St emporté mettra
de Yame St de la chaleur dans l’expreffion des
fentiments les plus fimples ; un caractère doux 8t
tendre ne mettra que de la fenfibilité dans l’expreff-
fion des plus ardentes paftions. O it conçoit mainte--
nant que" la fenfibilité doit fùffire dans un concert:
où le chanteur ne peut être- cenfé partager îai
firuation qu’il exprime 9 St ou les auditeurs- ei**-