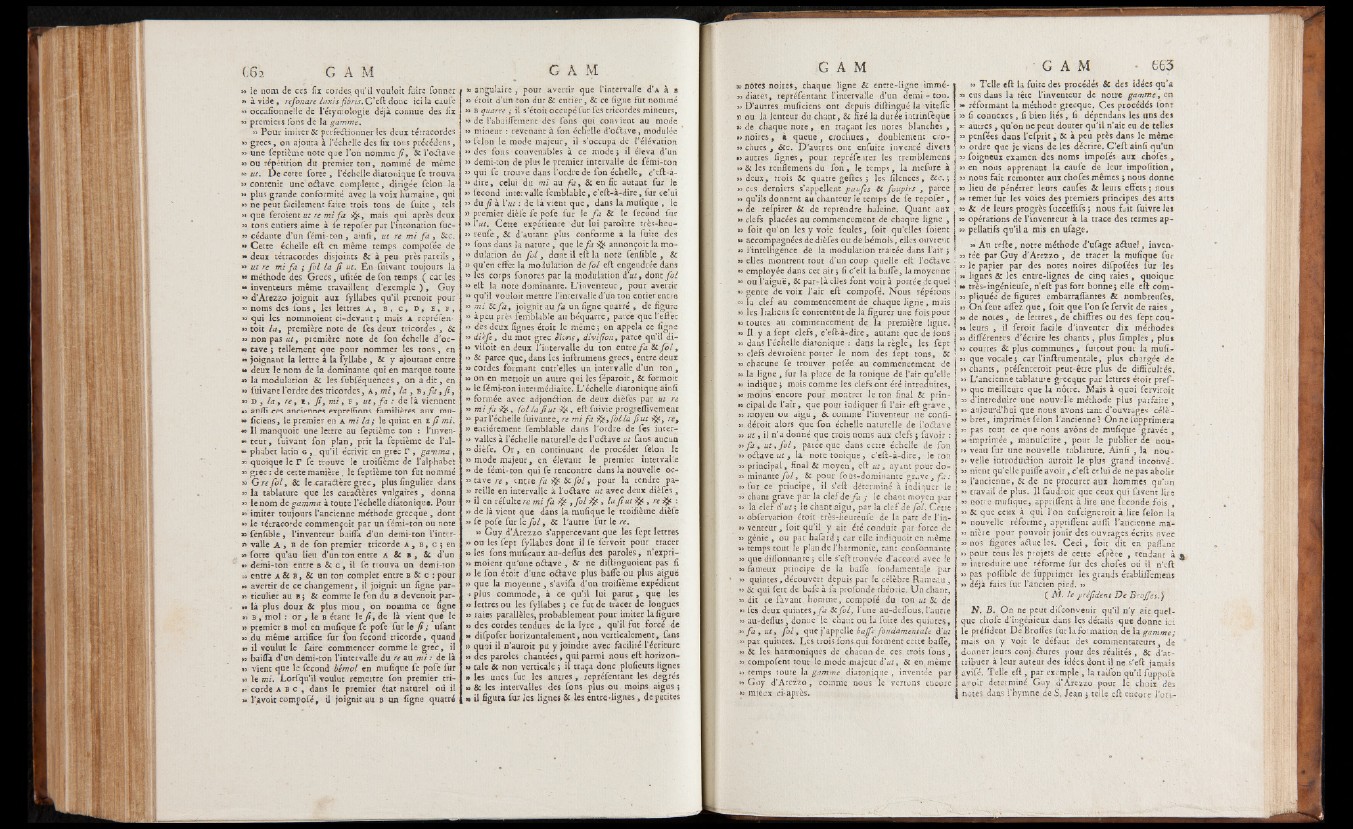
» le nom de ces fix cordes, qu’il vouloit faire fonner
» a v id e , refondre Iaxis fibris. C ’eft donc icilacaufc
» occafîonnelle de l’étymologie déjà connue des lix
m premiers fons de la gamme.
»» Pour imiter & perfectionner les deux tétracordes
» grecs, on ajouta à l’échelle des lix tons précédens,
>3 une feptième note que l’on nomme f iy & l’oétave
»3 ou répétition du premier ton, nommé de même
» ut. De cette forte , l’échelle diatonique fe trouva
»contenir une'oétave complette, dirigée félon la
» plus grande conformité avec la voix humaine, qui
» ne peut facilement faire trois tons de fuite , tels
>• que feraient ut re mi fa î$c, mais qui après deux
33 tons entiers aime à fe repofer par l’intonation fuc-
» cédante d’un fémi-ton, ainfi, ut re mi fa , &c.
*» Cette échelle eft en même temps compoféc de
» deux tétracordes disjoints & à peu près pareils ,
» ut re mi fa ; fo l la f i ut. En fuivant toujours la
»* méthode des Grecs , ufitéc de fon temps ( car les
•• inventeurs même travaillent d’exemple ) , Guy
*» d’Arezzo joignit aux fyllabes qu’il prenoit pour’
» noms des fons, les lettres a , b , c , d , e , f ,
33 qui les nommoienc ci-devant ; mais A.rcpréfen-
»> toit la 9 première note de fes deux tricordes , &
» non pas uty première note de fon échelle d’oc-
•» tave 5 tellement <jue pour nommer les tons, en
*• joignant la lettre a la fyllabe, & y ajoutant entre
•• deux le nom de la dominante qui en marque toute
» la modulation & les fubféquences , on a dit, en
»» fuivant l’ordre des tricordes, a , mi, la , b > fo » fiy
»3 d , la 9 re9 i-, f i »m i, F , u t , fa : de là viennent
•3 aulli ces anciennes exprelfions familières aux mu-
»• ficiens, le premier en a mi la ; le quint en e f i mi.
•» Il manquoit une lettre au feptième ton : l’inven-
•» teur, luivant fon plan, prit la feptième de l’al-
*> phabet latin g , qu’il écrivit en grec r , gamma ,
» quoique le r fe trouve le troifième de l’alphabet
» grec : de cette manière , le feptième ton fut nommé
» G re f o l , 8c le caradère grec , plus fingulier dans
33 la tablature que les caractères vulgaires, donna
>» le nom de gamma à toute l’échelle diatonique. Pour
» imiter toujours l’ancienne méthode grecque, dont
»3 le récracorde commençoit par un fémi-ton ou note
» fenfible, l’inventeur baiffa d’un demi-ton l’inttr-
r> valle A » b de fon premier tricorde a , b , ç j en
» forte qu’au lieu d’un ton entre a & b , & d’un
»» demi-ton entre b & c , il fe trouva un demi-ton
33 entre a & 8, & un ton complet entre b & c ; pour
*» avertir de ce changement, il joignit un ligne par-
» ticulier au b ; & comme le fon du b devenoit par-
•• là plus doux & plus mou, on nomma ce ligne
»3 b , mol : or , le b étant le f i , de là vient que le
» premier b mol en mulîque fe pofe fur le f i ; ufant
*3 du même artifice fur fon fécond tricorde, quand
il voulut le faire commencer comme le grec, il
*3 bailla d’un demi-ton l’intervalle du re au mi : de là
»3 vient que le fécond bémol en mulîque fe pofe fur
» le mi. Lorfqu’il voulut remettre Ton premier tri-
corde a b c , dans le premier état naturel ou il
m l’a voit compofé, il joignit au b un ligne quarré
»angulaire, pour avertir que l’intervalle d‘a à b
»3 étoit d’un ton dur & entier, & ce ligne fut nommé
33 b quarre ; il s’étoit occupé fur fes tricordes mineurs,
»3 de l’cibaiffement des fons qui convient au mode
»3 mineur : revenant à fon échelle d’octave, modulée
33 leion le mode majeur, il s’occupa de l’ élévation
»» des fons convenables à ce mode> il éleva d’un
>» demi-ton de plus le premier intervalle de fémi-ton
»3 qui fe trouve dans l’ordre de fon échelle, c’eft-à-
33 dire, celui du mi au / à , & eti fit autant fur le
» fécond intervalle femblable, c’eft-à-dire, fur celui
33 du f i à fit* : de là vient que, dans la mulîque , le
» premier dièfe fe pofe fur le fa & le lecond far
» Y ut. Cette expérience dut lui paraître très-heu-
33 reufe, & d’autant plus conforme à la fuite, des
»3 fons dans la nature, que le fa annonçoit la mo-
>» dulation du f o l , dont il cft la note fenfible , &
» qu’en effet la modulation de fol eft engendrée dans
33 les corps fonores par la modulation d’a r, dont fo l
»> elt la note dominante. L’inventeur, pour avertir
» qu’il vouloit mettre l'intervalle d’un ton entier entre
33 mi 8c fa , joignit au fa un ligne quarré , de figure
>3 à peu près femblable au béquarre, parce que l’effet
>3 des deux lignes étoit le mêmej on appela ce ligne
»3 dièfe, du mot grec <h’e«r, divifion, parce qu’il di-
» viloit en deux l’intervalle du ton entre fa 8c f o l ,
>3 & parce que,dans les inftrumens grecs, entre deux
» cordes formant entr elles un intervalle d’un ton ,
» on en mettoit un autre qui les féparoit, & formoit
» le fémi-ton intermédiaire. L ’échelle diatonique âinfi
»s formée avec adjonétion de deux dièfes par ut re
»» mi fa f y , fo lia f i ut 9^-, eftfuivie progrelfivement
» par l’échelle fui vante, re mi fa fy, fol la f i ut re>
» entièrement femblable dans l’ordre de fes inter-
» valles à l’échelle naturelle de l’oétave ut fans aucun
>» dièfe. O r , en continuant de procéder félon le
?> mode majeur, en élevant le premier intervalle
» de fémi-ton qui fe rencontre dans la nouvelle oc-
»3 tave re, entre fa 8c fo l y pour la rendre pa-
» reille en intervalle à l'o&ave ut avec deux dièfes ,
»* il en rélulte re mi fa , fo l y la f i u t , re >$< :
33 de là vient que dans la mufique le troifième dièfe
33 fe pofe fur le f o l , & l’autre fur le re.
33 Guy d’Arezzo s’appercevant que les fept lettres
»3 ou les fept lyllgbes dont il fe fervoit pour tracer
»3 les fons muficaux au-deffus des paroles, n’expri-
33 moient qu’une oétave , 8t ne diftinguoient pas fi
>3 le fon étoit d’une oétave plus baffe ou plus aiguë
» que la moyenne , s’avifa d’un troifième expédient
-> plus commode, à ce qu’il lui parut, quç les
>3 lettres ou les fyllabes ; ce fut de tracer de longues
33 raies parallèles, probablement pour imiter la figure
sa des cordes tendues de la lyre , qu’il fut force de
>• difpofcr horizontalement, non verticalement, fans
» quoi il n’auroit pu y joindre avec facilité l’écriture
» des paroles chantées, qui parmi nous eft horizon-
» talc 8c non verticale > il traça donc plufieuts lignes
» les unes fur les autres, repréfentant les degrés
» 8c les intervalles des fons plus ou moins aigus ;
i« U figura fur les lignes & les entre-ligues, de petites
3> Telle eft la fuite des procédés 8c des idées qu’a
3» eus dans la tête l’inventeur de notre gamme, en
3# réformant la méthode grecque. Ces procédés font
3> fi connexes , fi bien liés, fi dépendans les uns des
» autres , qu’on ne peut douter qu’ il n’ait eu de telles
99 penfées dans l’efprit, & à peu près dans le même
»» ordre que je viens de les décrire. C ’eft ainfi qu’un
9? foigneux examen des noms impofés aux chofes ,
99 en nous apprenant la caufe de leur impofition,
99 nous fait remonter aux chofes mêmes ; nous donne
»» lieu de pénétrer leurs caufes 8c leurs effets ; nous
3» remet fur les voies des premiers principes des arts
93 & de leurs progrès fuccefiifs > nous fait fuivre les
>3 opérations de l’inventeur à la trace des termes ap-
93 pellatifs qu’il a mis en ufage.
3» Au refte, notre méthode d’ufage a&uel, inven-
99 tée par Guy d’Arezzo , de tracer la mulîque fur
1 93 le papier par des notes noires difpofécs lur les
»• lignes & les entre-lignes de cinq raies , quoique
•• très-ingénieufe, n’eft pas fort bonnes elle cft com-
33 pliquée de figures embarraffantes êc nombreufes.
33 On fent affez que, foit que l’on fe fervît de raies ,
» de notes , de lettres, de chiffres ou des fept cou-
»1 leurs , il ferait facile d’inventer dix méthodes
33 différentes d’écrire les chants , plus fimples , plus
33 courtes 8c plus communes, fui tour pour la mufi*
33 que vocale5 car l’inftrumentâle, plus chargée de
sscnants, préfenreroit peut-être plus de difficultés.
33 L’ancienne tablature grecque par lettres étoit pref-
33 que meilleure que la nôtre. Mais à quoi ferviroit
33 d’introduire une nouvelle méthode plus parfaite ,
»3 aujourd’hui que nous avons tant d’ouvrages célè-
.» bres, imprimés félon l ’ancienne? On ne fupprimera
sa pas tout ce que nous avons de mufique gravée ,
30 imprimée, manuferite , pour le publier de nou-
?3 veau fur une nouvelle tablature. Ainfi , la nou-
ï» velle introdu&ion aurait le plus grand inconvé-
33 nient qu’elle puiffe avoir, c’eft celui de ne pas abolir
»a l’ancienne, & de ne procurer aux hommes qu’un
33 travail de plus. Il faudrait que ceux qui fa vent lire
33 notre mufique, appriffent à lire une lcconde fois ,
33 & que ceux à qui l’on enfeigneroit à lire félon la
3* nouvelle réforme, appriffent aulfi l’ancienne ma-
>3 nière pour pouvoir jouir des ouvrages écrits avec
» nos figures a&ue’les. C e c i, foit dit en paffant
33 pour tous les projets de cette efpèce , tendant à $
3> introduire une réforme fur des chofes où il n’eft
» pas poffible de fupptimer les grands écabliffemens
33 déjà faits fur l’ancien pied. >3
» notes noires, chaque ligne & entre-ligne immé-1
« diates, repréfentant l’intervalle d’un aemi - ton.
» D’autres muficiens ont depuis diftingué IaNviteffe
» ou la lenteur du chapt, 8c fixé la duree iotrinfèque
» de chaque note, en traçant les notes blanches ,
»3 noires , à queue , crochues , doublement cro-
3» chucs , &c. D ’autres ont enfuite inventé divers
» autres lignes, pour repréfe iter les rremblemcns
3» & les renflemens du fon, le temps, la mefure à
»3 deux, trois 8c quatre geftes ÿ les filcnces, 8cc. j
>3 ccs derniers s’appellent paufes 8c foupirs , parce
>3 qu’ils donnent au chanteur Je temps de fe repofer,
•3 de refpircr & de reprendre haleine. Quant aux
» clefs placées au commencement de chaque ligne ,
33 foit qu’on les y voie feules, foit qu’elles foient
33 accompagnées de dièfes ou de bémols, elles ouvrent
>3 l’intelligence de la modulation traitée dans l ’air ;
33 elles montrent tout d’un coup quelle eft l’oétave
33 employée dans cet air ; lî c’elt la baffe, la moyenne
» ou l ’aiguë, & par-là elles font voir à portéejiequel
»3 genre de voix l’air eft compofé. Nous répétons
03 la clef au commencement de chaque ligne, mais
33 les Italiens fe contentent de la figurer une fois pour
33 toutes au commencement de la première ligne.
3» 11 y a fept clefs, c’eft-à-dire, autant que de Ions
33 dans l’échelle diatonique : dans la règle, les fept
sa clefs devraient porter le nom des lept tons, &
33 chacune fe trouver pofée au commencement de
»3 la ligne, fur la place de la tonique de l’air qu’elle
33 indique 5 mais comme les clefs ont été introduites,
» moins encore pouf montrer le ton final & prin-
3* cipal de l’a ir, que pour indiquer fi l’air eft grave ,
»3 moyen ou aigu, 8c comme l’inventeur ne confi-
33 déroit alors que fon échelle naturelle de i’oétave
33 ut, il n’a donné que trois noms aux clefs j favoir :
33 fa y ut, fo l y parce que dans cette échelle de fon
33 oétave ut , la note tonique, c’eft-à-dire, le ton
33 principal, final 8c moyen, eft ut, ayant pour do-
33 minante fo l y 8c pour foüs-dominancegrave , fa :
33 fur ce principe, il s’eft déterminé à indiquer le
33 chant grave par la clef de fa j le chant moyen par
33 la clef à'ut 1 le chant aigu, par la clef de fol. Cette
33 obfervation étoit très-heureufe de la part de l’in-
»3 venteur, foit qu’il y ait été conduit par-force de
33 génie , ou par hafard j car elle indiquoit en même
33 temps tout le plan de l’harmonie, tant çonfonnante
» que difl'oniiante j elle s’ëft trouvée d’accord avec le
33 fameux principe de la baffe fondamentale par
33 quintes,découvert depuis par le célèbre Rameau,
33 & qui fert de bafe à fa profonde théorie. Un chant,
» dit ce {avant homme, compofé du ton ut & de
»3 fes deux quintes, fa 8c fol, l'une au-deflous, l’autre
33 au-deflus, donne le chant ou la fuite des quintes,
>■> fa y uty fo l y que j’appelle bajfe fondamentale d'ut
33 par quintes. Les trois.fons.qui forment cette baflè,
» & les harmoniques de chacun de ces trois fons,
33 compofent tout le mode majeur d’ut, & en même
33 temps toute la gamme diatonique , inventée par
3» Guy d’Arezzo, comme nous le verrons encore
»3 mieux ci-après.
( M. le préfident De Brojfes.)
N . B. On ne peut difeonvenir qu’il n’y ait quelque
chofe d’ingénieux dans les détails que donne ici
le préfident De Broffes fur la formation de la gamme ;
mais on y voit le défaut des commentateurs, de 9
donner leurs conj. dures pour des réalités , & d’attribuer
à leur auteur des idées dont il ne s’eft jamais
avifé. Telle eft , par exemple , la raifon qu’tl fuppofe
avoir déterminé Guy d’Arezzo pour le choix des
notes dans i’hymne de S. Jean j telle eft encore l’o ii