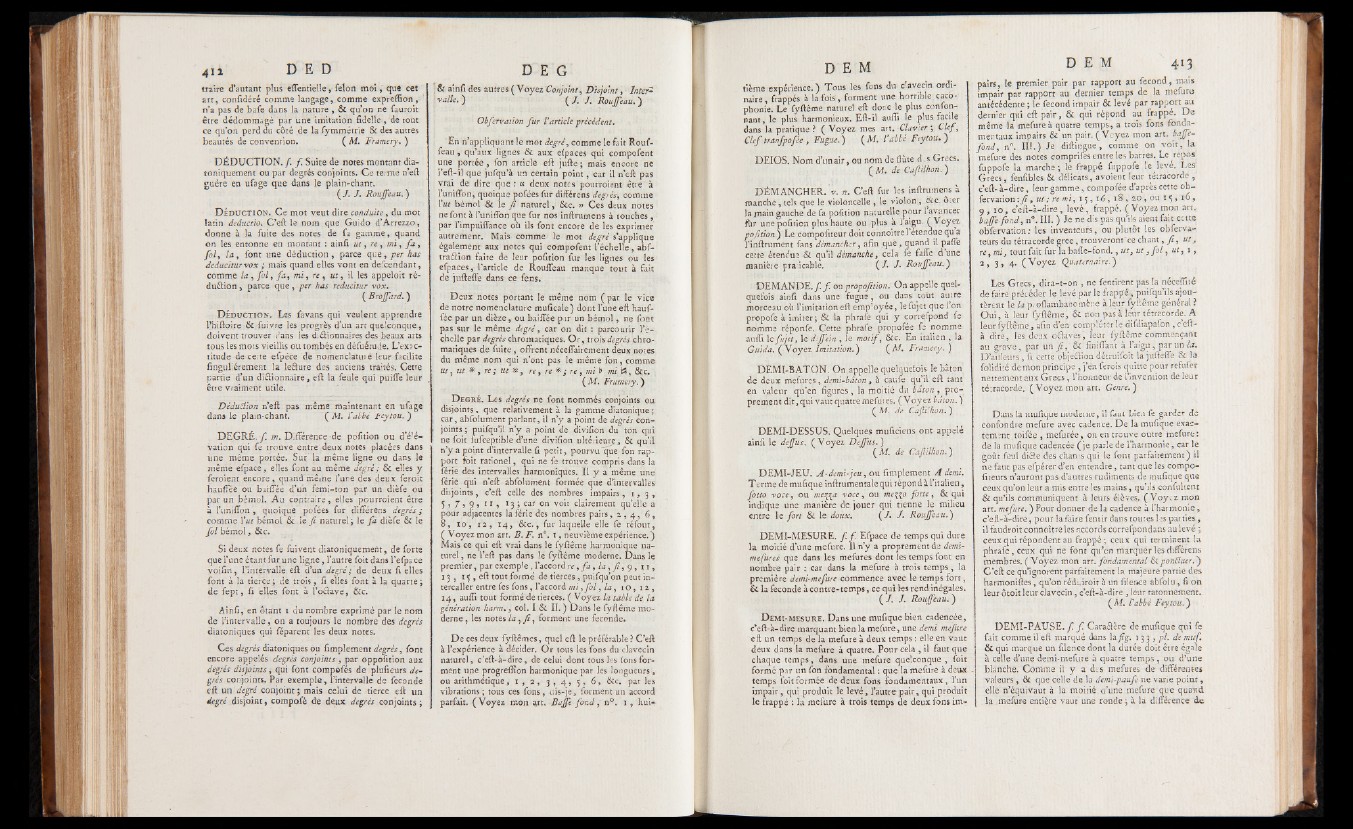
traire d’autant plus effentielle, félon moi , que cet
art, confidéré comme langage,_ comme expreffion,-'
n’a pas de bafe dans la nature , & qu’on ne fauroit
être dédommagé par une imitation fidelle, de tout
ce qu’on perd au côté de la fymmétrie & des autres
beautés de convention. ( M. Framery, )
DÉDUCTION, f . f . Suite de notes montant diatoniquement
ou par degrés conjoints. Ce terme n’eft
guère en ufage que dans le plain-chant.
( / . J. Roujfeau. )
D éduction. Ce mot veut dire conduits, du mot
latin déduction C ’eft le nom que Guido d’Arrezzo,
donne à la fuite des notes de fa gamme, quand
on les entonne en montant : ainfi ut, re, mi, f a ,
fo l 9 la y font une déduction, parce que, per has
deduciturvox ; mais quand elles vont en descendant,
comme la , fo l, fa , mi, re , u t, il les appeloit réduction
, parce que, per has reducitur vox.
( Broffard. )
D éduction. Les favans qui veulent apprendre
l’hiftoire &.fuivre les progrès d’un art quelconque,
doivent trouver dans les d:6tionnaires des beaux arts
tous les mois vieillis ou tombés en défuérude. L’exactitude
de certe efpèce de nomenclatuié leur facilite
finguliérement la leéture des anciens traités. Cette
partie d’un di&ionnaire , eft la feule qui puiffe leur
être vraiment utile.
Déduction n’eft pas même maintenant en ufage
dans le plain-chant. ( M. l'abbé Feytou.)
DEGRÉ, f tn. Différence de pofition ou d’é!é-
vation qui fe trouve entre deux notes placées dans
ûne même portée. Sur la même ligne ou dans le
même efpace, elles font au même degré ; & elles y
feraient encore, quand même l’ure des deux feroit
hauffée ou baiffée d’un femi-ton par un dièfe où
par un bémol. Au contraire, elles pourroient être
à l’uniffon , quoique pofées fur différens degrés ;
comme Y ut bémol & le j i naturel; le fà dièfe & le
fol bémol, &c.
Si deux notes fe fuivent diatoniquement, de forte
que l’une étant fur une ligne, l’autre foit dans l’efpace
voifin, l’interyalle eft d’un degré; de deux fi elles
font à la tierce ; de trois, fi elles font à la quarte ;
de fept, fi elles font à l’oâ av e, &c.
Ainfi, en ôtant 1 du nombre exprimé par le nom
de l’intervalle, on a toujours le nombre des degrés
diatoniques qui féparent les deux notes.
Ces degrés diatoniques ou fimplement degrés, font
encore appelés degrés conjoints , par oppofition aux
degrés disjoints, qui font compofés de plufieurs degrés
conjoints. Par exemple, l’intervalle de fécondé
eft un degré conjoint; mais celui de tierce eft un
degré disjoint, compofé de deux degrés conjoints ;
& ainfi des autres (Voyez Conjoint, Disjoint, Inter-
!valle.) ( J. J. Roujfeau. )
Obfervation fur Varticle précèdent.
En n’appliquant le mot degré, comme le fait Rouf-
feau, qu’aux lignes & aux efpaces qui compofent
une portée, fon article eft jufte ; mais encore ne
î’eft-il que jufqu’à un certain point, car il n’eft pas
vrai de dire q u e :« deux notes pourroient être à
l’uniffon, quoique pofées fur différens degrés, comme
l'ut bémol & le f i naturel, &c. » Ces deux notes
ne font à l’uniffon que fur nos inftrumens à touches ,
par l’impuiffance ou ils font encore de les exprimer
autrement. Mais comme le mot degré s’applique
également aux notes qui compofent l’échelle, abf-
traélion faite de leur pofition fur les lignes ou les
efpaces,- l’article de Rouffeau manque tout à fait
de jufteffe dans ce fens.
Deux notes portant le même nom ( par le vice
de notre nomenclature muficale) dont l’une eft hauffée
par un dièze, ou baiffée p:ir un bémol, ne font
pas sur le même degré, car on dit : parcourir l’échelle
par degrés chromatiques. O r , trois degrés chromatiques
de fuite, offrent néceffairement deux notes
du même nom qui n’ont pas le même fon, comme
[ ut > ut * 9 re ; ut * , re, re « 6 re, mi t> mi &c.
(Af. Frumery.)
D egré. Les degrés ne font nommés conjoints ou
disjoints, que relativement à la gamme diatonique ;
, car, abfolument parlant, il n’y a point de degrés conjoints
; puifqu’il n’y a point de divifion du ton qui
ne foit fufceptible d’une divifion ultérieure , & qu’il
n’y a point d’intervalle fi petit, pourvu que fon rapport
foit rationel, qui ne fe trouve compris dans la
férié des intervalles harmoniques. Il y a même une
férié qui n’eft abfolument formée que d’intervalles
disjoints, c’eft celle des nombres impairs , 1 , 3 ,
5 , 7 , 9 , 1 1 , 13 ; car on voit clairement qu’elie a
pour adjacentes la férié des nombres pairs, 2 , 4 , 6 ,
8 , io ‘, 12 , 1 4 , & c . , fur laquelle elle fe réfout,
( Voyez mon art. B. F. n°. 1 , neuvième expérience. )
Mais ce qui eft vrai dans le fyftême harmonique naturel
, ne l’eft pas dans le fyftême moderne. Dans le
premier, par exemple, l’accord r e ,fa , la, f i , 9 , 1 1 ,
13 , 15 , eft tout formé de tierces, puifqu’on peut in-
tercaller entre fes fons, l’accord m i,fo l, la, 10 , 12 ,
14 , aufli tout forme de tierces. ( Voyez la table de la
génération harm., col. I & II.) Dans le fyftême moderne
, les notes la rf i , forment une fécondé.
De ces deux fyftêmes, quel eft le préférable ? C ’eft
à l’expérience à décider. Or tous les fons du clavecin
naturel, c ’eft-à-dire, de celui dont tous les fons forment
une progreftîon harmonique par les longueurs ,
ou arithmétique, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , &c. par les
vibrations ; tous ces fons, ois-je, forment un accord
parfait. (V oyez mon art. Baffe fond, n°. 1 , huitîème
expérience.) Tous les fons du clavecin ordinaire,
frappés à la fois, forment une horrible cacophonie.
Le fyftême naturel eft donc le plus confon-
nant, le plus harmonieux. Eft-il aufli le plus facile
dans la pratique? (V o y e z mes art .Clavier', Clef,
Clef tranfpofée , Fugue.) (Af. Vabbe Feytou. )
DEIOS. Nom d’un air, ou nom de flûte des Grecs.
(A i. de C a flilh o n .)
DÉMANCHER, v. n. C ’eft fur les inftrumens à
manche, tels que le violoncelle, le violon, &c. oter
la jnam gauche de fa pofition naturelle pour 1 avancer
for une pofition plus haute ou plus à l’aigu. (V oyez
pofition) Le compofiteur doit connoître l’étendue qu a
l’inftrument fans démancher, afin que, quand il paffe
cette étendue & qu’il démanche, cela fë faffe d une
manière pra.icable. {J. J. Roujfeau. )
DEMANDE././ ou proportion. On appelle quelquefois
ainfi dans une fugue, ou dans tout autre
morceau ou l’imitation eft employée, lefujet que 1 on
propofe à imiter; & la phrafe qui y correspond fe
nomma réponfe. Cette phrafe propofée fe nomme
aufli le fujet, le dejfein , le motif, &c. En italien , la
Guida. (V o y e z Imitation.') (Af. Framery.)
DEMI-BATON. On appelle quelquefois le bâton
de deux mefures, demi-bâton , à çaufe qu’il eft tant
en valeur qu’en figures, la moitié du bâton, proprement
dit,qui vaut quatre mefures. (V o y e z bâton. )
( Af. de Caflilhon. )
DEMI-DESSUS. Quelques muficiens ont appelé
ainfi le deffus. (V oy e z Deffus.)
(Af. de Caflilhon.')
DEMI-JEU. A-demi-jeu, ou fimplement A demi.
Terme de mufique inftrumentale qui répond à l’italien,
fotto voce, ou mefâa voce, ou me^o forte, & qui
indique une manière de jouer qui tienne le milieu
entre le fort & le doux. ( / . J. Roujfeau.)
DEMI-MESURE, ƒ ƒ Efpace de temps qui dure
la moitié d’une mefure. Il n’y a proprement de demi-
mefures que dans les mefures dont les temps font en
nombre pair : car dans la mefure à trois temps, la
première demi-mefure commence avec le temps fort,
& la fécondé à contre-temps, ce qui les rend inégales.
( J. J. Roujfeau. )
D emi-m esu re. Dans une mufique bien cadencée,
c’eft-à-dire marquant bien la mefure, une demi mefure
eft un temps de la mefure à deux temps : elle en vaut
deux dans la mefure à quatre. Pour cela , il faut que
chaque temps, dans une mefure quelconque , foit
formé par un fon fondamental : que la mefure à deux
temps foit formée de deux fons fondamentaux, l’un
impair, qui produit le levé, l’autre pair, qui produit
le frappé : la mefure à trois temps de deux fons im-:
pairs, le premier pair par rapport au fécond, mais
impair par rapport au dernier temps de la mefure
antécédente ; le fécond impair & levé par rapport au
dernier qui eft pair, & qui répond au frappe. De
même la mefure à quatre temps, a trois fons fondamentaux
impairs & un pair. (V c y e z mon art. baffe-
fond, n°. III.) Je diftingue , comme on vo it, la
mefure des notes comprîtes entre les barres. Le repos
fuppofe la marche; le frappé fuppofe le levé. LesT
Grecs, fenfibles & délicats, avoient leur tétracorde ,
c’eft-à-dire, leur gamme, compofée d’après cette ob-
fervation: f i , ut ; re mi, 1 5 , 1 6 , 1 8 , 20 , ou 15 j 10,
9 , 1 0 , c’eft-à-dire , le vé , frappé. ( Voyez mon art.
baffe-fond, n°. III. ) Je ne dis pas qu’ils aient fait cette
obfervation: les inventeurs, ou plutôt les obferva-
teûrs du tétracorde grec, trou veront'ce chant, f i , ut,
re, mi, tout fait fur la bafle-fond., ut, ut, f o l , ut, 1 ,
2, 3 , 4. (V o y e z Quaternaire.)
Les Grecs, dira-t-on , ne fentirent pas la néceflité
de faire précéder le levé par le frappé^'puifqu’ils ajoutèrent
le la p,oflambanomèr.e àleur'fyllême général?
Oui, à leur fyftême, & non pas à'leur tétracorde. A
leur fyftême , afin d’en compléter le difdiapafon, c’eft-
à dire, les deux o<ftaves~, leur fyftême commençant
au grave, par un f i , & finiffant à l’aigu, par un la.
D’aiileurs , fi cette objeélion détruifoit la jufteffe & la
foüdiïé de mon principe , j en ferois quitte pour refufer
nettement aux Grecs, l’honneur de l’invention de leur
té:racorde. (V oyez mon art. Genre.)
Dans la mufique moderne, il faut bien fe garder de
confondre mefure avec cadence. De la mufique exactement
toifée , mefurée, on en trouve outre mefure:
de la mufique cadencée ( je parle de l’harmonie, car le
goût feul dicïe des chants qui le font parfaitement) il
ne faut pas efpérerd’en entendre, tant que les compo-
fiteurs n’auront pas d’autres rudiments de mufique que
ceux qu’on leur a mis entre les mains, qu’ils confultenc
& qu’ils communiquent à leurs élèves. (V o y e z mon
art. mefure. ) Pour donner de la cadence à l’harmonie,
c’eft-à-dire, pour la faire fentir dans toutes les parties,
il faudroit connoître les accords correfpondans au levé ;
ceux qui répondent au frappé ; ceux qui terminent la
phrafe, ceux qui ne font qu’en marquer les différens
membres. ( Voyez mon art. fondamental & ponéluer. )
C ’eft ce qu’ignorent parfaitement la majeure partie des
harmoniftes, qu’on rédeiroit à un filence abfolu, fi on
leur ôtoit leur clavecin, c’eft-à-dire , leur tâtonnement.
(Af. l'abbé Feytou.)
DEMI-PAUSE, f. f Cara&ère de mufique qui fe
fait comme il eft marqué dans la fig. 133 , pl. de muf.
& qui marque un filence dont la durée doit être égale
à celle d’une demi-mefure à quatre temps , ou d’une
blanche. Comme il y a des mefures de différentes
valeurs , & que celle de la demi-paufe ne varie point,
elle n’équivaut à la moitié a’une mefure que quand
la mefure entière vaut une ronde ; à la différence de