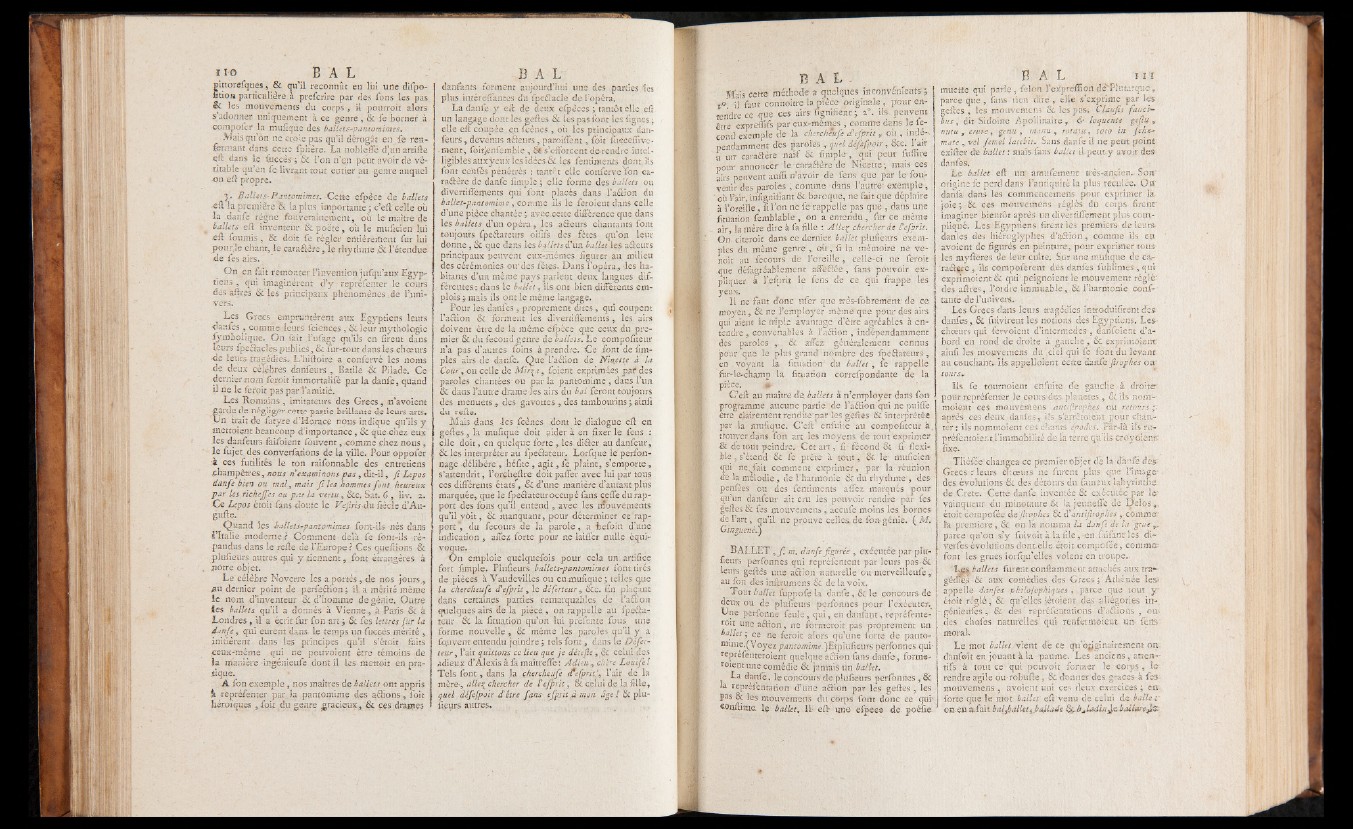
no B A L
fittorefques, & qu’il reconnût en lui une difpo-
tioa particulière à prefcrire par des fons les pas
& les mouvements du corps , il poiirroit alors
s’adonner uniquement à ce genre , & fe borner à
compofer la nm.fique des ballets-pantomimes. ■
-V>ais qu’on ne croie pas qu’il dérogât .en fe renfermant
dans cette fphère. La nobleffé d’un artifte
eft dans le (accès ; .& l’on n’en peut avoir de véritable
qu’en fe livrant tout entier au genre auquel
on eft propre.
3* Ballets-Pantomimes. Cette efpèce de ballets
■ eft la première '& la plus importante; c’eft celle où
■ la danfe règne fouverainement, où le maître de
ballets eft inventeur 8c poète, où lë muficien lui
e fl fournis , & doit fe régler entièrement fur lui
pour Je chant, le caraétère, le rbythnie p rétend u e
.de fes airs. T
On en fait remonter l’invention jufqu’aux Egyp-
tiens , qui imaginèrent d’y repréfenter le cours
des affres 8c les principaux phénomènes d e l’univers.
Les Grecs empruntèrent aux Egyptiens leurs
danfes , comme leurs fciences , 8c leur mythologie
Jymbolique. On fait .l’ufagè qu’ils en fireut dans
leurs fpeétaclès publics , & fur-tout dans-leschoeurs
-de leurs tragédies. L ’hiftoire -a confervé les noms
de deux célèbres danfeurs., Batile ■ & Pilade. Ce
dernier nom feroit immortalifé par la .danfe, quand
U ne le feroit pas par'l’amitié.
Les Romains , imitateurs des Grecs ^ n’a voient
garde de négliger cette partie brillante de leurs arts.
Un trait .de fatyre d’Horace nous indique qu’ils y
înettoient beaucoup d'importance, & quechez eux '
les danfeurs faifoient (auvent, comme .chez nous ,
le fujet des converfations de la yille. Pour ©ppofer
ces futilités le ton raifonnable des entretiens
champêtres, nous n examinons p as, dit-il, f i Lepos
danfe bien ou mal, mais f i les hommes font heureux
par les, richejfes ou par la vertu, 8cc. Sat. 6 , liv. 2.
C e Lepos étoit fans doute le Vefirisàu. ftèçle d’Au-
gufte.
Quand les balle-ts-pantomlmes font-ils nés dans
l ’Italie modem‘e ;? Comment delà fe font-ils -répandus
dans le relie de l’Europe ? Ces queftions &
plaideurs autres qui y tiennent, font étrangères à
notre objet.
Le célèbre Noverre les a.portés,.de nos jours.,
#u dernier point de perfeélion ; il a mérité même
le nom d’inventeur 8ç d’homme de génie. Outre
les ballets qu’il a donnés à Vienne, à Paris & à
Londres , il a écrit for fon art ; 8c fes lettres fur la
danfe, qui eurent dans le temps un fucçès mérité ,
initièrent dans les principes qu’il s’était- faits
ceux-même qui ne pcuvoient être témoins de
la manière ingénieufe dont il les mettoit en pratique.
A fon-exempîe, nos maîtres de ballets ont appris
& repréfenter par la pantomime des aélions, foit
héroïques , foit du genre gracieux, 8c çes drames
B A L
danfànts tonnent aujourd’hui une des parties les
plusrintéreffantes du fpeéiade de l’opéra.
La danfe y eft de deux efpèces ; tantôt elle ; eft
un langage dont les geftes & les pas font les fignes;
elle efl coupée en fcènes, où les principaux danfeurs
, devenus aéle.urs, parôiftént, foit 1 ïiccefiîve -
ment, foit^enfemble, 8s s’efforcent de-rendre intelligibles
auxÿeux les idées & les fentiments dont, ils
font cehfés pénétrés : tantôt elle conferveYon caractère
de danfe fimple ; elle forme des ballets ou
divertiftéments qui font placés dans l’adion du
ballet-pantomime, comme ils le feroient dans celle
d’une pièce chantée ; avec cette différence que dans
les ballets d’un opéra , les aâeurs chantants font
toujours fpe&ateurs oififs des fêtes qu’on leur
donne, 8c que dans les bfi.lets d\m ballet ieS a&eurs
principaux peuvent eux-mêmes figurer au milieu
des cérémonies ou* des fêtes. Dans l’opéra., des habitants
d’un même pays parlent deux langues différentes:,
dans le ballet, ils ont bien différents .emplois
j mais ils ont le même langage.
Pour les danfes , proprement dites, qui coupent
l’a&ion & forment les divèrtiffements , les airs
doivent être de la même efpèce que ceux clu premier
8c .du fécond genre de ballets. Le eompofiteur
n’a pas d’autres foins à prendre. Ç e font de (impies
airs de danfe. Que l ’aénon de Minette à la
Cour ) ou celle de Aîir^a, foient exprimées p a f des
paroles chantées-ou par la pantomime , dans l’un
8c dans l’autre drame les airs du bal feront toujours
des , menuets , des gavottes , des tambourins ; ainii
du reffé.
Mais-dans -les fcènes .dont le dialogue eft en
geftes „ la mufique doit aider à en fixer le feus :
elle doit, en quelque forte , les di&er au danfeur,
& les interpréter au fpeclateur. Lorfque le perfon-
nage délibère, héfite , agit, fe plaint, s’emporte,
s’attendrit , l’orçheftre doit paffer avee lui par tous
ces différents états, & d’une manière d’autast plus
marquée, que le fpeâateur occupé fans ceffe du rapport
des foiis qu’il entend , avec les îfTouvements
qu’il v ô it , 8c manquant, pour déterminer' ce rapport
, du fëcours de la parole, a hqfoin d’une
indication , affez forte pour ne laiffer nulle éqiijr
voque.
On emploie quelquefois pour cela un, artifice
fort fimple. Plufieurs ballets-pantomimes font tirés
de pièces à Vaudevilles ou enmufique; telles que
la chercheufe d efprit, le défcrteur, &c. En plaçant
dans certaines parties remarquables de l’afKon
quelques airs de la pièce,, on rappelle au fpe&a-
teur 8c la fituation qu’on lui préfente fous une
forme nouvelle, 8c même les paroles qu’il y a
fouvent entendu joindre ; te ls 'fon td an s le Défer-
teur, l’air quittons ce lieu que je dètefie , Si. celui ,des
adieux d’Alexis à fa maîtreffe: Adieu., chère Louife!
Tels fon t, dans la chercheufe tfeefprif, l’air de la
mère-, alle%_ chercher de Vefprit , 8c celui de la fille,
quel défefpoir d'être fans efp/it Kà. mon âge J & plu-
fieurs autres*
b a l .
Mais cette méthode a quelques Jnconvénlents: ;
t° . il faut connoître la pièce originale , pour en-
tendre cé que ces airs fignifient ; 20. ils, peuvent
être expreflîfs p a r eux-mêmes , comme dans le fécond
exemple d e la durcheufe £ efprit,. où /, indé-s
pendamment des. paroles vqud défefpoir , 8cc. l’air
a im caraâère n a ïf 8c fimple-, qui peut fumre
pour annoncer le cara&ère de N ice tte ; mais ces
airs peuvent aufli i f avoir de fens que par le;fou-
venir des paroles , comme dans l ’autre- exemple , ,
• 0ù p'àir, ihfignifiant 8c baroque, ne fait que déplaire
à l’o reille, fi l ’on ne fe-rappelle pas que ;, dans une
fituation femblabfe , on a entendu , fur ce même
air, la mère dire à fa fille : Alle^ chercher de L efprit.
On. citeroit dans ce dernier'. ballet plufieurs exem- .
pies du même g e n r e 'o ù , fi la mémoire ne v e-
noit au fècours dé l’o r e i lle , celle-ci ne feroit
.que défagreablement a ffè éîé e, fans pouvoir expliquer
à l’efprit le fens de ce qui frappe les
yeux;
Il ne faut donc ufer que très-fobremént de ce
moyen , & ne l’employer même' que pou r dés airs
qui aient le triple avantage d’être agréables a én-
tenclre , convenables à l’a â ion , indépendamment
des paroles r . 8c affez généralement connus
pour que le plus grand nombre des fpeélateurs ,
en voyant la, fituation du ballet, fe rappelle
fur-lé-champ la fituation correfpondante de la
pièce. ' &
G’efl: au maître dé, ballets à n’employer dans fon
programme aucune partie de l’âéfion qui ne puiffe
être clairement rendue'par les geftes & interprétée
par la nnifique. C ’eft enfuhe au eompofiteur à ,
trouver dans fon art les moyens de tout exprimer
& de tout peindre. C e t a r t , fi - fécond. 8c fi flexible
, s’étend & fe prête à to u t , 8c le- muficien-
qui ne^fait comment exprime r, par la réunion
de la mélodie , de l'harmonie 8c du rhythme , des-
penfées ou des fentiments affez marqués pour
qu’un danfeur ait cru les pouvoir rendre par fes
géftes 8c fes niouvemens , acculé moins les_ bornes-
de Part, qu’i l ne prouve ce lles de for>. génie. ( M .
Ginguenéd)
BALLET , f i m. danfe figurée , exécutée par plti-
fieurs perfonnes ,qui repréfentent par leurs pas-8c
leurs geftês une afiio.n -naturelle ou merveilleufe -,.
au fon des inftrumens 8c de la voix.
Tout ballet fuppofe la danfe , 8c le concours de
deux ou de plufieurs perfonnes pour l’exécuter^
Une perfonne feule, qui, en danfant, repréfente-
roit une aftion, ne formeroit; pas proprement un
ballet ; ce ne feroit alors qu’une forte de panto-
mune. (Voyez pantomime. )Etpiufieurs perfonnes qui-
reprefènteroient quelque action fans danfe, forme-
roiept une comédie 8c jamais lin ballet.
La danfe, le concours de plufieurs perfonnes , &
la repréléntation d’ une a&ion par les geftes , les
pas 8c les mouvemens du corps font donc ee qur
«pnftitue fe ballet* l\ ^ eft- une efpees de- poéfie-
B A L 1 n
muette qui parle, félon l’e^preffion de^Pîutarque,
parce q ue , fans rien dire , elle s’exprime par les
geftes , les mouvement & les pas. Claufis faneb-
bus | dit Sidoine Apollinaire , & loquente gefiu ,
nu tu , crtir-e , genu , monur rotatu, lo to in fehe~
mate , vel femel latebit. Sans danfe il ne peut point
exîfter de ballet : mais fans ballet il peut y avoir des-
dardés..'
Le ballet eft un- amufément très-ancien.. Son'
origine fe perd dans l’antiquité la plus reculée. Oïl'
danfa dans les commencemehs pour exprimer là
joie ; 8c ces mouvemens réglés du corps firent'
imaginér bientôt après un divertlffement plus compliqué.
Les Egyptiens firent les premiers de leurs-
dan fes des hiéroglyphes d ic tion , comme Ils en
avoient de figurés en peinture:, pour exprimer tous
les myftères de leur culte. Sur une mufique de ca.-
■ râétere , ils compofêrerit des danfes fublimes , qui
exprimoient 8c qui\peignoient le mouvement réglé'
des affres, l’ordre immuablev 8 c l’harmoaie confiante
de l’univers.
Les Grecs dans leurs tragédies introdüinrent des-
danfes v 8c fuivirent les notions des Egyptiens. Les-
éhoèiirs qui fervoient d’intermedes-, danloient d’abord
çn rond de droite à gauche , & exprimoient:
ainfi les- mouvemens du ^ciel qui fe font du levant-
au couchant, ils appelaient cette davl£q firophes ou
tours*
Us fe tournoient e'nfuîte dé gauche à droite“'
pour repréfenter "le cours des. planètes , 8c ils nora.--
moient ces mouvemens antiferoph.es ou retours f
après ces deux danfes, ils^s’arrêtoient pour charnier
: ils nommoient ces chants epodes, Fàr-îa'iîs re-
préfentoier.t rimmobilité de la terre qu’ils croÿoien«:
fixe.
Tlîéféè'changea ce premier objet dé la danfe des
Grecs :' leurs choeurs ne furent plus que l’imagé'
des évolutions & des détours du fameux labyrinthe,
de Crete. Cette danfe inventée 8c exécutée, par le:-
vainqueur du minotaure .& la jeunefté de Del os ,,
étoit compofée de firophes Sc d'antifirophes , . comme'
la première , on la nomma la danfe de la grue ,,
parce qa’on s’y fuivoità lafiie,-en faifant les di--
verfes évolutions dontêlle étoit compofée, commé
font les grues iorfqu’elles volent en troupe..
Les. ballets furent.conftammeut attachés aux tra*-
gêdie.S' & aux comédies des Grecs ; Athénée les-
appelle danfes pkilofophiques , parce que tout y:
étoit réglé, 8c qu’elles [étoient des; allégories in-
- génieafes-,' 8c des repréféntations d’aélioùs , ondes
chofes naturelles' qui renférmoient un- fens-
moral;
Le mot-ballet,Vient de ce qu’ô|j.ginairement on
dânfoit en jouant à la paume. Les anciens, attentifs
à tout ce qui pouvoit former le corps , îe-
rendre agile ou-robufte, 8c donner des grâces à fes-
mouvemens , avoient uni ces deux exercices ; eijv
forte que le mot ballet eft venu de celui de balle r
on. en aifait balfialletJaaUade 8g, bj ladin^Q bai lare