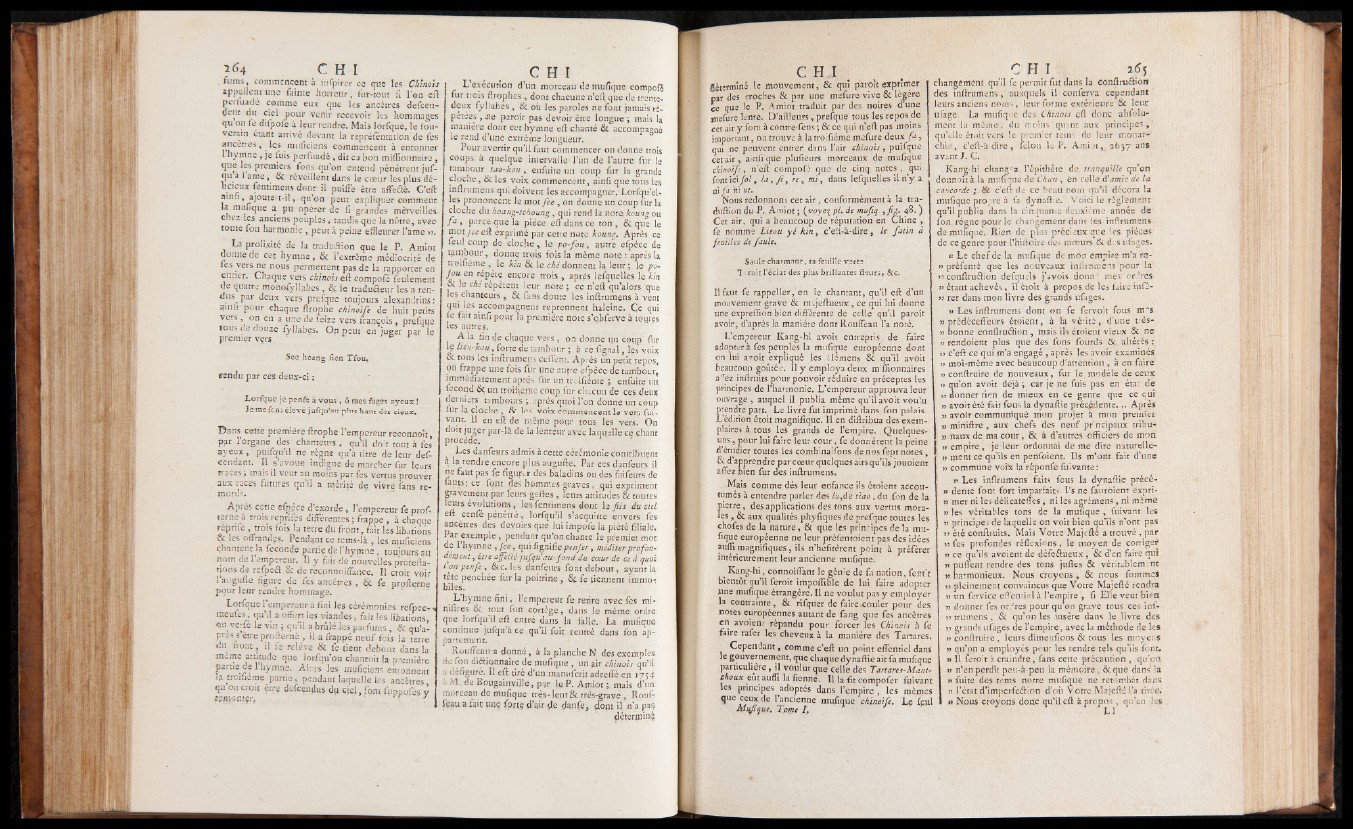
* furas» commencent à iufpirer ce que les Chinois
appellent une fa in te horreur, fur-tout fi l ’on eft
perluadé comme eux que less ancêtres defcen-
Qezit du ciel pour venir recevoir les hommages
qu on le dilpofe à leur rendre. Mais lorfque, le fou-
verain étant arrivé devant la repréfentation de fes
ancêtres, les muficiens commencent à entonner
1 hymne , je fuis perluadé, dit c j bon millionnaire ,
que les premiers fons qu’on entend pénètrent juf-
qu a 1 a me, & réveillent dans le coeur les plus dé-
licieux fentimens dont il puifle être afte&è. C ’eft
run.i, ajoute-t-il, qu’on peut expliquer comment
la mufique a pu opérer de fi grandes mèrveilles-
chez les anciens peuples, tandis que la nôtre, avec
toute fon harmonie , peut a peine effleurer l’ame >3.
La prolixité de la traduâion que le P. Amiot
donne de cet hymne, & l’extrême médiocrité de
fes .vers ne nous permettent pas de la rapporter en
entier. Chaque vers chinois eft compofé feulement
qe quatre monofyllabes , le tradu&eur les a rén-
.lls„ Par ^eux vers prefque toujours alexandrins :
amli pour chaque ftrophe chinoife de hqit petite
vers , on en a une de leize vers francois , prefque
tous cfe douze lyllabçs. On peut en juger par le
premier vers
See hoang lien Tfou,
pendu par ces deux-ci :
Xorfque je penfb à vous , ô mes fages ayeux !
Je me feu; élevé jufqu’au plus haut des deux*
Dans cette première flrophe l’empereur reconnoît,
ppr l’organe des chanteurs , qu’il doit tout a fes
a y eux , puifqu’il ne règne qu’à titre de leur def-
cendant. Il s’avoue indigne de marçher fur leurs
traces ; mais il veut au moins par fes vertus prouver
aux races futures qu il a mérite de vivre fans remords.
Api ès cette efpgce d’exorde, l ’empereur fe prof»
terne à trois reprifps differentes \ frappe , à chaque
réprife , trois fois la terre du front, fait les libations
& les offrandes. Pendant ce tems-là , les muficiens
çhantent la fécondé partie de l'hymne . toujours au
nom de l’empereur. Il y fait de nouvelles protefta-
tjons de refpeéè & de reçpnnoifiaiice. Il croit voir
1 aiigulle figure de fes ancêtres , & fe prpfterne
pour leur rendre hommage.
Lorfque l’empereur a fini les cérémonies refpec-%
tueufes, qu’il a offert les viandes, fait les libations
ou verfé le vin ; qu'il a brûlé les parfums, & quJa-
pres s’être profterné , il a frappé neuf fois la terre
du front, il fe .relève & fe tient debout dans la
meme attitude que lorfqu’on chantoit la première
partie de l’hymne. Alors les muficiens entonnent
la troilieme partie, pendant laquelle les ancêtres
qu’on croit être defcen^us du ciel, font fuppofés y
fgjnontçrf . ; ■ -, J
L exécution d’un morceau de mufique compofé
fur trois ftrophes , dont chacune n’eft que de trente-
deux fyllabes , & où les paroles ne font jamais répétées
, -ne paroît pas devoir être longue ; mais la
manière dont cet hymne eft chanté & accompagné
le rend d’une extrême longueur.
Pour avertir qu’il faut commencer on donne trois
coups à quelque intervalle l’un de l’autre fur le
tambour tao-kou, enfuite un coup fur la grande
cloche, & les, voix commencent, ainfi que tous les
inftrumèns qui doivent les accompagner. Lorfqu’el-
les prononcent le mot fee , on donne un coup fur la
j cloche du hoang-tchoung, qui rend la note* koungow
I fa > parce que la pièce eft dans ce ton , & que le
motjee eft exprimé par cette note koung. Après ce
feul coup de cloche, le po-fou, autre efpèce de
tambour, donnq trois fois la même note : après la
troifième le kin & le ché donnent la leur ; le po-
fou en répète ençore trois , après lefqçelles le kin
& le ché répètent leur note ; ce n’eft qu’alors ~que
le§ chanteurs , & fans doute les inftrumens à vent
qui les accompagnent reprennent haleine. Çe qui
fe fait ainfi pour la première note s’qbferye à toutes
les autres.
A la fin çje chaque vers , on donne iin coup fur
' 1? lien-kou, forte de tamboup ; à ce lignai, les voix
& tous les inftrumeps ceiTen;. Après un petit repos,
on frappe une fois fur une aupe efpèce'de tambour,
immédiatement après fur un troifième ; enfuite un
fecoqd Sç un troifième coup fur chacun de ces deux
derniers tambours ; «près quoi l’on donne un coup
fur la cloche , & les voix commencent le vers fui*»
vant. 11 en eft de même poijr tous les yers. On
doit juger par-là de la lenteur avec laquelle ce chant
procède.
Les danfeurs admis à cette cérémonie contribuent
à la rendre encore plus augufte. Par ces danfeurs il
ne faut pas fe figurer des baladins ou des faifeurs de
fauts: ce fqnt des hommes graves ,^qui expriment
gravement par leurs geftes , leurs attitudes & toutes
leurs évolutions , les fentimens dont le fils du ciel
eft cenfé pénétré, lorfqu’il sJacquitte envers fes
ancêtres des devoirs que lui impofe la piété filiale.
Par exemple, pendant qu’on chante le premier mot
de 1 hymne , jee., qui fignifie penfer, méditer profondément
, être ajfeflé jufqu’au fond du coeur de c.e à quoi
l'on penfe, &c. les danfeurs font debout, ayant la
tête penchée fur la poitrine, & fe tiennent immobiles.
L hymne fini, Fempereur fe retire avec fes mi*
niftres & tout fbn cortège, dans le même ordre
que lorfqu il eft entré dans la fa lie. La mufique
continue jufqu’à ce qu’il foit rentré dans fon appartement.
Roufîeau a donne, a la planche N des exemples
de fon dictionnaire de mufique , un air chinois qu’il
a défiguré. 11 eft tire d’un manufcirit adreffé en 1754
à M. de Bougainville, par le P. Amiot ; mais d’un
morceau de mufique très-lent & très-grave , Rouf*,
fçau 3 fait unç fprt§ d’air de d^nfe, dont il n’a pas
déterminé
C H I
flètermînê le mouvement, & quï paroît exprimer
par des croches & par une mefure-vive & légère
ce que le P. Amiot traduit par des noires d’une
inefure lente. D ’ailleurs, prelque tous les repos de
cet air y font à contre-fens ; & ce qui n’eft pas moins
important, on trouve à la troifième mefure deux fa,
qui ne peuvent entrer dans l’air chinois, puifque
cet air , ai-nfi que plufieurs morceaux de mufique
chinoife, n’eft compofé que de cinq notes , qui
font ici fo l, la, f i , re, mi, dans lefquelles il n’y a
ni fa ni ut.
Nous redonnons cet air , conformément à la traduction
(JuJP. Amiot ; (voyeç pl. de mufiq ,fig. 48. )
Cet air, qui a beaucoup de réputation en Chine ,
fç nomme Licou yé kin, c’eÜ-à-dire , le fatin à
feuilles de faule.
Saule charmant, ta feuille verte
T ernit l’éclat des plus brillantes fleurs, &c.
Il faut fe rappeller, en le chantant, qu’il eft d’un
mouvement grave & majeftueux, ce qui lui donne
une exprefïion bien différente de celle qu’il paroît
avoir, d’après la manière dont Roufleau l’a noté.
L’empereur Kang-hi avoir entrepris de faire
adopter à fes peuples la mufique européenne dont
on lui a voit expliqué les démens & qu’il avoit
beaucoup goûtée. Il y employa deux miflionnaires
a^ez infiruits pour pouvoir réduire en préceptes les
principes de l’harmonie. L’empereur approuva leur
ouvrage , auquel il publia même qu’il avoit voulu
prendre part. Le livre fut imprimé dans fon palais. !
L’édition étoit magnifique. Il en diftribua des exemplaires
àjous les grands de l’empire. Quelques-
uns , pour lui faire leur cour, fe donnèrent la peine
d’étudier toutes les combinaifons de nos fept notes ,
& d’apprendre par coeur quelques airs qu’ils jouoient
affez bien fur des inftrumens.
Mais comme dès leur enfance ils étoient accoutumés
à entendre parler des lu,de tiao, du fon de la
pierre, des applications des fons aux vertus morales
, & aux qualités phyfiques de prefque toutes les
chofes de la nature, & que les principes de la mufique
européenne ne leur préfentoient pas des idées
aufli magnifiques, ils n’héfitèrent point à préférer
intérieurement leur ancienne mufique.
Kan^-hi , connoiffant le génie de fa nation, fent’t
bientôt qu’il fçroit impoflible de lui faire adopter
*me mufique étrangère. Il ne vo.ulut pas y employer
la contrainte, & rifquer de faire .couler pour des
notes européennes autant de fang que fes ancêtres
en avoient répandu pour forcer les Chinois à fe
faire rafer les cheveux à la manière des Tartares.
le gouvernement, que chaque dynaftie ait fa mufiqus
particulière , il voulut que celle des Tartares-Mant•
fihoux eut aufli la fienne. Il la fit compofer fifivan
les principes adoptés dans l’empire, les même:
<jue ceux de l’ancienne mufique chinoife. Le feu
Mufique. Tptne I. * J
changement qu’il fe permit fut dans la conftruâion
des inftrumens, auxquels il conferva cependant
leurs anciens noms, leur forme extérieure & leur
ufage. La mufique des Chiriois eft donc abfolu-
mënt la même, du moins, quant aux principes,
qu’elle étoit vers le premier teins de leur monarchie,
c’eft-à-dire, félon le P. Amiot, 2637 ans
avant J. C.
Kanrg-hi changea l’épithète de tranquille qu’on
donnoit à la mufique de Ch an , en celle à'amie de la
concorde ; & c’eft de ce beau nom qu’il décora la
mufique propre à fa dynaftie." Voici le réglement
qu’il publia dans la cinquante deuxième année de
fon règne pour le changement dans les inftrumens
de mufique. Rien de plus précieux que les pièces
de ce genre pour l’hiftoire des moeurs & d. s ufages.
« Le chef de la mufique de mon empire m’a re-
|| préfenté que les nouveaux inftramens pour la
3 3 conftruélion defquels j’ a vois-donné mes or J . res
33 étant achevés, il étoit à propos_.de les faire infé-
3j rer dans mon livre des grands ufages.
3> Les inftrumens dont on fe fervoit fous m~s
33 prédéceffeurs étoient, à la vérité ^ d’une très-
33 bonne conftruélion , mais ils étoient vieux & ne
3> rendoient plus que des fons fourds & altérés :
33 c’eft ce qui m’a engagé , après les avoir examinés
» moi-même avec beaucoup d’attention , à en faire
1? conftruire de nouveaux, fur le modèle de ceux
» qu’on avoit déjà ; car je ne fuis pas en éta: de
33 donner rien de mieux en ce genre que ce qui
» avoit été fait fous la dynaftie précédente. .. Après
33 avoir communiqué mon projet à mon premier
i3 miniftre, aux chefs des neuf pr'ncipaux tribu-
w naux de ma cour, & à d’autres officiers de mon
» empire, je leur ordonnai de me dire naturelle-
» ment ce qu’ils en penfoient. Us m’ont fait d’une
» commune v c& la réponfe fuivante :
3i Les inftrumens faits fous la dynaftie précé-
3» dente font fort imparfaits. Us ne fauroient expri-
3) mer ni les délicatefles j ni les agrémens, ni même
33 les véritables tons de la mufique , fuivant les
33 principes dé laquelle on voit bien qu’ils n’ont pas
33 été conftruits. Mais Votre Majcfté a trouvé , par
33 fes profondes réflexions, le moyen de corriger
>3 ce qu’ils avoient de défeélueux , & d’en faire qui
33 puffent rendre des tons juftes & véritablem-nt
>3 harmonieux. Nous croyons , & nous fommes
33 pleinement convaincus que Votre Majefté rendra
33 un fervice eftentiel à l’empire , fi Elle veut bien
33 donner fes ordres pour qu’on grave tous ces inf-
33 trumens , & qu’on les insère dans le livre des
33 grands ufages de l’empire, avec la méthode de les
w cpnftruire , leurs dimenfions & tous les moyens
33 qu’on a employés pour les rendre tels qu’ils font.
» Il feroit à craindre, fans cette précaution , qu’on
»3 n’en perdît peu-à-peu la mémoire , &que dans la
1» fuite des tems notre mufique ne retombât dans
33 l’état d’imperfeéfion d’où Votre Majefté Fa tirée.
» Nous croyons donc qu’il eft à propos , qu’en les